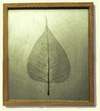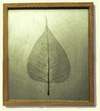 |
Forum Mettâ
Bouddhisme originel
|
| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
idir
Inscrit le: 19 Fév 2010
Messages: 46
|
 Posté le: Mar 01 Mar, 2011 3:03 Sujet du message: Posté le: Mar 01 Mar, 2011 3:03 Sujet du message: |
 |
|
| Chaosophe a écrit: | | idir a écrit: | | l’esprit humain, tout au moins ce que nous identifions comme un «moi», est fourbe" |
| Bouddha a écrit: | | "Moines, avez-vous vu un chef-d'oeuvre pictural ?" "Oui, Seigneur." "Moines, ce chef d'oeuvre artistique est une conception du mental. Vraiment, moines, le mental est plus artistique que ce chef-d'œuvre" » (Le Bouddha ; SN 22.100). |
| Buddhagosa a écrit: | | « Comment la conscience (c'est-à-dire le mental) est-elle capable de produire une telle variété d'effets par ses actions ? [...] Une inspiration artistique survient chez les peintres de chefs-d'oeuvres, qui les pousse à agencer les formes de telle ou telle façon. Lors de cette conception s'accomplissent des opérations du mental (ou opérations artistiques) exécutant des tâches telles que le dessin des contours, l'application de la peinture, les retouches et embellissements [...] Ainsi, toutes les formes d'art dans le monde, spécifiques ou génériques, sont accomplies par le mental. En vertu de sa capacité à produire une telle variété d'effets par ses actions, le mental qui accomplit tous ces arts est en lui-même artistique. Non : il est même plus artistique que l'art lui-même, qui ne peut exécuter parfaitement chaque oeuvre. » (Buddhagosa, Atthasáliní, I, II, 64). |
| Nietzsche a écrit: | "Nous inventons à coup d’affabulation la plus grande part de l’expérience vécue [...] On est bien plus artiste qu’on ne le sait » (Nietzsche, PBM)
« [L'esprit est habité par] cette pression et ce penchant continuels d’une force créatrice, formatrice, habile à se métamorphoser » (ibidem). |
Dans ce texte Nietzsche souligne notre inattention :
| Nietzsche a écrit: | | "Pas plus qu’un lecteur, aujourd'hui, ne lit intégralement les mots [...] nous ne voyons un arbre de manière précise et exhaustive ». |
| idir a écrit: | | Marcher sur le chemin menant vers l’éveil revient à marcher sur le fil du rasoir, à tout moment on risque de tomber, vu l’étroitesse du chemin, ou bien être coupé |
| Nietzsche a écrit: | | "L'homme est une corde tendue entre la bête et le Surhumain – une corde au-dessus de l'abîme. / Danger de franchir l'abîme – danger de suivre cette route – danger de regarder en arrière – danger d'être saisi d'effroi et de s'arrêter court !" (Nietzsche, APZ) |
|
je suis très loin d’être un connaisseur de Nietzsche, mais je le soupçonne (ayez de l’indulgence et pardonnez moi pour cette prétention) d’avoir vampirisé la pensée bouddhiste en apportant sa touche bien sûr (par exemple l’eternel retour). comparée au bouddhisme, la philosophie nietzschéenne me parait très inaboutie. elle donne l’impression d’être un flux de sautes d’humeur, une volonté de tout transcender qui débouche…sur la folie de son initiateur. de ce point de vue là elle se situe aux antipodes de l’idéal bouddhique qui mène à le cessation totale de la souffrance |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
cgigi2
Modérateur
Inscrit le: 02 Mar 2007
Messages: 793
|
 Posté le: Mar 01 Mar, 2011 7:59 Sujet du message: Posté le: Mar 01 Mar, 2011 7:59 Sujet du message: |
 |
|
| Citation: | Nietzsche a écrit:
"L'homme est une corde tendue entre la bête et le Surhumain – une corde au-dessus de l'abîme. / Danger de franchir l'abîme – danger de suivre cette route – danger de regarder en arrière – danger d'être saisi d'effroi et de s'arrêter court !" (Nietzsche, APZ) |
gigi dit:
Le danger aussi est une conception du mental, en réalité il n'y a que la réalité absolue d'où tout d'écoule, point de danger dans la Vérité de la Vie,
nul abîme dans l'esprit, que pureté et clarté 
avec metta
gigi

_________________
Que tous soient en liaison
Avec les Bouddhas des Trois Temps
Passés, Présents et Futurs,
Ici et Maintenant. |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Chaosophe
Inscrit le: 13 Avr 2008
Messages: 125
|
 Posté le: Mar 01 Mar, 2011 14:07 Sujet du message: Posté le: Mar 01 Mar, 2011 14:07 Sujet du message: |
 |
|
| idir a écrit: | | je le soupçonne [...] d’avoir vampirisé la pensée bouddhiste en apportant sa touche bien sûr (par exemple l’eternel retour). comparée au bouddhisme, la philosophie nietzschéenne me parait très inaboutie. elle donne l’impression d’être un flux de sautes d’humeur, une volonté de tout transcender qui débouche…sur la folie de son initiateur. de ce point de vue là elle se situe aux antipodes de l’idéal bouddhique qui mène à le cessation totale de la souffrance |
Vous avez une intuition très juste sur ce que Nietzsche doit au bouddhisme. Bien que le moustachu connaissait très mal la doctrine de l'Eveillé (faute de textes à l'époque), il semble lui avoir emprunté beaucoup de choses. Celui qui se prétendait "le Bouddha d'Europe" a au moins le mérite d'avoir fait l'éloge du Dhamma, comme nul le l'avait fait auparavant (il dit du bouddhisme qu'il est "une hygiène" et une "physiologie", qui aurait dépassé tous les préjugés moraux et opéré la première "inversion de toutes les valeurs"...). Seulement on a surtout retenu de Nietzsche des accusations particulièrement sévères contre le Bouddhisme, décrit comme "nihilisme" et "décadence" : les bouddhistes rechercheraient la paix, le calme, le néant, par incapacité à supporter la souffrance et tout ce que la vie contient de changeant, chaotique, absurde et douloureux. Et il est vrai qu'il est très très difficile de répondre à ces objections. On pourrait demander, par provocation : rechercher l'Eveil et la fin de la souffrance, n'est-ce pas reconnaître que l'on n'aime pas la vie comme elle est et que, par faiblesse, par lassitude, par hypersensibilité à la souffrance, on recherche un monde de calme, de paix et de sérénité, ce qui est l'inverse de la vie - donc qu'on recherche la mort, le néant ? Ce qui pousse à ce genre d'objections, c'est le fait que Nibbâna soit décrit comme "cessation du devenir", "fin de l'existence" (conditionnée), "au-delà des peines", donc comme un arrière-monde bien rassurant, qui semble n'avoir rien de commun avec l'existence quotidienne... Bien sûr, on peut toujours répondre que Nibbâna n'est pas le néant, qu'il n'est ni être ni non être, etc... Mais Nietzsche savait tout ça, et il maintient pourtant ses objections. Nietzsche reconnait l'impermanence ("Il n'y a aucun état de fait, tout est fluctuant, insaisissable, évanescent", FP XII, 2 [82]) ; il reconnait la douleur universelle ("ce que l'existence a de terrible et de problématique") ; il reconnait l'absence de moi (« Il n'y a ni "esprit", ni raison, ni pensée, ni conscience, ni âme, ni volonté, ni vérité" ; FP 1888, 14 [122]). Pourtant, il ne souhaite pas sortir du samsâra, mais veut "l'Eternel Retour" de l'existence... Il dit qu'il est comme le rêveur lucide, qui veut retourner dans le rêve ; que l'illusion et l'ignorance sont nécessaires à la survie ; que le désir ne doit pas être condamné mais affirmé ; que la force c'est être capable d'aimer, rechercher et vouloir la souffrance comme un stimulant et un moteur du dépassement de soi ; etc...
C'est ça qui est intéressant : le fait que Nietzsche reconnait les 3 caractéristiques de l'existence (anicca, dukkha et anatta), et que pourtant il ne souhaite pas l'Eveil : au contraire il veut la souffrance et l'illusion (il adhère au samsâra, comme dans le Zen). Nietzsche et le Bouddha semblent extrêmement proches à beaucoup d'égard : même lorsque Nietzsche croit s'opposer au bouddhisme, il s'en rapproche de façon "ironique" (comme l'a montré Morrison). Pourtant ils semblent parfois totalement opposés et inconciliables : le Bouddha serait nihiliste (il voudrait la fin du devenir) et Nietzsche serait affirmateur (il voudrait le retour du devenir). Mais peut-être que l'on peut résorber cette opposition. Car cette affirmation dont parle Nietzsche, cette adhésion inconditionnelle, ce "dire OUI à la vie dans tout ce qu'elle contient de terrible et de problématique" - Nietzsche le qualifie de "nihilisme viril" ou de "nihilisme de la force", c'est-à-dire à la capacité à nier et à détruire (nos croyances, nos préjugés, nos vénérations, etc.), pour pouvoir ensuite créer à nouveau (créer des valeurs, une civilisation supérieure, un Surhomme, etc.). Or on trouve quelque chose comme cela dans le canon pali :
| Citation: | | La croyance : “Je ne devrais pas être ; Ca ne devrait pas m'arriver ; Je ne serais pas ; Cela ne m'arrivera pas » est « le point de vue suprême extérieur [au Dhamma]», car celui qui a cette croyance ne s'attache pas au devenir, ni ne s'attriste de la fin du devenir ; mais il y « a encore [en lui] de l’aberration, il y a changement ». Donc il faut se détacher de la croyance annihiliste : alors on « devient dépassionné envers ce qui est suprême, et encore plus envers ce qui est inférieur » (SN 22.55). |
Dans ce texte, la croyance annihiliste (ucchedaditthi), d'habitude classée parmi les vues fausses, est décrite « comme la plus haute des vues spéculatives extérieures (etadaggam bâhirakânam ditthigatânam), la raison étant que celui qui accepte une telle vue ne sera pas attaché à l’existence ni réfractaire à la cessation de l’existence » (commentaire). - D'autres textes montrent que la volonté de néant - une des causes de la souffrance - peut-être utilisée pour mettre fin au devenir ; mais ultimement, elle doit être abandonnée. Tout se passe comme si le "nihilisme" était utilisé pour être retourné contre lui-même, exactement comme le fait Nietzsche ; et cela, bien que Nietzsche se vante d'être "le premier nihiliste parfait", c'est-à-dire le premier nihiliste fort et viril, et qu'il condamne le bouddhisme comme "nihilisme de la faiblesse"... Bref, le Bouddha anticipe Nietzsche, lequel croit le réfuter alors qu'il l'imite !
Voici quelques citations nietzschéennes pour ceux qui voudraient approfondir (cf. Antéchrist) :
| Citation: | Le bouddhisme serait une « religion de la décadence », une « religion qui convient à la fin et à la lassitude de la civilisation » (§ 22)
« La pitié convertit au néant !... On ne dit pas "néant" : à la place, on dit "au-delà" ; ou "Dieu" ; ou "la vraie vie" ; ou le nirvâna, la rédemption, la béatitude… ». |
Nietzsche dit qu’il ne veut pas « porter préjudice » au Dhamma, et s’avoue « profondément reconnaissant aux savants indianistes » de pouvoir le comparer au christianisme, pour l’estimer supérieur. Il reconnait au bouddhisme un profond réalisme lucide, c'est-à-dire la capacité de poser des problèmes objectivement et froidement. Il souligne les bonnes conditions d’émergence du bouddhisme : après le brahmanisme, « la notion de "Dieu" est déjà liquidée quand il survient ». Le bouddhisme serait la « seule religion effectivement positiviste », c'est-à-dire réaliste, objective, lucide. Le bouddhisme a raison de faire la « guerre à la souffrance » ; car le bonheur n’est pas la satisfaction ou la paix, mais l’augmentation de la puissance, la guerre. Supérieur au christianisme, le bouddhisme « a dépassé [...] le leurre de soi-même que sont les notions morales, — il se tient [...] par delà Bien et le Mal ». En effet, rappelez-vous que le Dhammapada dit de l’Eveillé qu’« il a dépassé bien et mal » (Dhp, § 39 ; cf. Udâna, XXVIII-6). Le bouddhisme aurait pour condition une sensibilité excessive (la « susceptibilité à la souffrance », une capacité de souffrir raffinée) et une intellectualité excessive (une trop longue vie dans les concepts et les procédures logiques, ce qui rend l’individu « impersonnel », neutre, objectif). « Le mécontentement de soi-même, la souffrance devant soi-même » est « chez les bouddhistes une hyperesthésie et une excessive susceptibilité a la douleur » (§ 22). C'est contre cette dépression que le Bouddha préconise une sorte « d’hygiène » : la vie en plein air et vagabonde, la modération et le discernement dans l’alimentation, la prudence à l’égard de l’alcool et des affects violents, l’insouciance totale. Le bouddhisme exclut la prière et l’ascèse mortificatrice. Le grand avantage du bouddhisme serait de mettre fin au ressentiment, c'est-à-dire à la haine des faibles contre les forts et contre eux-mêmes (Nietzsche cite alors le « touchant refrain » du Dhammapada : « ce n’est pas l’hostilité qui met fin à l’hostilité »). Nietzsche fait l’éloge de l’égoïsme, la fierté et l’orgueil bouddhiste, en quoi il me semble voir juste… (car l’amour bienveillant, metta, vient précisément de l’amour légitime que l’on se porte à soi-même, cf. SN 3 : 8 : « On ne trouve personne nulle part plus cher que soi-même » ; SN 1 : 12 : « Il n’y a d’affection que celle qu’on a pour soi-même »). Les conditions d’apparition du bouddhisme seraient un climat très tempéré, des mœurs douces et tolérantes, l’absence de militarisme, l’existence d’une classe sociale supérieure et savante. Le bouddhisme veut la « belle humeur » (l’allégresse qui accompagne ou définit le sentiment de puissance), le calme et l’absence de désir. « Et ce but, on l’atteint ». Le bouddhisme serait une religion pour des hommes tard venus, des races devenues bonnes, douces, surin¬tellectualisées, qui éprouvent trop facilement de la douleur. « L'Europe n'est de loin pas encore mûre pour lui ». Le bouddhisme serait une « façon de ramener » de tels hommes à la paix, à la belle humeur, au régime dans l'ordre intellectuel, à un certain endurcissement de l'ordre physique. En tout cas le bouddhisme est « cent fois plus froid, plus véridique, plus objectif », « cent fois plus réaliste » que le christianisme : il n’a « pas besoin de rendre convenable à ses yeux sa souffrance [...] au moyen de l'interprétation du péché » ; il ne fait que dire ce qu'il pense (« je souffre », sans honte ni dénégation de la souffrance). |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
idir
Inscrit le: 19 Fév 2010
Messages: 46
|
 Posté le: Mar 01 Mar, 2011 17:56 Sujet du message: Posté le: Mar 01 Mar, 2011 17:56 Sujet du message: |
 |
|
| Chaosophe a écrit: | | idir a écrit: | | je le soupçonne [...] d’avoir vampirisé la pensée bouddhiste en apportant sa touche bien sûr (par exemple l’eternel retour). comparée au bouddhisme, la philosophie nietzschéenne me parait très inaboutie. elle donne l’impression d’être un flux de sautes d’humeur, une volonté de tout transcender qui débouche…sur la folie de son initiateur. de ce point de vue là elle se situe aux antipodes de l’idéal bouddhique qui mène à le cessation totale de la souffrance |
Vous avez une intuition très juste sur ce que Nietzsche doit au bouddhisme. Bien que le moustachu connaissait très mal la doctrine de l'Eveillé (faute de textes à l'époque), il semble lui avoir emprunté beaucoup de choses. Celui qui se prétendait "le Bouddha d'Europe" a au moins le mérite d'avoir fait l'éloge du Dhamma, comme nul le l'avait fait auparavant (il dit du bouddhisme qu'il est "une hygiène" et une "physiologie", qui aurait dépassé tous les préjugés moraux et opéré la première "inversion de toutes les valeurs"...). Seulement on a surtout retenu de Nietzsche des accusations particulièrement sévères contre le Bouddhisme, décrit comme "nihilisme" et "décadence" : les bouddhistes rechercheraient la paix, le calme, le néant, par incapacité à supporter la souffrance et tout ce que la vie contient de changeant, chaotique, absurde et douloureux. Et il est vrai qu'il est très très difficile de répondre à ces objections. On pourrait demander, par provocation : rechercher l'Eveil et la fin de la souffrance, n'est-ce pas reconnaître que l'on n'aime pas la vie comme elle est et que, par faiblesse, par lassitude, par hypersensibilité à la souffrance, on recherche un monde de calme, de paix et de sérénité, ce qui est l'inverse de la vie - donc qu'on recherche la mort, le néant ? Ce qui pousse à ce genre d'objections, c'est le fait que Nibbâna soit décrit comme "cessation du devenir", "fin de l'existence" (conditionnée), "au-delà des peines", donc comme un arrière-monde bien rassurant, qui semble n'avoir rien de commun avec l'existence quotidienne... Bien sûr, on peut toujours répondre que Nibbâna n'est pas le néant, qu'il n'est ni être ni non être, etc... Mais Nietzsche savait tout ça, et il maintient pourtant ses objections. Nietzsche reconnait l'impermanence ("Il n'y a aucun état de fait, tout est fluctuant, insaisissable, évanescent", FP XII, 2 [82]) ; il reconnait la douleur universelle ("ce que l'existence a de terrible et de problématique") ; il reconnait l'absence de moi (« Il n'y a ni "esprit", ni raison, ni pensée, ni conscience, ni âme, ni volonté, ni vérité" ; FP 1888, 14 [122]). Pourtant, il ne souhaite pas sortir du samsâra, mais veut "l'Eternel Retour" de l'existence... Il dit qu'il est comme le rêveur lucide, qui veut retourner dans le rêve ; que l'illusion et l'ignorance sont nécessaires à la survie ; que le désir ne doit pas être condamné mais affirmé ; que la force c'est être capable d'aimer, rechercher et vouloir la souffrance comme un stimulant et un moteur du dépassement de soi ; etc...
C'est ça qui est intéressant : le fait que Nietzsche reconnait les 3 caractéristiques de l'existence (anicca, dukkha et anatta), et que pourtant il ne souhaite pas l'Eveil : au contraire il veut la souffrance et l'illusion (il adhère au samsâra, comme dans le Zen). Nietzsche et le Bouddha semblent extrêmement proches à beaucoup d'égard : même lorsque Nietzsche croit s'opposer au bouddhisme, il s'en rapproche de façon "ironique" (comme l'a montré Morrison). Pourtant ils semblent parfois totalement opposés et inconciliables : le Bouddha serait nihiliste (il voudrait la fin du devenir) et Nietzsche serait affirmateur (il voudrait le retour du devenir). Mais peut-être que l'on peut résorber cette opposition. Car cette affirmation dont parle Nietzsche, cette adhésion inconditionnelle, ce "dire OUI à la vie dans tout ce qu'elle contient de terrible et de problématique" - Nietzsche le qualifie de "nihilisme viril" ou de "nihilisme de la force", c'est-à-dire à la capacité à nier et à détruire (nos croyances, nos préjugés, nos vénérations, etc.), pour pouvoir ensuite créer à nouveau (créer des valeurs, une civilisation supérieure, un Surhomme, etc.). Or on trouve quelque chose comme cela dans le canon pali :
| Citation: | | La croyance : “Je ne devrais pas être ; Ca ne devrait pas m'arriver ; Je ne serais pas ; Cela ne m'arrivera pas » est « le point de vue suprême extérieur [au Dhamma]», car celui qui a cette croyance ne s'attache pas au devenir, ni ne s'attriste de la fin du devenir ; mais il y « a encore [en lui] de l’aberration, il y a changement ». Donc il faut se détacher de la croyance annihiliste : alors on « devient dépassionné envers ce qui est suprême, et encore plus envers ce qui est inférieur » (SN 22.55). |
Dans ce texte, la croyance annihiliste (ucchedaditthi), d'habitude classée parmi les vues fausses, est décrite « comme la plus haute des vues spéculatives extérieures (etadaggam bâhirakânam ditthigatânam), la raison étant que celui qui accepte une telle vue ne sera pas attaché à l’existence ni réfractaire à la cessation de l’existence » (commentaire). - D'autres textes montrent que la volonté de néant - une des causes de la souffrance - peut-être utilisée pour mettre fin au devenir ; mais ultimement, elle doit être abandonnée. Tout se passe comme si le "nihilisme" était utilisé pour être retourné contre lui-même, exactement comme le fait Nietzsche ; et cela, bien que Nietzsche se vante d'être "le premier nihiliste parfait", c'est-à-dire le premier nihiliste fort et viril, et qu'il condamne le bouddhisme comme "nihilisme de la faiblesse"... Bref, le Bouddha anticipe Nietzsche, lequel croit le réfuter alors qu'il l'imite !
Voici quelques citations nietzschéennes pour ceux qui voudraient approfondir (cf. Antéchrist) :
| Citation: | Le bouddhisme serait une « religion de la décadence », une « religion qui convient à la fin et à la lassitude de la civilisation » (§ 22)
« La pitié convertit au néant !... On ne dit pas "néant" : à la place, on dit "au-delà" ; ou "Dieu" ; ou "la vraie vie" ; ou le nirvâna, la rédemption, la béatitude… ». |
Nietzsche dit qu’il ne veut pas « porter préjudice » au Dhamma, et s’avoue « profondément reconnaissant aux savants indianistes » de pouvoir le comparer au christianisme, pour l’estimer supérieur. Il reconnait au bouddhisme un profond réalisme lucide, c'est-à-dire la capacité de poser des problèmes objectivement et froidement. Il souligne les bonnes conditions d’émergence du bouddhisme : après le brahmanisme, « la notion de "Dieu" est déjà liquidée quand il survient ». Le bouddhisme serait la « seule religion effectivement positiviste », c'est-à-dire réaliste, objective, lucide. Le bouddhisme a raison de faire la « guerre à la souffrance » ; car le bonheur n’est pas la satisfaction ou la paix, mais l’augmentation de la puissance, la guerre. Supérieur au christianisme, le bouddhisme « a dépassé [...] le leurre de soi-même que sont les notions morales, — il se tient [...] par delà Bien et le Mal ». En effet, rappelez-vous que le Dhammapada dit de l’Eveillé qu’« il a dépassé bien et mal » (Dhp, § 39 ; cf. Udâna, XXVIII-6). Le bouddhisme aurait pour condition une sensibilité excessive (la « susceptibilité à la souffrance », une capacité de souffrir raffinée) et une intellectualité excessive (une trop longue vie dans les concepts et les procédures logiques, ce qui rend l’individu « impersonnel », neutre, objectif). « Le mécontentement de soi-même, la souffrance devant soi-même » est « chez les bouddhistes une hyperesthésie et une excessive susceptibilité a la douleur » (§ 22). C'est contre cette dépression que le Bouddha préconise une sorte « d’hygiène » : la vie en plein air et vagabonde, la modération et le discernement dans l’alimentation, la prudence à l’égard de l’alcool et des affects violents, l’insouciance totale. Le bouddhisme exclut la prière et l’ascèse mortificatrice. Le grand avantage du bouddhisme serait de mettre fin au ressentiment, c'est-à-dire à la haine des faibles contre les forts et contre eux-mêmes (Nietzsche cite alors le « touchant refrain » du Dhammapada : « ce n’est pas l’hostilité qui met fin à l’hostilité »). Nietzsche fait l’éloge de l’égoïsme, la fierté et l’orgueil bouddhiste, en quoi il me semble voir juste… (car l’amour bienveillant, metta, vient précisément de l’amour légitime que l’on se porte à soi-même, cf. SN 3 : 8 : « On ne trouve personne nulle part plus cher que soi-même » ; SN 1 : 12 : « Il n’y a d’affection que celle qu’on a pour soi-même »). Les conditions d’apparition du bouddhisme seraient un climat très tempéré, des mœurs douces et tolérantes, l’absence de militarisme, l’existence d’une classe sociale supérieure et savante. Le bouddhisme veut la « belle humeur » (l’allégresse qui accompagne ou définit le sentiment de puissance), le calme et l’absence de désir. « Et ce but, on l’atteint ». Le bouddhisme serait une religion pour des hommes tard venus, des races devenues bonnes, douces, surin¬tellectualisées, qui éprouvent trop facilement de la douleur. « L'Europe n'est de loin pas encore mûre pour lui ». Le bouddhisme serait une « façon de ramener » de tels hommes à la paix, à la belle humeur, au régime dans l'ordre intellectuel, à un certain endurcissement de l'ordre physique. En tout cas le bouddhisme est « cent fois plus froid, plus véridique, plus objectif », « cent fois plus réaliste » que le christianisme : il n’a « pas besoin de rendre convenable à ses yeux sa souffrance [...] au moyen de l'interprétation du péché » ; il ne fait que dire ce qu'il pense (« je souffre », sans honte ni dénégation de la souffrance). |
je crois que Nietzsche s’opposait au bouddhisme par vanité et désir de reconnaissance. s’il disait qu’il était d’accord avec cette doctrine, alors il n’aurait plus rien à dire étant donné que la voie a été déjà pavée durant les 25 siècles qui ont suivi l’avènement du bouddha, tout ce qu’il avait à faire c’était d’entrer dans le courant et cheminer sur cette voie, par contre s’il élevait quelques protestations contre tel enseignement ou telle croyance bouddhique alors il aurait matière à écrire et à discourir, lui ouvrant ainsi la porte de la gloire et la postérité.
les vérités bouddhiques, comme un boomerang, lui sont revenues droit au visage, lui qui a voulu se complaire dans la souffrance a été bien servi. mais le problème c’est qu’il était incapable de supporter la souffrance qu’il désirait tant pour se sentir vivre et exister. pour preuve cet épisode de sa vie où il était entrain de se promener avec sa sœur (ou peut-être l’une de ses connaissances féminines) et tout d’un coup il éclata en sanglots car submergé par une angoisse qui lui venait du plus profond de son intériorité. Nietzsche mourut dans la démence, incapable même de prononcer un seul mot, lui qui célébra la puissance et la volonté, trépassa dans la déchéance et la dépendance totale.
de Nietzsche on pourrait dire qu’il était le bourreau de lui-même. il a péché (nous revoilà dans le judéo-christianisme) par orgueil et il en a payé le prix fort, il a voulu ignorer le remède proposé par Bouddha mais la loi de cause à effet ne l’a pas ignoré
la démarche créatrice de Nietzsche est semblable à ces artistes, écrivains, poètes…qui estiment que la souffrance est nécessaire à la création. il a troqué la paix intérieur contre les dividendes d’une célébrité qu’il a payé très chère.
pour moi Nietzsche est un personnage qui n’apporte rien de neuf ni d’utile |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Chaosophe
Inscrit le: 13 Avr 2008
Messages: 125
|
 Posté le: Mer 02 Mar, 2011 15:34 Sujet du message: Posté le: Mer 02 Mar, 2011 15:34 Sujet du message: |
 |
|
| idir a écrit: | | je crois que Nietzsche s’opposait au bouddhisme par vanité et désir de reconnaissance [...]. Tout ce qu’il avait à faire c’était d’entrer dans le courant et cheminer sur cette voie, par contre s’il élevait quelques protestations contre tel enseignement [...] alors il aurait matière à écrire et à discourir, lui ouvrant ainsi la porte de la gloire et la postérité". |
Mais ne peut-on pas critiquer le bouddhisme pour d'autres motifs que le désir de reconnaissance ? Je ne sais pas si Nietzsche réclamait la gloire : il revendiquait l'incompréhensibilité, était volontairement obscur, ne voulait pas être accessible à tout le monde... Il disait qu'il ne serait compris qu'en l'an 4000...
| idir a écrit: | | "Les vérités bouddhiques, comme un boomerang, lui sont revenues droit au visage, lui qui a voulu se complaire dans la souffrance a été bien servi. mais le problème c’est qu’il était incapable de supporter la souffrance qu’il désirait tant pour se sentir vivre et exister". |
Je trouve votre analyse très puissante. Nietzsche avoue rechercher la souffrance comme "un stimulant" ; mais dire qu'il en avait besoin pour "se sentir vivre", c'est montrer ce qu'il peut y avoir de maladif et d'addictif dans cette attitude. Malheureusement, la preuve que vous apportez ne me semble pas concluante. Car si vous faites bien référence au prétendu "effondrement de Nietzsche" sur la place de Turin, où il serait tombé en sanglot, il faut savoir que c'est une pure légende ! Quant à la folie de Nietzsche, elle lui venait d'une maladie (probablement de la syphilis), et absolument pas des conséquences de sa pensée radicale ! Sa folie n'est donc pas une preuve contre le bienfondé de sa réflexion.
| idir a écrit: | | "il était le bourreau de lui-même". |
Il affirme lui-même qu'il faut "être à deux doigts de la tyrannie". Cela veut dire qu'il faut pratiquer un certain ascétisme (comme dans le bouddhisme) ; mais pas du tout un ascétisme castrateur et mortificateur ("à deux doigts de..."). C'est une nouvelle affinité avec le bouddhisme : critique et récupération simultanées de l'ascétisme.
| idir a écrit: | | "il a péché (nous revoilà dans le judéo-christianisme) par orgueil et il en a payé le prix fort" |
Je ne suis pas sûr que le vocabulaire chrétien soit le mieux adapté en contexte bouddho-nietzschéen. Et cela est révélateur d'une certaine condamnation morale qui s'énonce dans votre propos. Faudrait-il "brûler les hérétiques" ?!
| idir a écrit: | | "la démarche créatrice de Nietzsche est semblable à ces artistes, écrivains, poètes…qui estiment que la souffrance est nécessaire à la création". |
Encore une analyse très juste me semble-t-il. On touche la un problème de fond : si la souffrance est inhérente et consubstantielle à la vie (comme le reconnaissent le Bouddha et Nietzsche), faut-il en conclure que combattre la souffrance, c'est combattre la vie, donc être une vie ratée (Nietzsche) ? ou conclure que combattre la souffrance, c'est défendre la vie contre son pire ennemi, et créer ainsi une vie différente, supérieure (le Bouddha) ?
Pour moi l'alternative est indécidable. Car aussi bien Nietzsche que le Bouddha semble adhérer aux 2 réponses simultanément. Ainsi Nietzsche dit vouloir la souffrance, mais il précise qu'il faut la vouloir comme un ennemi contre lequel lutter :
| Nietzsche a écrit: | | "Il y a pour [notre orgueil] un incomparable attrait, face à un tyran tel que la douleur et à toutes les insinuations qu’elle nous souffle pour nous faire porter témoignage contre la vie – à prendre précisément parti pour la vie contre le tyran" (A, § 114, trad. Wotling, Nietzsche et le problème de la civilisation, p. 146. Cf. HTH II, préface, § 5). |
Quant au Bouddha, il combat la souffrance, mais il affirme qu'elle est une condition de l'Eveil et qu'il ne faut pas la fuir ou la nier, mais la connaître, l'éprouver, l'accepter et la comprendre :
| Gotama a écrit: | | La souffrance est « la condition suffisante de la confiance (saddhā) », d’où provient le bien-être, la joie spirituelle, etc., et finalement l'Eveil (SN 12 : 22). |
La différence est peut-être que Nietzsche dit qu'il faut lutter contre la souffrance sans vouloir de victoire définitive - car l'idéal de libération définitive serait une illusion rassurante née de la faiblesse. Mais là encore, on peut amoindrir l'opposition entre Nietzsche et le Bouddha, car pour celui-ci l'Eveil n'exclut pas la souffrance : un Eveillé expérimente encore la souffrance, seulement elle ne perturbe plus son esprit...
| idir a écrit: | | il a troqué la paix intérieur contre les dividendes d’une célébrité qu’il a payé très chère. |
Nietzsche n'a jamais été célèbre. Très peu le lisaient de son vivant, et plus d'un siècle après sa mort, il reste négligé dans l'enseignement et l'histoire de la philosophie. Surtout, l'intéressant est sa critique de la paix intérieur : si la vie est changement, violence, chaos, "volonté de puissance", alors vouloir la paix c'est vouloir la mort ! Allez répondre à ça... Quelle puissante objection ! Quelle étrange tension il y a, dans le bouddhisme, entre la reconnaissance de la fugacité (l'impermanence de toute chose), et la recherche d'une réalité "éternelle", en tout cas soustraite au changement ! Le bouddhisme : remède - ou maladie ? |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
idir
Inscrit le: 19 Fév 2010
Messages: 46
|
 Posté le: Lun 28 Mar, 2011 14:56 Sujet du message: Posté le: Lun 28 Mar, 2011 14:56 Sujet du message: |
 |
|
| Chaosophe a écrit: | | idir a écrit: | | je crois que Nietzsche s’opposait au bouddhisme par vanité et désir de reconnaissance [...]. Tout ce qu’il avait à faire c’était d’entrer dans le courant et cheminer sur cette voie, par contre s’il élevait quelques protestations contre tel enseignement [...] alors il aurait matière à écrire et à discourir, lui ouvrant ainsi la porte de la gloire et la postérité". |
Mais ne peut-on pas critiquer le bouddhisme pour d'autres motifs que le désir de reconnaissance ? Je ne sais pas si Nietzsche réclamait la gloire : il revendiquait l'incompréhensibilité, était volontairement obscur, ne voulait pas être accessible à tout le monde... Il disait qu'il ne serait compris qu'en l'an 4000...
| idir a écrit: | | "Les vérités bouddhiques, comme un boomerang, lui sont revenues droit au visage, lui qui a voulu se complaire dans la souffrance a été bien servi. mais le problème c’est qu’il était incapable de supporter la souffrance qu’il désirait tant pour se sentir vivre et exister". |
Je trouve votre analyse très puissante. Nietzsche avoue rechercher la souffrance comme "un stimulant" ; mais dire qu'il en avait besoin pour "se sentir vivre", c'est montrer ce qu'il peut y avoir de maladif et d'addictif dans cette attitude. Malheureusement, la preuve que vous apportez ne me semble pas concluante. Car si vous faites bien référence au prétendu "effondrement de Nietzsche" sur la place de Turin, où il serait tombé en sanglot, il faut savoir que c'est une pure légende ! Quant à la folie de Nietzsche, elle lui venait d'une maladie (probablement de la syphilis), et absolument pas des conséquences de sa pensée radicale ! Sa folie n'est donc pas une preuve contre le bienfondé de sa réflexion.
| idir a écrit: | | "il était le bourreau de lui-même". |
Il affirme lui-même qu'il faut "être à deux doigts de la tyrannie". Cela veut dire qu'il faut pratiquer un certain ascétisme (comme dans le bouddhisme) ; mais pas du tout un ascétisme castrateur et mortificateur ("à deux doigts de..."). C'est une nouvelle affinité avec le bouddhisme : critique et récupération simultanées de l'ascétisme.
| idir a écrit: | | "il a péché (nous revoilà dans le judéo-christianisme) par orgueil et il en a payé le prix fort" |
Je ne suis pas sûr que le vocabulaire chrétien soit le mieux adapté en contexte bouddho-nietzschéen. Et cela est révélateur d'une certaine condamnation morale qui s'énonce dans votre propos. Faudrait-il "brûler les hérétiques" ?!
| idir a écrit: | | "la démarche créatrice de Nietzsche est semblable à ces artistes, écrivains, poètes…qui estiment que la souffrance est nécessaire à la création". |
Encore une analyse très juste me semble-t-il. On touche la un problème de fond : si la souffrance est inhérente et consubstantielle à la vie (comme le reconnaissent le Bouddha et Nietzsche), faut-il en conclure que combattre la souffrance, c'est combattre la vie, donc être une vie ratée (Nietzsche) ? ou conclure que combattre la souffrance, c'est défendre la vie contre son pire ennemi, et créer ainsi une vie différente, supérieure (le Bouddha) ?
Pour moi l'alternative est indécidable. Car aussi bien Nietzsche que le Bouddha semble adhérer aux 2 réponses simultanément. Ainsi Nietzsche dit vouloir la souffrance, mais il précise qu'il faut la vouloir comme un ennemi contre lequel lutter :
| Nietzsche a écrit: | | "Il y a pour [notre orgueil] un incomparable attrait, face à un tyran tel que la douleur et à toutes les insinuations qu’elle nous souffle pour nous faire porter témoignage contre la vie – à prendre précisément parti pour la vie contre le tyran" (A, § 114, trad. Wotling, Nietzsche et le problème de la civilisation, p. 146. Cf. HTH II, préface, § 5). |
Quant au Bouddha, il combat la souffrance, mais il affirme qu'elle est une condition de l'Eveil et qu'il ne faut pas la fuir ou la nier, mais la connaître, l'éprouver, l'accepter et la comprendre :
| Gotama a écrit: | | La souffrance est « la condition suffisante de la confiance (saddhā) », d’où provient le bien-être, la joie spirituelle, etc., et finalement l'Eveil (SN 12 : 22). |
La différence est peut-être que Nietzsche dit qu'il faut lutter contre la souffrance sans vouloir de victoire définitive - car l'idéal de libération définitive serait une illusion rassurante née de la faiblesse. Mais là encore, on peut amoindrir l'opposition entre Nietzsche et le Bouddha, car pour celui-ci l'Eveil n'exclut pas la souffrance : un Eveillé expérimente encore la souffrance, seulement elle ne perturbe plus son esprit...
| idir a écrit: | | il a troqué la paix intérieur contre les dividendes d’une célébrité qu’il a payé très chère. |
Nietzsche n'a jamais été célèbre. Très peu le lisaient de son vivant, et plus d'un siècle après sa mort, il reste négligé dans l'enseignement et l'histoire de la philosophie. Surtout, l'intéressant est sa critique de la paix intérieur : si la vie est changement, violence, chaos, "volonté de puissance", alors vouloir la paix c'est vouloir la mort ! Allez répondre à ça... Quelle puissante objection ! Quelle étrange tension il y a, dans le bouddhisme, entre la reconnaissance de la fugacité (l'impermanence de toute chose), et la recherche d'une réalité "éternelle", en tout cas soustraite au changement ! Le bouddhisme : remède - ou maladie ? |
en lisant ce que tu as écrit sur Nietzsche je me suis rappelé cette formidable réflexion que Claude Levi Strauss a faite sur le bouddhisme.
“Qu’ai-je appris d’autre, en effet, des maîtres que j’ai écoutés, des philosophes que j’ai lus, des sociétés que j’ai visitées et de cette science même dont l’Occident tire son orgueil, sinon des bribes de leçons qui, mises bout à bout, reconstituent la méditation du Sage au pied de l’arbre ? Tout effort pour comprendre détruit l’objet auquel nous nous étions attachés, au profit d’un effort qui l’abolit au profit d’un troisième et ainsi de suite jusqu’à ce que nous accédions à l’unique présence durable,
qui est celle où s’évanouit la distinction entre le sens et l’absence de sens : la même d’où nous étions partis. Voici deux mille cinq cent ans que les hommes ont découvert et ont formulé ces vérités. Depuis nous n’avons rien trouvé, sinon — en essayant après d’autres toutes les portes de sortie — autant de démonstrations supplémentaires de la conclusion à laquelle nous aurions voulu échapper.
Sans doute, j’aperçois aussi les dangers d’une résignation trop hâtive. Cette grande religion du non-savoir ne se fonde pas sur notre infirmité à comprendre. Elle atteste notre aptitude, nous élève jusqu’au point où nous découvrons la vérité sous forme d’une exclusion mutuelle de l’être et du connaître. Par une audace supplémentaire elle a — seule avec le marxisme — ramené le problème métaphysique à celui de la conduite humaine. Son schisme s’est déclaré sur le plan sociologique, la différence
entre le Grand et le Petit Véhicule étant de savoir si le salut d’un seul dépend ou non du salut de l’humanité toute entière. »
♦ Claude Levi-Strauss, Tristes tropiques, p.493, éditions Plon, collection Terre
humaine / Pocket, 10/2008. |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Chaosophe
Inscrit le: 13 Avr 2008
Messages: 125
|
 Posté le: Ven 01 Avr, 2011 12:54 Sujet du message: Posté le: Ven 01 Avr, 2011 12:54 Sujet du message: |
 |
|
| MAGNIFIQUE !!! Du pain béni... |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
|
|
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
|
|