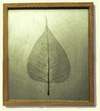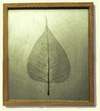 |
Forum Mettâ
Bouddhisme originel
|
| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
Istiqama

Inscrit le: 01 Fév 2010
Messages: 86
|
 Posté le: Mar 16 Mar, 2010 20:58 Sujet du message: questionnement sur Anatta Posté le: Mar 16 Mar, 2010 20:58 Sujet du message: questionnement sur Anatta |
 |
|
Anatta est l'une des difficultés majeures que je rencontre dans l'enseignement de Bouddha. Intellectuellement, je n'arrive pas à saisir la doctrine Anatta mais... c'est peut-être tout simplement que c'est indicible !
Quoi qu'il en soit, j'aimerai connaître votre analyse car mon incompréhension tient probablement aussi à une confusion dans l'approche que j'ai de la question.
Selon l'enseignement de Bouddha, il n'existe pas dans l'homme une entité permanente, absolue. Il n'existe pas d'âme. En fait, ce n'est pas cela qui me plonge vraiment dans la confusion mais le fait que l'on lise dans l'enseignement de Bouddha que l'on puisse se rappeler de toutes ses vies antérieures ou qu'un tel ait atteint un tel niveau spirituel qu'il est assuré de ne plus avoir que tant de renaissances à connaître. En fait, vous l'avez compris, je n'arrive pas à mettre en concordance l'Anatta et le Kamma. Où se niche cette mémoire que nous avons de nos vies antérieures ? Qu'est-ce qui permet de "transporter" d'une vie à l'autre un "niveau" spirituel ?
Par ailleurs, si l'on peut affirmer que le nibbana n'est pas être exprimé par le langage humain, qu'est-ce qui en nous a finalement conscience de ce caractère particulier du nibbana ? Car pour dire qu'on ne peut pas le décrire, c'est que d'une manière ou d'une autre on en a conscience. Ca revient à une forme de perception.
Voilà, je suis conscient de la confusion de ce que je dis et de l'empêtrement dans lequel je me trouve.
Ceci dit, et ça va peut-être vous paraître difficile à croire mais c'est vrai, ça ne m'empêche pas de méditer, de pratiquer de mon mieux. Ca ne sème pas le doute dans mon esprit. Je ressens plutôt ces questions comme un verrou qu'il faut faire sauter. J'ai l'intuition diffuse qu'il suffit d'un rien, que je n'examine pas la question dans le bon sens.
Peut-être que l'un d'entre vous trouvera le mot juste !
Bonne soirée !
_________________
Comme une mère protègerait son unique enfant au risque de sa propre vie, cultivons un amour sans limite envers tous les êtres. |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Dukkhanirodha

Inscrit le: 11 Déc 2009
Messages: 57
|
 Posté le: Mer 17 Mar, 2010 1:52 Sujet du message: Posté le: Mer 17 Mar, 2010 1:52 Sujet du message: |
 |
|
anatta n'est pas quelque chose à comprendre avec l'intellect. Il faut le réaliser par expérience directe. Pour cela, il faut observer anicca, par la pratique de vipassana.
_________________
http://www.tipitaka.fr |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Adrien

Inscrit le: 31 Aoû 2008
Messages: 205
Localisation: Toulouse
|
 Posté le: Mer 17 Mar, 2010 3:03 Sujet du message: Posté le: Mer 17 Mar, 2010 3:03 Sujet du message: |
 |
|
Je suis d'accord avec dukkhanirodha.
Cependant, la compréhension intellectuelle m'aide, donc je te donne mon ressenti.
Un nuage qui devient pluie est pour moi une bonne illustration d'anatta : la pluie provient du nuage, c'est la continuité du nuage, mais pourtant, ce sont deux choses qui ont des propriétés bien différentes. De même, Adrien à 25 ans, ça n'est pas la même chose qu'Adrien à 10 ans, et c'est encore plus différent de Adrien bébé. Il y a des moments clés où des changements plus radicaux se produisent : la petite enfance, l'adolescence, les traumatismes, etc. Mais le plus radical de tous, c'est la mort. La personne qui renaît peut renaître sur un autre plan d'existence, ou dans une famille et un milieu social très différent. La personne qui renaît est la même personne que celle qui est morte, au même titre qu'Adrien à 25 ans est la même personne qu'Adrien bébé. Mais la personne qui renaît est différente de celle qui est morte, au même titre qu'Adrien à 25 ans est différent d'Adrien bébé.
D'instant en instant, on n'a pas conscience du changement permanent, et pour percevoir cela, ça passe par la méditation (et ça sera cette perception directe d'anicca qui nous aidera à comprendre plus profondément anatta).
Quand le Bouddha nous parle d'anatta, il ne nous enseigne pas quelque chose qu'il faut apprendre, et en laquelle il faut croire. Il faut juste porter un regard différent sur nous-mêmes, et se rendre compte qu'on croit en l'existence d'un "soi" à protéger, alors qu'en fait, on n'a jamais rien vu de stable en nous. Peut-être qu'il y a quelque chose de stable, mais nous ne l'avons jamais vu.
Ce que nous prenons pour le soi, ça peut être le corps, les émotions, les opinions, la personnalité, une idée philosophique d'un soi subtile, etc.
Cette notion peut donc avoir une influence dans notre vie de tous les jours : en changeant notre regard (conformément à ce que nous savons ne pas savoir), on déconditionne nos réactions. On ne s'identifie plus aux émotions, aux opinions, etc. (tout du moins on essaie).
De mon côté, quand une forte émotion me prend, j'essaie de l'observer sans parti pris, comme j'observerais une mouche posée sur ma main. De même, sans chercher à n'avoir aucune opinion, j'essaie de ne pas trop en créer, de ne pas y accorder trop d'importance, et de laisser de côté les sujets futiles. J'ai conscience qu'elles sont en constante évolution, qu'elles se construisent souvent à partir de bien peu de choses, et que d'y attacher une grande importance est souvent source de souffrance.
Par contre, j'ai énormément de mal à ne pas m'identifier à ma personnalité.
Par ailleurs, je crois percevoir qu'anatta est lié à l'équanimité.
| Citation: | | En fait, vous l'avez compris, je n'arrive pas à mettre en concordance l'Anatta et le Kamma. Où se niche cette mémoire que nous avons de nos vies antérieures ? Qu'est-ce qui permet de "transporter" d'une vie à l'autre un "niveau" spirituel ? |
Une métaphore m'a bien éclairé à ce sujet : les kamma de ma vie actuelle porteront des fruits dans mes prochaines vies : mais qu'est-ce qui fait le lien ?
En fait, c'est comme un pommier : où se cachent les pommes dans la graine, ou dans l'arbre qui est en train de pousser ? Ou si je reprends tes mots : qu'est-ce qui a permis de "transporter" les pommes de la graine aux branches de l'arbre ?
| Citation: | | Par ailleurs, si l'on peut affirmer que le nibbana n'est pas être exprimé par le langage humain, qu'est-ce qui en nous a finalement conscience de ce caractère particulier du nibbana ? Car pour dire qu'on ne peut pas le décrire, c'est que d'une manière ou d'une autre on en a conscience. Ca revient à une forme de perception. |
Oui. Mais je ne vois pas le problème...
Comment expliquer la couleur rouge à un aveugle de naissance ? On peut toujours essayer de faire un rapprochement avec ce qu'il connaît : le rouge c'est vif, donc ça ressemblera plus à quelque chose de goûtu qu'à quelque chose de fade. Le rouge, ça ressort bien, donc ça ressemblera plus à un son distinct qu'à un son diffus, etc.
Je pense que pour nibbana, c'est un peu la même chose : on est un peu comme des aveugles de naissance. |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Pieru
Web

Inscrit le: 17 Jan 2007
Messages: 256
Localisation: France sud
|
 Posté le: Mer 17 Mar, 2010 8:28 Sujet du message: Posté le: Mer 17 Mar, 2010 8:28 Sujet du message: |
 |
|
Anatta passe aussi par le fait que nous ne sommes pas le centre du monde, il est surement nécessaire de "s'oublier" soi-même littéralement en œuvrant par exemple pour les autres.
Anatta lié à anicca c'est sur.
Ce qui renait? C'est ce qui est présent maintenant en nous, ce processus, ces habitudes mentales qui procède du samsara.
C'est ce qui renait (et meurt) à chaque instant quand nous nous identifions à un objet, une pensée, une sensation, etc tout ce que nous faisons "notre". Ad vitam eternam jusqu'à nibbana.
Amicalement dans le dhamma
_________________
"Qui connait la nature connait le Dhamma". |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
cgigi2
Modérateur
Inscrit le: 02 Mar 2007
Messages: 793
|
 Posté le: Mer 17 Mar, 2010 16:27 Sujet du message: Posté le: Mer 17 Mar, 2010 16:27 Sujet du message: |
 |
|
| Citation: | | Ce monde est supporté par un dualisme, celui de l'existence et de la non-existence. Mais quand on voit avec juste discernement l'origine du monde tel qu'il est, "non-existence" n'est pas le terme qu'on retient. Quand on voit avec juste discernement la cessation du monde tel qu'il est, "existence" n'est pas le terme qu'on retient. (Kaccayanagotta Sutta) |
avec metta
gigi

_________________
Que tous soient en liaison
Avec les Bouddhas des Trois Temps
Passés, Présents et Futurs,
Ici et Maintenant. |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Chaosophe
Inscrit le: 13 Avr 2008
Messages: 125
|
 Posté le: Jeu 25 Mar, 2010 17:33 Sujet du message: Posté le: Jeu 25 Mar, 2010 17:33 Sujet du message: |
 |
|
Bonjour.
Comment concilier kamma et anatta ? Il faut bien voir que c'est justement parce qu'il y a la loi du kamma qu'il n'y a pas de soi ! En effet, kamma exprime la loi de conditionnalité, c'est-à-dire le fait que toute chose est causante et causée, et ultimement que tout est interdépendant. Or, si chaque chose dépend de causes et de conditions, aucune chose n'a d'existence propre, indépendante, réelle, donc aucune n'a de "soi". Cela est clair et infaillible.
Donc l'homme n'est pas une substance, une essence, une personne, un "moi", mais il n'est pas tout à fait rien non plus, un néant, une inexistence totale. L'homme n'est ni être, ni non-être : il est une série, c'est-à-dire un enchainement de causes et d'effets. C'est cela qui permet de se rappeler de nos vies antérieures : nous sommes reliées à elles par un enchainement de causes et d'effets. L'homme est une série causale, sans continuité réelle (il n'y a pas d'âme qui transmigre), mais constitué d'un enchainement qui relie chacun des instants de sa vie, et donc qui permet la remémoration des vies antérieures.
Vous demandez "ce qui en nous a finalement conscience de ce caractère particulier du nibbana ? Car pour dire qu'on ne peut pas le décrire, c'est que d'une manière ou d'une autre on en a conscience. Ca revient à une forme de perception".
Mais un être non éveillé n'a pas "conscience du nibbâna". Un être éveillé non plus n'en n'a pas conscience : car nibbâna, c'est la fin de la conscience ! Cela dit, les être éveillés, après avoir vécu l'expérience (ou plutôt la non-expérience) du nibbâna, réalisent que leur conscience étaient absente durant cette "expérience" ; donc ils saisissent négativement (par contraste) la réalité de nibbâna. De plus, il n'est pas nécessaire d'avoir conscience de nibbâna, ou l'idée qu'il existe, pour suivre le Chemin ; au contraire, le Bouddha affirme à plusieurs reprise que la recherche active du nibbâna (lorsqu'elle s'accompagne d'un désir impatient, inquiet, soucieux) constitue un obstacle à l'Eveil ! |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
cgigi2
Modérateur
Inscrit le: 02 Mar 2007
Messages: 793
|
 Posté le: Jeu 25 Mar, 2010 21:49 Sujet du message: Posté le: Jeu 25 Mar, 2010 21:49 Sujet du message: |
 |
|
| Citation: | Dans le Ditthi Sutta (Anguttara Nikaya, X, 93), le disciple Anathapindika résume de façon pragmatique le point de vue philosophique bouddhiste :
Tout ce qui est venu à l'existence résulte de conditions, de volitions, de l'interdépendance. Tout cela est impermanent. Tout ce qui est impermanent est insatisfaisant. Tout ce qui est insatisfaisant n'est pas moi, n'est pas mien, n'est pas un "soi". |
avec metta
gigi

_________________
Que tous soient en liaison
Avec les Bouddhas des Trois Temps
Passés, Présents et Futurs,
Ici et Maintenant. |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Istiqama

Inscrit le: 01 Fév 2010
Messages: 86
|
 Posté le: Ven 26 Mar, 2010 22:19 Sujet du message: Posté le: Ven 26 Mar, 2010 22:19 Sujet du message: |
 |
|
Merci pour votre attention mais, malheureusement, je ne suis toujours pas satisfait.
J'ai bien compris la problématique de la production conditionnée, du kamma, de l'impermanence, etc. Ce n'est pas ça qui me pose un problème intellectuel. Je dis bien intellectuel puisque j'ai précisé que ça ne bousculait pas ma "fois" et ma pratique. Simplement, comme on en parle dans beaucoup de livres sur le bouddhisme et que les explications sont loin, très loin d'être claires et logiques (quand elles ne sont pas contradictoires), la question m'a semblé intéressante.
Encore un fois, je ne me place pas dans une logique dogmatique. En clair, je ne cherche pas à expliquer ce que je ne comprends pas par ce que je comprends encore moins bien dans des livres. Ca revient à expliquer l'obscur par le plus obscur. C'est le ressenti qui m'intéresse, le reste n'est que verbiage.
Dire : c'est justement parce qu'il y a la loi du kamma qu'il n'y a pas de soi , ça demande des explications dans la mesure où, pour moi, le kamma résulte de la volition. Or, qui dit volition, dit quelqu'un ou quelque chose, je ne sais pas, qui veut. Peut-être la conscience, non? Parce qu'après tout, la conscience est un continuum... Que les choses et les êtres n'aient pas d'existence indépendante, c'est possible mais les choses et les êtres ont des propriétés que nous pouvons expérimenter, ce qui signifie qu'elles et ils ont une certaine "réalité" (relativisée, bien entendu, par l'interdépendance, etc.)
Je suis d'accord avec la déclaration "L'homme n'est ni être, ni non-être : il est une série, c'est-à-dire un enchainement de causes et d'effets" mais le raisonnement ne va pas jusqu'au bout, à mon sens. Il reste à expliquer la mémoire et à trouver ce qui fait le lien entre les différents éléments de la "série". Un collier de perles est bien composé de perles placées les unes à côté des autres mais il y a un fil, un fil conducteur, qui les relie.
Quant à nibbana, bien sûr, je ne peux pas en témoigner d'expérience, hélas, mais dire que c'est la fin de la conscience... il me semble que ce n'est pas une analyse que tous les maîtres connus et reconnus partagent forcément. D'ailleurs, réaliser que la conscience était absente de nibbana, c'est contradictoire puisque ça signifierait qu'on était conscient de ne plus avoir conscience.
Pour conclure, je pense que toute la difficulté réside dans l'indicible, ce que l'on ne peut pas dire non parce que ça correspondrait à une absence de conscience mais tout simplement parce que le langage ne peut rendre que les idées, les sensations, les perceptions, etc. qu'il n'a jamais recontrées.
Enfin, nous en saurons davantage une fois l'éveil réalisé. Au passage, dans d'autres traditions bouddhiste, le nibbana n'est pas la fin ultime puisqu'il ne confère pas l'omnipotence et l'omniscience, deux notions qui doivent être difficile à acquérir si la conscience est absente.
Bon WE !
_________________
Comme une mère protègerait son unique enfant au risque de sa propre vie, cultivons un amour sans limite envers tous les êtres. |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Istiqama

Inscrit le: 01 Fév 2010
Messages: 86
|
 Posté le: Ven 26 Mar, 2010 22:32 Sujet du message: Posté le: Ven 26 Mar, 2010 22:32 Sujet du message: |
 |
|
Corrections : bien sûr, il n'y a aps de "s" à foi mais surtout dans la phrase : le langage ne peut rendre que les idées, les sensations, les perceptions, etc. qu'il n'a jamais recontrées
je voulais dire "qu'il a déjà rencontrées".
Avec toutes mes excuses.
_________________
Comme une mère protègerait son unique enfant au risque de sa propre vie, cultivons un amour sans limite envers tous les êtres. |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Adrien

Inscrit le: 31 Aoû 2008
Messages: 205
Localisation: Toulouse
|
 Posté le: Ven 26 Mar, 2010 23:01 Sujet du message: Posté le: Ven 26 Mar, 2010 23:01 Sujet du message: |
 |
|
Si tu veux corriger un message, tu peux cliquer en haut à droite de ton post, sur le bouton "éditer".
Pour le reste, je ne saurais que difficilement t'aider, car je suis assez d'accord avec toi, certaines choses sont souvent mal ou pas assez expliquées dans les livres (notamment à propos de la coproduction conditionnée). On lit une explication, et certaines questions s'élèvent en nous sans que le texte n'apporte de réponse.
| Citation: | | Je suis d'accord avec la déclaration "L'homme n'est ni être, ni non-être : il est une série, c'est-à-dire un enchainement de causes et d'effets" mais le raisonnement ne va pas jusqu'au bout, à mon sens. Il reste à expliquer la mémoire et à trouver ce qui fait le lien entre les différents éléments de la "série". Un collier de perles est bien composé de perles placées les unes à côté des autres mais il y a un fil, un fil conducteur, qui les relie. |
Un tout petit problème avec cette analogie : les perles sont côte à côte dans l'espace, tandis que la série qui constitue l'homme est côte à côte dans le temps. Ce qui est le fil pour les perles dans l'espace, est la causalité pour les évènements dans le temps. Donc, "ce qui fait le lien", c'est tout simplement les lois de la nature (les lois du dhamma).
| Citation: | | D'ailleurs, réaliser que la conscience était absente de nibbana, c'est contradictoire puisque ça signifierait qu'on était conscient de ne plus avoir conscience. |
Je ne connais pas très bien ce sujet, mais j'ai déjà lu deux réponses (contradictoires entre elles, et je ne sais pas quelle est la bonne) :
- Il y a une conscience supra-mondaine, et on peut dire que la conscience ordinaire est totalement absente.
- Il n'y a rien, et c'est seulement en sortant de nibbana qu'on arrive à constater que tout a cessé pendant un instant.
Peut-être que la réponse est encore ailleurs (mais là j'ai la flemme de chercher).
| Citation: | | Au passage, dans d'autres traditions bouddhiste, le nibbana n'est pas la fin ultime puisqu'il ne confère pas l'omnipotence et l'omniscience, deux notions qui doivent être difficile à acquérir si la conscience est absente. |
Pour nous, la conscience n'est absente (ou pas ?) seulement pendant l'absorption méditative dans nibbana. Une fois qu'on sort de la méditation, la conscience redevient présente. |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Pieru
Web

Inscrit le: 17 Jan 2007
Messages: 256
Localisation: France sud
|
 Posté le: Ven 26 Mar, 2010 23:34 Sujet du message: Posté le: Ven 26 Mar, 2010 23:34 Sujet du message: |
 |
|
Bonsoir,
| Citation: | | je ne suis toujours pas satisfait |
Ca c'est le propre de dukkha ! 
Tu évoques la volition, en demandant qui veut.
Et tu demandes où se trouve la mémoire...
Peut être que la volition a sa propre dynamique qui s'applique à différent objet, ou support.
Bouddha énonce la volition comme un constituant des êtres humains, mais peut être que cela ne t'aide pas non plus.
La mémoire d'un évènement peut être inscrite dans la trame du temps...?
Et on peut se demander où est la conscience quand on dort. Est-elle toujours ce continuum?
Quand à l'absence de conscience durant nibbana, c'est vrai que l'expérience est décrite ainsi, mais comme dit Istiqama, c'est aussi parce que nous n'avons pas les mots adéquats. Attention aussi à l'association qui est vite faite entre absence de conscience = néant.
En tout cas, j'ai bien aimé ton explication Chaosophe.
Amicalement
_________________
"Qui connait la nature connait le Dhamma". |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Istiqama

Inscrit le: 01 Fév 2010
Messages: 86
|
 Posté le: Sam 27 Mar, 2010 10:18 Sujet du message: Posté le: Sam 27 Mar, 2010 10:18 Sujet du message: |
 |
|
D'abord, merci à tous de me faire part - ainsi qu'à tous les lecteurs du forum - de vos réflexions sur le sujet. Du point de vue intellectuel, c'est en triturant un sujet dans tous les sens, en le regardant sous les angles les plus improbables qu'on finit par voir jaillir une petite lueur de compréhension ou, au moins, d'intuition.
Pour l'instant, je suis toujours dans la phase d'insatisfaction, dukkha. Et les enseignements nous indiquent que l'ignorance en est l'une des causes, sachant que lorsque la vue, l'explication juste est présentée, elle dissipe forcément et de facto cette insatisfaction.
Je ne vais pas revenir sur mes interrogations, l'essentiel ayant été dit et, par ailleurs, j'ai bien du mal à résumer en quelques lignes la totalité de mon ressenti à ce propos. Ca mériterait un séminaire de plusieurs jours.
Pour moi, il reste à élucider la question de la mémoire et de la conscience. Surtout pour cette dernière, par la pratique, je m'aperçois bien que la "conscience" est comme une juxtaposition d'instants. Ca appelle troisremarques.
D'abord, qu'est-ce qui relie ces instants ? Ensuite, la conséquence de cette observation implique que le passé et l'avenir n'ont pas de valeur intrasèque.
Mais d'un autre côté, on comprend vite que chaque instant peut être divisé, en fonction de la perception qui s'affine, en d'autres instants de plus en plus petits, ce qui a pour conséquence de rendre le présent insaisissable, voire inexistant.
Pour finir, tout cela me ramène à réflechir sur le Bhaddekaratta Sutta :
En regardant profondément la vie telle qu'elle est
Dans l'ici et maintenant
Le pratiquant demeure
dans la stabilité et la liberté
Ceci est assimilé à la Pleine Conscience. Et effectivement, dans la pratique, on ressent bien cet état dans lequel il semble qu'il n'y ait plus de temps mais seulement une "conscience" qui accompagne ce qui se passe au lieu d'être en permanence en décalage avec l'instant présent..
Je laisserai donc tout ça décanter je ne sais où dans mon "esprit" et j'y reviendrai dans quelques années ou quelques dizaines d'années !
Encore une fois, merci à tous
_________________
Comme une mère protègerait son unique enfant au risque de sa propre vie, cultivons un amour sans limite envers tous les êtres. |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Chaosophe
Inscrit le: 13 Avr 2008
Messages: 125
|
 Posté le: Ven 30 Avr, 2010 1:14 Sujet du message: Posté le: Ven 30 Avr, 2010 1:14 Sujet du message: |
 |
|
Puisque c'est le ressenti qui vous intéresse, non l’aspect intellectuel, j’essaierai d’aborder les problèmes que vous soulevez d’un point de vue concret, notamment à l’aide d’exemples simples, même s’il s’agit de questions relativement complexes.
| Citation: | | « C'est justement parce qu'il y a la loi du kamma qu'il n'y a pas de soi , ça demande des explications dans la mesure où, pour moi, le kamma résulte de la volition ». |
L’explication est que c'est précisément parce que les choses apparaissent qu’elles n’existent pas vraiment ! C'est justement parce qu’elles arrivent ou se produisent qu’elles ne sont pas réelles ! Si les choses existaient réellement, elles n’apparaitraient pas et ne se produiraient pas ! Car si elles existaient vraiment, c'est-à-dire par elles-mêmes, elles ne dépendraient pas de causes et de conditions : donc elles ne se produiraient pas et n’apparaitraient pas. En effet, une chose qui existe réellement doit exister par elle-même (j'y reviendrai) ; et il est contradictoire qu’une chose existe par elle-même et dépende de circonstances : c'est soit l’un, soit l’autre qui est vrai.
Dans le cas de l’homme, cela veut dire que c'est justement parce que je produis des actes par mes intentions que je n’existe pas réellement. Voilà comment je l’expliquerai rapidement, d’un point de vue qui n’est pas le plus répandu parmi les textes : je n’existe qu’en produisant des intentions, et je meurs dès que je cesse d’en produire (par exemple si je cesse de vouloir manger, ou dormir, ou respirer, etc.). Donc je n’existe qu’en dépendance de ces intentions, et non pas réellement, par moi-même, indépendamment d’elles. (Notons que « intention » ne désigne pas seulement, dans le bouddhisme, la volonté consciente, mais tout les actes mentaux qui, étant imprégnés de désir, produisent des résultats bons ou mauvais).
Une autre manière de comprendre en quoi les intentions prouvent l’absence de moi, c'est de se dire que ce sont les intentions ou le désir qui relient les différents instants d’une existence. En effet, c'est le désir présent (par exemple celui de manger une glace) qui produit l’instant suivant (durant lequel je mange ma glace). Donc ce qui perpétue notre vie, ce sont des actes et des processus (les intentions), et non pas des êtres ou des réalités substantielles. Traditionnellement, "acte" ou "processus" s'opposent à "être" ou "existence substantielle" : l'un est considéré comme dynamique, fugace et manifeste, l'autre comme statique, permanent et caché.
| Citation: | | « qui dit volition, dit quelqu'un ou quelque chose, je ne sais pas, qui veut » |
Pourquoi toute action impliquerait-elle un agent ? Vous semblez croire que, là où se déroule une action, un agent doit exister ; que là un processus ou un effet est produit (comme la volition), alors il doit y avoir un être, c'est-à-dire qu’une réalité une et autonome. Mais cela est loin d’être évident ! Rien n’oblige qu’une action suppose un agent. Lorsque nous disons par exemple que « le tonnerre gronde », qu’est-ce qui gronde ? Qu’est-ce qui gronde, à part le tonnerre, donc le grondement lui-même ?! Le tonnerre ne gronde pas : le tonnerre est un grondement. Il n’est pas un agent distinct d’un effet, qui serait le grondement, mais sa réalité consiste uniquement dans cet effet. De même, les éclairs n’illuminent pas : les éclairs sont de la lumière ! Et pensez-vous que la lumière soit un être distinct de son effet éclairant ? Pouvez-vous imaginer une lumière qui n’éclaire pas en quelque façon ? (Même la "lumière noire" éclaire certains objets !). Pourquoi dans ce cas croire que la lumière, ou le grondement du tonnerre, est un être distinct de son effet, un agent différent de son action ? Cette croyance est un préjugé, c'est-à-dire un présupposé inaperçu (et c'est parce qu’on ne l’aperçoit pas qu’on ne le remet pas en cause). Ce préjugé, que certains qualifient de « fétichiste », et consistant à croire que tout acte implique un être agissant, repose lui-même sur un autre préjugé, plus tenace : la croyance que l’action et sa cause sont deux choses différentes, deux entités distinctes. Il s’agit du préjugé "dualiste", selon lequel l’acte est différent de l’agent, que la cause et l'effet représentent deux réalités distinctes et indépendantes.
Voici un autre exemple : la force n’est pas un être distinct de ses effets (accélérations, gravitation, etc.) : la force est l’ensemble de ses effets. Pour la science actuelle, l’électricité n’est pas une réalité cachée derrière des manifestations dont elle serait la cause : le courant électrique n’est que l’ensemble des actions physico-chimiques qui le manifestent (incandescence d’un filament de carbone, électrolyses, etc.). Pour le bouddhisme, comme pour la science et la philosophie modernes, une chose se réduit à la série des apparitions qui la manifestent. Les préjugés fétichistes et dualistes produisent des difficultés insurmontables, qu'il est pas ici le lieu d'exposer, mais qu'on peut résumer ainsi : le "quelqu'un ou quelque chose" dont vous parlez est introuvable ! Lorsque l'on suppose qu'un être, ou une personne sont à l'origine d'un acte mental, on les envisage comme une "faculté" ou un "moi" psychologiques, donc comme un pouvoir distinct de son exercice, un agent différent de son action, une cause séparée de son effet, une essence distincte de son existence. Mais qu'est-ce qu'un pouvoir sans son exercice ? Qu'est-ce qu'une cause sans effet, ou un agent sans son action ? En quoi s'agit-il encore d'un pouvoir, d'une cause, d'un agent ? Si je dis que j'ai le pouvoir de marcher, mais que je n'ai encore jamais marché, ne marche pas actuellement, et ne marcherai peut-être jamais, rien n'autorise à dire que je possède vraiment ce pouvoir. Certes, c'est le corps qui marche ; mais il n'est "agent" de marche que au moment où il marche, et dans cette mesure seulement. En fait l'idée de pouvoir ou d'agent revient à postuler l'existence d'une chose mystérieuse, inconnue et inobservable, qui n'explique rien : c'est comme dire que l'opium endort grâce à sa "faculté dormitive", comme l'écrivait Molière, ou que qu'un couteau coupe grâce à son "pouvoir coupant"...
Il semble que la grammaire soit à l’origine de la croyance au « moi » ou au « soi » : n’est-ce pas elle qui exige un agent derrière toute action ? L’Etat enseigne donc dès la primaire cette croyance à l’origine de la souffrance !
| Citation: | | Or, qui dit volition, dit quelqu'un ou quelque chose, je ne sais pas, qui veut. Peut-être la conscience, non? Parce qu'après tout, la conscience est un continuum... Que les choses et les êtres n'aient pas d'existence indépendante, c'est possible mais les choses et les êtres ont des propriétés que nous pouvons expérimenter, ce qui signifie qu'elles et ils ont une certaine "réalité" (relativisée, bien entendu, par l'interdépendance, etc.) |
Lorsque vous dites que "les êtres ont des propriétés", vous considérer ces êtres comme des réalités distinctes de ce qu’elles possèdent : or elles ne peuvent exister sans propriété ! A-t-on déjà vu une chaise sans couleur, sans matière, sans poids ni volume ? Le problème concerne sans doute ce que l’on entend par « réalité ». Lorsque le Bouddha enseigne anatta, il ne veut pas dire que les choses n’existent absolument pas, et que tout est illusion : il veut seulement dire que les choses n’existent pas vraiment ou réellement, c'est-à-dire par elles-mêmes, en vertu de leur propre nature, de façon autonome et isolée, indépendamment de causes et de conditions. Or d’habitude, lorsque nous disons qu’une chose est réelle, existe réellement ou vraiment, et n’est pas une illusion, une pure apparence sans fondement, nous voulons dire que cette chose existe de façon indépendante. La plupart des gens, lorsqu’ils parlent de « réalité », entendent par ce terme un mode d’existence indépendant. Par exemple, nous ne disons pas qu’un arc-en-ciel ou un mirage sont des êtres réels, parce qu’ils n’apparaissent que lorsque certaines conditions (météorologiques, etc.) sont réunies, et c'est précisément cette dépendance, cette absence d’autonomie, qui nous fait dire qu’il s’agit d’illusions ou d’apparence, et non de réalité. De même, chacun reconnaitra sans beaucoup de difficultés qu’une vague n’existe pas réellement, mais que seul l’océan est réel, car l’existence de la vague dépend de celle de l’océan, dont elle n'est qu'un aspect (alors qu’un océan sans vague est possible). La vague est vide de « soi », mais elle est pleine d’eau, c'est-à-dire qu’elle apparait vraiment, ou réellement, elle se manifeste effectivement, il y a bien apparence ; on peut même se noyer en elle. En d’autres termes, il ne faut pas opposer apparence et réalité, pas plus que action et agent, ou effet et cause : « la réalité, c'est l’apparence », a dit un sage. En fait, cette opposition est abstraite, théorique, elle a été inventée par des philosophes !
Que veut dire une « "réalité" (relativisée, bien entendu, par l'interdépendance) » ? Cela veut-il dire une réalité pas très réelle ? Un être qui n’existe pas totalement ? - Les choses que nous tenons pour existantes n’ont qu’une réalité de phénomène, c'est-à-dire qu’elles apparaissent, elles se manifestent (« phénomène » veut dire : « qui apparait »). Les choses « existent » au sens où elles se manifestent ; mais elles n’existent pas vraiment, pas réellement, c'est-à-dire qu’elles n’existent ou ne se manifestent pas par elles-mêmes, de leur propre chef, du fait d’un pouvoir qui leur serait propre (au contraire, chacune n’existe que grâce aux autres).
A la limite, les propriétés dont vous parlez « existent », mais pas les choses qui, d’après vous, « ont » ces propriétés. Encore faut-il ajouter que ces propriétés existent au sens où elles apparaissent et se produisent, mais qu’elles n’existent pas réellement, c'est-à-dire en vertu d’une nature propre. Tout dépend donc de ce que vous entendez par « existence » ou « réalité » : la doctrine d’anatta vise à trouver un juste milieu entre le néant (le rien absolu), et l’être en soi (l’existence réelle, en vertu d’une nature propre). Si vous comprenez qu’aucune chose et aucun agent réel ne cache derrière les propriétés et les actions qui apparaissent ou se produisent, et que ces propriétés ou actions elles-mêmes n’ont aucune réalité substantielle ou essentielle, alors vous comprenez anatta (sous son aspect théorique). Il faut seulement se souvenir que cette doctrine est une critique de la manière de penser habituelle (parmi le peuple et les philosophes), pour laquelle « réalité » ne signifie pas seulement « apparaitre » ou « se produire », mais également « exister de façon indépendante », par soi-même. En effet, on oppose traditionnellement la réalité à l’apparence, l’existence à l’apparition, l’être à la manifestation, la vérité à l’illusion, l'essence à l'existence, etc. Vous pouvez conserver le terme de « réalité » dans le contexte de l’interdépendance, si vous restreignez son sens à celui d’apparition ou production, et si vous comprenez que l’apparence elle-même (ou le devenir, la causalité, etc.) n’existe pas vraiment, ne relève pas de « l’être » au sens habituel. Donc il y a apparence, il y a des choses qui se manifestent, mais ni ces choses, ni leurs propriétés, ni cette apparition elle-même ne sont réelles au sens ordinaire, et ne relèvent pas de "l'être". Elles ne sont pas réelles, si on entend par "réalité" le fait de posséder une existence durable et indépendante d'une conscience ; mais elles sont réelles, si on entend par "réalité" le fait d'apparaitre de façon transitoire et en dépendance d'une conscience.
Une chose importante me semble de comprendre que les prétendues "choses" n'existent pas en dehors de la conscience que nous avons d'elle, et en particulier du nom que nous leur donnons. Les mots créent les choses ! Par exemple, mon vélo a bel et bien été causé, produit, et il m’apparait ; mais il n’existe pas vraiment, indépendamment de ma conscience, en dehors du fait que je l’observe. Car si aucune conscience n’est là pour l’observer, alors rien n’en fait une chose une (UN vélo) : il n'y a qu’un ensemble de parties et de propriétés (deux roues, un guidon, etc.) juxtaposées les unes aux autres, que seul le terme « vélo » regroupe pour en faire un tout unitaire. Combiner ensemble plusieurs éléments n'a jamais produit une chose véritablement une : l'unité véritable exigerait l'indivisibilité parfaite, l'absence de parties, donc l'absence de volume (seul le point mathématique, c'est-à-dire presque rien, serait réel !). Comme nous allons le voir, toute chose composée n'est qu'un nom attribué à des parties, lesquelles ne sont qu'un nom pour leurs propres éléments, et aucune n'a d'existence véritable.
| Citation: | | Je suis d'accord avec la déclaration "L'homme n'est ni être, ni non-être : il est une série, c'est-à-dire un enchainement de causes et d'effets" mais le raisonnement ne va pas jusqu'au bout, à mon sens. Il reste à expliquer la mémoire et à trouver ce qui fait le lien entre les différents éléments de la "série". Un collier de perles est bien composé de perles placées les unes à côté des autres mais il y a un fil, un fil conducteur, qui les relie. |
Pourquoi supposer que, lorsqu’une chose semble durer, il existe « une chose » qui « fait le lien » entre les instants de son existence ? Pourquoi les instants supposeraient-ils nécessairement un être qui les relie ? N’est-ce pas le même préjugé que précédemment ? Certes, dans l’exemple du collier, il y a un tel agent de liaison : mais ignorez-vous qu’un fil n’est constitué que de fibres courtes, dont aucune n’est aussi longue que le fil, lequel est donc dépourvu d’agent de liaison ? Le fil n’est qu’un ensemble de fibres, qui ne sont pas reliées entre elles par quelque chose d’autre. Le fil est lui-même comme… un collier de perles dépourvu de fil ! En fait, aucun ensemble et aucune composition n’implique de continuité, de liaison ou de « fil conducteur ». Une corde n’est qu’un ensemble de ficelles, donc n’est pas une chose, mais plusieurs choses (pourtant, nous disons « UNE corde », parce que nous aimons tout simplifier). De même, mon vélo n’est qu’un ensemble de roues, guidon, etc., mais en dehors de ses éléments, il n'y en a aucun autre qui les relierait tous ensemble. Pourquoi donc ne pas considérer qu’il en va de même pour les choses composées non pas de parties matérielles ou spatiales, mais de parties temporelles, c'est-à-dire d’instants, comme la conscience ? Ne peut-on pas considérer, au contraire, que chaque état de conscience produit l’état suivant, et disparait lorsque celui-ci apparait, en sorte qu’il n'y a aucun état continu ? Pourriez-vous me citer ne serait-ce qu’un seul état de conscience permanent durant votre vie ? De quelle sensation, émotion ou idée s’agirait-il ? Encore une fois, les mots nous font croire à l’existence des choses : car c'est le mot « continuum » qui fait croire que la conscience contient un élément qui existe de façon continue. Si j’emploie le mot « série », c'est principalement par opposition à celui de « continuum », qui fait croire à des illusions. Il ne faut donc pas s’imaginer l’esprit ou la conscience comme un théâtre dans lequel se succéderaient ces personnages que seraient les idées, sensations et sentiments : la conscience n’est pas différente, en un sens, des contenus qui "l’habitent". Qu'est-ce en effet qu'une conscience sans objet ? Nous y reviendrons...
La mémoire n’exige pas du tout qu’une chose existe de façon permanente dans la conscience. Prenons d'abord exemple sur le corps: si j’ai une cicatrice sur le bras, 10 ans après la cicatrice demeure, alors que toutes les cellules de ma peau, ainsi que les molécules composant ces cellules, ont été entièrement renouvelées. Ce qui se conserve, dans ce cas, n’est pas une chose réelle, mais seulement une forme, une empreinte. Diriez-vous qu’une empreinte, comme celle d’un sceau dans de la cire, existe réellement, par elle-même ? Pourquoi ne pas imaginer qu’il en va de la mémoire de l’esprit comme de la mémoire du corps : un souvenir n’est pas un état de conscience qui dure dans la conscience pendant des années ; c'est une marque (une sorte de cicatrice) produite sur l’esprit par un événement, et reproduite à chaque instant de conscience (ou reproduite seulement à l’instant où l’on se rappelle, peu importe). Des instants de conscience toujours nouevaux reproduisent un contenu ancien : ce contenu semble une réalité véritable, conservée de façon durable, mais il n'est que de l'information, sans cesse reproduite.
| Citation: | | Quant à nibbana [...] dire que c'est la fin de la conscience... il me semble que ce n'est pas une analyse que tous les maîtres connus et reconnus partagent forcément. |
Nibbâna n’est-il pas « la fin des agrégats », comme les textes le répètent inlassablement ? Et la conscience n’est-elle pas un agrégat ? Donc Nibbâna est la fin de la conscience. CQFD.
| Citation: | « Là où le nom et la forme sont arrêtés sans trace : C'est avec la cessation de la conscience qu'ils sont amenés à s'arrêter » (SN V.1. Ajita-manava-puccha)
« Là où n’existe aucun intellect, aucune idée, aucune sphère de la conscience du contact avec l'intellect : là, Malin, tu ne peux aller » (SN IV.19). |
| Citation: | | « Réaliser que la conscience était absente de nibbana, c'est contradictoire puisque ça signifierait qu'on était conscient de ne plus avoir conscience » |
.
C'est pourquoi les textes disent que celui qui atteint Nibbâna ne s’en aperçoit pas immédiatement, mais seulement par après. Voici comment cela se produit, schématiquement : sur le chemin de l'Eveil, la conscience se détourne des réalités conditionnées et changeantes, dont elle perçoit le caractère insatisfaisant, et l'absence de réalité ; ces réalités disparaissent donc à ces yeux ; puisque la conscience n'a plus d'objet, elle disparait ; comme elle a pourtant l'habitude de se projeter vers un objet, elle réapparait ; puisqu'il n'y a alors aucun objet à connaitre, elle prend cette absence d'objet elle-même pour objet ; mais parce qu'il n'y a alors rien de déterminé (aucun objet) à connaître, elle n'y parvient que quelques instants ; elle peut ensuite prendre de nouveau les réalités conditionnées pour objet, ou s'entraîner à connaître Nibbâna de façon plus durable. Pour mieux comprendre tout cela, je vous invite à lire ce qui est dit de Nibbâna sur dhammadana.org. Le site montre très bien comment cet aspect (l’absence de conscience) distingue le bouddhisme des religions et des philosophies.
| Citation: | « …J'ai déjà lu deux réponses (contradictoires entre elles, et je ne sais pas quelle est la bonne) :
- Il y a une conscience supra-mondaine, et on peut dire que la conscience ordinaire est totalement absente.
- Il n'y a rien, et c'est seulement en sortant de nibbana qu'on arrive à constater que tout a cessé pendant un instant ». |
Sur ce sujet, je vous renvoie à ce post : http://forumetta.free.fr/viewtopic.php?t=496&highlight=anidassanam. Je reproduis ici de façon simplifiée ce que j'avais déjà écrit. C'est bien de Nibbâna qu'il s'agit lorsque le Bouddha déclare :
| Citation: |
« Conscience sans surface (viññanam anidassanam : « sans caractéristiques », ou « sans distinctions »), sans fin, lumineuse tout autour, n’a pas été expérimentée à travers [...] la totalité du tout » (MN 49). |
Le "tout" désigne les sens et leurs objets, qui constituent la "surface" à travers laquelle la conscience ordinaire est expérimentée (on expérimente la conscience visuelle à cause de l’œil et de la forme dont on est conscient). Au contraire, la "conscience sans surface" est connue directement, sans intermédiaire, non pas comme un objet, au moyen d'organes corporel : elle est en dehors du « tout », c'est-à-dire en dehors de l’espace et du temps, en une dimension où il n’y a pas d’ici, de là, ou d’entre-deux (Ud I, 10), ni allée, ni venue, ni séjour (Ud VIII.1). On ne peut donc pas dire qu'elle soit permanente ou omniprésente (termes qui n’ont de sens que dans l’espace-temps). Cette conscience est synonyme du Nibbana lui-même : les textes la décrivent comme telle, par exemple, comme le lieu où les phénomènes physiques et mentaux trouvent leur fin (DN 11) ; comme Nibbâna, elle est connue sans médiation. Les textes la comparent à une lumière qui ne se pose nulle part, parce qu’elle ne rencontre aucun obstacle : de même « lorsqu’il n’y a pas de plaisir, de soif, alors la conscience ne s’établit pas ici ni ne croît" et la souffrance disparait (SN XII. 64). Autrement dit, lorsque la conscience cesse de se projeter vers des objets, comme une lumière ne se projetant sur aucune chose, c'est la fin de la souffrance, donc Nibbâna.
En définitive, il faut distinguer Nibbâna de la conscience qui le connait. Celle-ci est la conscience ordinaire, qui figure parmi les agrégats ; tandis que Nibbâna lui-même est comparé (non identique à) une conscience immédiate et lumineuse.
| Citation: | « La "conscience" est comme une juxtaposition d'instants [...]. Qu'est-ce qui relie ces instants ? Ensuite, la conséquence de cette observation implique que le passé et l'avenir n'ont pas de valeur intrasèque.
Mais d'un autre côté, on comprend vite que chaque instant peut être divisé, en fonction de la perception qui s'affine, en d'autres instants de plus en plus petits, ce qui a pour conséquence de rendre le présent insaisissable, voire inexistant ». |
Là, je ne suis pas sûr de vous suivre ; vous voulez peut-être dire que, si la conscience n’est composée que d’instants juxtaposés, le temps semble perdre toute sa réalité. Et, de fait, le passé et l’avenir n’existent plus, ou pas encore, tandis que le présent ne cesse de passer, sans s’arrêter : aucun des 3 ne semble véritablement exister. Mais tout le message du Bouddha est précisément que le temps est une création de l’esprit ! Et Nibbâna est justement la fin du temps (voire ce post : http://forumetta.free.fr/viewtopic.php?t=729).
| Citation: | | « Dans la pratique, on ressent bien cet état dans lequel il semble qu'il n'y ait plus de temps mais seulement une "conscience" qui accompagne ce qui se passe au lieu d'être en permanence en décalage avec l'instant présent ». |
Le mieux est lorsque disparait la séparation entre la conscience et « ce qui se passe ». Alors sujet et objet ne s’opposent plus, l’impression d’être un témoin cesse, et seule reste la réalité. |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Chaosophe
Inscrit le: 13 Avr 2008
Messages: 125
|
 Posté le: Ven 30 Avr, 2010 13:24 Sujet du message: Posté le: Ven 30 Avr, 2010 13:24 Sujet du message: |
 |
|
Puisque c'est le ressenti qui vous intéresse, non l’aspect intellectuel, j’essaierai d’aborder les problèmes que vous soulevez d’un point de vue concret, notamment à l’aide d’exemples simples, même s’il s’agit de questions relativement complexes.
| Citation: | | « C'est justement parce qu'il y a la loi du kamma qu'il n'y a pas de soi , ça demande des explications dans la mesure où, pour moi, le kamma résulte de la volition ». |
Je ne reviendrai pas sur l'idée selon laquelle c'est précisément parce que les choses apparaissent ou se produisent qu’elles n’existent pas vraiment. Sur cette question, il faut seulement retenir que, si les choses existaient réellement, c'est-à-dire par elles-mêmes, de façon indépendante, elles ne dépendraient pas de causes et de conditions, donc ne pourraient apparaitre...
Dans le cas de l’homme, cela signifie que c'est justement parce que je produis des actes par mes intentions que je n’existe pas réellement. Une manière de comprendre cela est de se dire que ce sont les intentions ou le désir qui relient les différents instants d’une existence. En effet, c'est le désir présent (par exemple celui de manger une glace) qui produit l’instant suivant (durant lequel je mange ma glace). Donc ce qui perpétue notre vie, ce sont des actes et des processus (les intentions), et non pas des êtres ou des réalités substantielles. (Traditionnellement, "acte" ou "processus" s'opposent à "être" ou "existence substantielle" : l'un est considéré comme dynamique, fugace et manifeste, l'autre comme statique, permanent et caché).
| Citation: | | « qui dit volition, dit quelqu'un ou quelque chose, je ne sais pas, qui veut » |
Pourquoi toute action impliquerait-elle un agent ? Vous semblez croire que, là où se déroule une action, un agent doit exister ; que là un processus ou un effet est produit (comme la volition), alors il doit y avoir un être, c'est-à-dire qu’une réalité une et autonome. Mais cela est loin d’être évident ! Rien n’oblige qu’une action suppose un agent. Lorsque nous disons par exemple que « le tonnerre gronde », qu’est-ce qui gronde ? Qu’est-ce qui gronde, à part le tonnerre, donc le grondement lui-même ?! Le tonnerre ne gronde pas : le tonnerre est un grondement. Il n’est pas un agent distinct d’un effet, qui serait le grondement, mais sa réalité consiste uniquement dans cet effet. De même, les éclairs n’illuminent pas : les éclairs sont de la lumière ! Et pensez-vous que la lumière soit un être distinct de son effet éclairant ? Pouvez-vous imaginer une lumière qui n’éclaire pas en quelque façon ? (Même la "lumière noire" éclaire certains objets !). Pourquoi dans ce cas croire que la lumière, ou le grondement du tonnerre, est un être distinct de son effet, un agent différent de son action ? Cette croyance est un préjugé, c'est-à-dire un présupposé inaperçu (et c'est parce qu’on ne l’aperçoit pas qu’on ne le remet pas en cause). Ce préjugé, que certains qualifient de « fétichiste », et consistant à croire que tout acte implique un être agissant, repose lui-même sur un autre préjugé, plus tenace : la croyance que l’action et sa cause sont deux choses différentes, deux entités distinctes. Il s’agit du préjugé "dualiste", selon lequel l’acte est différent de l’agent, que la cause et l'effet représentent deux réalités distinctes et indépendantes.
Voici un autre exemple : la force n’est pas un être distinct de ses effets (accélérations, gravitation, etc.) : la force est l’ensemble de ses effets. Pour la science actuelle, l’électricité n’est pas une réalité cachée derrière des manifestations dont elle serait la cause : le courant électrique n’est que l’ensemble des actions physico-chimiques qui le manifestent (incandescence d’un filament de carbone, électrolyses, etc.). Pour le bouddhisme, comme pour la science et la philosophie modernes, une chose se réduit à la série des apparitions qui la manifestent. Les préjugés fétichistes et dualistes produisent des difficultés insurmontables, qu'il est pas ici le lieu d'exposer, mais qu'on peut résumer ainsi : le "quelqu'un ou quelque chose" dont vous parlez est introuvable ! Lorsque l'on suppose qu'un être, ou une personne sont à l'origine d'un acte mental, on les envisage comme une "faculté" ou un "moi" psychologiques, donc comme un pouvoir distinct de son exercice, un agent différent de son action, une cause séparée de son effet, une essence distincte de son existence. Mais qu'est-ce qu'un pouvoir sans son exercice ? Qu'est-ce qu'une cause sans effet, ou un agent sans son action ? En quoi s'agit-il encore d'un pouvoir, d'une cause, d'un agent ? Si je dis que j'ai le pouvoir de marcher, mais que je n'ai encore jamais marché, ne marche pas actuellement, et ne marcherai peut-être jamais, rien n'autorise à dire que je possède vraiment ce pouvoir. Certes, c'est le corps qui marche ; mais il n'est "agent" de marche que au moment où il marche, et dans cette mesure seulement. En fait l'idée de pouvoir ou d'agent revient à postuler l'existence d'une chose mystérieuse, inconnue et inobservable, qui n'explique rien : c'est comme dire que l'opium endort grâce à sa "faculté dormitive", comme l'écrivait Molière, ou que qu'un couteau coupe grâce à son "pouvoir coupant"...
Il semble que la grammaire soit à l’origine de la croyance au « moi » ou au « soi » : n’est-ce pas elle qui exige un agent derrière toute action ? L’Etat enseigne donc dès la primaire cette croyance à l’origine de la souffrance !
| Citation: | | Or, qui dit volition, dit quelqu'un ou quelque chose, je ne sais pas, qui veut. Peut-être la conscience, non? Parce qu'après tout, la conscience est un continuum... Que les choses et les êtres n'aient pas d'existence indépendante, c'est possible mais les choses et les êtres ont des propriétés que nous pouvons expérimenter, ce qui signifie qu'elles et ils ont une certaine "réalité" (relativisée, bien entendu, par l'interdépendance, etc.) |
Lorsque vous dites que "les êtres ont des propriétés", vous considérer ces êtres comme des réalités distinctes de ce qu’elles possèdent : or elles ne peuvent exister sans propriété ! A-t-on déjà vu une chaise sans couleur, sans matière, sans poids ni volume ? Le problème concerne sans doute ce que l’on entend par « réalité ». Lorsque le Bouddha enseigne anatta, il ne veut pas dire que les choses n’existent absolument pas, et que tout est illusion : il veut seulement dire que les choses n’existent pas vraiment ou réellement, c'est-à-dire par elles-mêmes, en vertu de leur propre nature, de façon autonome et isolée, indépendamment de causes et de conditions. Or d’habitude, lorsque nous disons qu’une chose est réelle, existe réellement ou vraiment, et n’est pas une illusion, une pure apparence sans fondement, nous voulons dire que cette chose existe de façon indépendante. La plupart des gens, lorsqu’ils parlent de « réalité », entendent par ce terme un mode d’existence indépendant. Par exemple, nous ne disons pas qu’un arc-en-ciel ou un mirage sont des êtres réels, parce qu’ils n’apparaissent que lorsque certaines conditions (météorologiques, etc.) sont réunies, et c'est précisément cette dépendance, cette absence d’autonomie, qui nous fait dire qu’il s’agit d’illusions ou d’apparence, et non de réalité. De même, chacun reconnaitra sans beaucoup de difficultés qu’une vague n’existe pas réellement, mais que seul l’océan est réel, car l’existence de la vague dépend de celle de l’océan, dont elle n'est qu'un aspect (alors qu’un océan sans vague est possible). La vague est vide de « soi », mais elle est pleine d’eau, c'est-à-dire qu’elle apparait vraiment, ou réellement, elle se manifeste effectivement, il y a bien apparence ; on peut même se noyer en elle. En d’autres termes, il ne faut pas opposer apparence et réalité, pas plus que action et agent, ou effet et cause : « la réalité, c'est l’apparence », a dit un sage. En fait, cette opposition est abstraite, théorique, elle a été inventée par des philosophes !
Que veut dire une « "réalité" (relativisée, bien entendu, par l'interdépendance) » ? Cela veut-il dire une réalité pas très réelle ? Un être qui n’existe pas totalement ? - Les choses que nous tenons pour existantes n’ont qu’une réalité de phénomène, c'est-à-dire qu’elles apparaissent, elles se manifestent (« phénomène » veut dire : « qui apparait »). Les choses « existent » au sens où elles se manifestent ; mais elles n’existent pas vraiment, pas réellement, c'est-à-dire qu’elles n’existent ou ne se manifestent pas par elles-mêmes, de leur propre chef, du fait d’un pouvoir qui leur serait propre (au contraire, chacune n’existe que grâce aux autres).
A la limite, les propriétés dont vous parlez « existent », mais pas les choses qui, d’après vous, « ont » ces propriétés. Encore faut-il ajouter que ces propriétés existent au sens où elles apparaissent et se produisent, mais qu’elles n’existent pas réellement, c'est-à-dire en vertu d’une nature propre. Tout dépend donc de ce que vous entendez par « existence » ou « réalité » : la doctrine d’anatta vise à trouver un juste milieu entre le néant (le rien absolu), et l’être en soi (l’existence réelle, en vertu d’une nature propre). Si vous comprenez qu’aucune chose et aucun agent réel ne cache derrière les propriétés et les actions qui apparaissent ou se produisent, et que ces propriétés ou actions elles-mêmes n’ont aucune réalité substantielle ou essentielle, alors vous comprenez anatta (sous son aspect théorique). Il faut seulement se souvenir que cette doctrine est une critique de la manière de penser habituelle (parmi le peuple et les philosophes), pour laquelle « réalité » ne signifie pas seulement « apparaitre » ou « se produire », mais également « exister de façon indépendante », par soi-même. En effet, on oppose traditionnellement la réalité à l’apparence, l’existence à l’apparition, l’être à la manifestation, la vérité à l’illusion, l'essence à l'existence, etc. Vous pouvez conserver le terme de « réalité » dans le contexte de l’interdépendance, si vous restreignez son sens à celui d’apparition ou production, et si vous comprenez que l’apparence elle-même (ou le devenir, la causalité, etc.) n’existe pas vraiment, ne relève pas de « l’être » au sens habituel. Donc il y a apparence, il y a des choses qui se manifestent, mais ni ces choses, ni leurs propriétés, ni cette apparition elle-même ne sont réelles au sens ordinaire, et ne relèvent pas de "l'être". Elles ne sont pas réelles, si on entend par "réalité" le fait de posséder une existence durable et indépendante d'une conscience ; mais elles sont réelles, si on entend par "réalité" le fait d'apparaitre de façon transitoire et en dépendance d'une conscience.
Une chose importante me semble de comprendre que les prétendues "choses" n'existent pas en dehors de la conscience que nous avons d'elle, et en particulier du nom que nous leur donnons. Les mots créent les choses ! Par exemple, mon vélo a bel et bien été causé, produit, et il m’apparait ; mais il n’existe pas vraiment, indépendamment de ma conscience, en dehors du fait que je l’observe. Car si aucune conscience n’est là pour l’observer, alors rien n’en fait une chose une (UN vélo) : il n'y a qu’un ensemble de parties et de propriétés (deux roues, un guidon, etc.) juxtaposées les unes aux autres, que seul le terme « vélo » regroupe pour en faire un tout unitaire. Combiner ensemble plusieurs éléments n'a jamais produit une chose véritablement une : l'unité véritable exigerait l'indivisibilité parfaite, l'absence de parties, donc l'absence de volume (seul le point mathématique, c'est-à-dire presque rien, serait réel !). Comme nous allons le voir, toute chose composée n'est qu'un nom attribué à des parties, lesquelles ne sont qu'un nom pour leurs propres éléments, et aucune n'a d'existence véritable.
| Citation: | | Je suis d'accord avec la déclaration "L'homme n'est ni être, ni non-être : il est une série, c'est-à-dire un enchainement de causes et d'effets" mais le raisonnement ne va pas jusqu'au bout, à mon sens. Il reste à expliquer la mémoire et à trouver ce qui fait le lien entre les différents éléments de la "série". Un collier de perles est bien composé de perles placées les unes à côté des autres mais il y a un fil, un fil conducteur, qui les relie. |
Pourquoi supposer que, lorsqu’une chose semble durer, il existe « une chose » qui « fait le lien » entre les instants de son existence ? Pourquoi les instants supposeraient-ils nécessairement un être qui les relie ? N’est-ce pas le même préjugé que précédemment ? Certes, dans l’exemple du collier, il y a un tel agent de liaison : mais ignorez-vous qu’un fil n’est constitué que de fibres courtes, dont aucune n’est aussi longue que le fil, lequel est donc dépourvu d’agent de liaison ? Le fil n’est qu’un ensemble de fibres, qui ne sont pas reliées entre elles par quelque chose d’autre. Le fil est lui-même comme… un collier de perles dépourvu de fil ! En fait, aucun ensemble et aucune composition n’implique de continuité, de liaison ou de « fil conducteur ». Une corde n’est qu’un ensemble de ficelles, donc n’est pas une chose, mais plusieurs choses (pourtant, nous disons « UNE corde », parce que nous aimons tout simplifier). De même, mon vélo n’est qu’un ensemble de roues, guidon, etc., mais en dehors de ses éléments, il n'y en a aucun autre qui les relierait tous ensemble. Pourquoi donc ne pas considérer qu’il en va de même pour les choses composées non pas de parties matérielles ou spatiales, mais de parties temporelles, c'est-à-dire d’instants, comme la conscience ? Ne peut-on pas considérer, au contraire, que chaque état de conscience produit l’état suivant, et disparait lorsque celui-ci apparait, en sorte qu’il n'y a aucun état continu ? Pourriez-vous me citer ne serait-ce qu’un seul état de conscience permanent durant votre vie ? De quelle sensation, émotion ou idée s’agirait-il ? Encore une fois, les mots nous font croire à l’existence des choses : car c'est le mot « continuum » qui fait croire que la conscience contient un élément qui existe de façon continue. Si j’emploie le mot « série », c'est principalement par opposition à celui de « continuum », qui fait croire à des illusions. Il ne faut donc pas s’imaginer l’esprit ou la conscience comme un théâtre dans lequel se succéderaient ces personnages que seraient les idées, sensations et sentiments : la conscience n’est pas différente, en un sens, des contenus qui "l’habitent". Qu'est-ce en effet qu'une conscience sans objet ? Nous y reviendrons...
La mémoire n’exige pas du tout qu’une chose existe de façon permanente dans la conscience. Prenons d'abord exemple sur le corps: si j’ai une cicatrice sur le bras, 10 ans après la cicatrice demeure, alors que toutes les cellules de ma peau, ainsi que les molécules composant ces cellules, ont été entièrement renouvelées. Ce qui se conserve, dans ce cas, n’est pas une chose réelle, mais seulement une forme, une empreinte. Diriez-vous qu’une empreinte, comme celle d’un sceau dans de la cire, existe réellement, par elle-même ? Pourquoi ne pas imaginer qu’il en va de la mémoire de l’esprit comme de la mémoire du corps : un souvenir n’est pas un état de conscience qui dure dans la conscience pendant des années ; c'est une marque (une sorte de cicatrice) produite sur l’esprit par un événement, et reproduite à chaque instant de conscience (ou reproduite seulement à l’instant où l’on se rappelle, peu importe). Des instants de conscience toujours nouevaux reproduisent un contenu ancien : ce contenu semble une réalité véritable, conservée de façon durable, mais il n'est que de l'information, sans cesse reproduite.
| Citation: | | Quant à nibbana [...] dire que c'est la fin de la conscience... il me semble que ce n'est pas une analyse que tous les maîtres connus et reconnus partagent forcément. |
Nibbâna n’est-il pas « la fin des agrégats », comme les textes le répètent inlassablement ? Et la conscience n’est-elle pas un agrégat ? Donc Nibbâna est la fin de la conscience. CQFD.
| Citation: | « Là où le nom et la forme sont arrêtés sans trace : C'est avec la cessation de la conscience qu'ils sont amenés à s'arrêter » (SN V.1. Ajita-manava-puccha)
« Là où n’existe aucun intellect, aucune idée, aucune sphère de la conscience du contact avec l'intellect : là, Malin, tu ne peux aller » (SN IV.19). |
| Citation: | | « Réaliser que la conscience était absente de nibbana, c'est contradictoire puisque ça signifierait qu'on était conscient de ne plus avoir conscience » |
.
C'est pourquoi les textes disent que celui qui atteint Nibbâna ne s’en aperçoit pas immédiatement, mais seulement par après. Voici comment cela se produit, schématiquement : sur le chemin de l'Eveil, la conscience se détourne des réalités conditionnées et changeantes, dont elle perçoit le caractère insatisfaisant, et l'absence de réalité ; ces réalités disparaissent donc à ces yeux ; puisque la conscience n'a plus d'objet, elle disparait ; comme elle a pourtant l'habitude de se projeter vers un objet, elle réapparait ; puisqu'il n'y a alors aucun objet à connaitre, elle prend cette absence d'objet elle-même pour objet ; mais parce qu'il n'y a alors rien de déterminé (aucun objet) à connaître, elle n'y parvient que quelques instants ; elle peut ensuite prendre de nouveau les réalités conditionnées pour objet, ou s'entraîner à connaître Nibbâna de façon plus durable. Pour mieux comprendre tout cela, je vous invite à lire ce qui est dit de Nibbâna sur dhammadana.org. Le site montre très bien comment cet aspect (l’absence de conscience) distingue le bouddhisme des religions et des philosophies.
| Citation: | « …J'ai déjà lu deux réponses (contradictoires entre elles, et je ne sais pas quelle est la bonne) :
- Il y a une conscience supra-mondaine, et on peut dire que la conscience ordinaire est totalement absente.
- Il n'y a rien, et c'est seulement en sortant de nibbana qu'on arrive à constater que tout a cessé pendant un instant ». |
Sur ce sujet, je vous renvoie à ce post : http://forumetta.free.fr/viewtopic.php?t=496&highlight=anidassanam. Je reproduis ici de façon simplifiée ce que j'avais déjà écrit. C'est bien de Nibbâna qu'il s'agit lorsque le Bouddha déclare :
| Citation: |
« Conscience sans surface (viññanam anidassanam : « sans caractéristiques », ou « sans distinctions »), sans fin, lumineuse tout autour, n’a pas été expérimentée à travers [...] la totalité du tout » (MN 49). |
Le "tout" désigne les sens et leurs objets, qui constituent la "surface" à travers laquelle la conscience ordinaire est expérimentée (on expérimente la conscience visuelle à cause de l’œil et de la forme dont on est conscient). Au contraire, la "conscience sans surface" est connue directement, sans intermédiaire, non pas comme un objet, au moyen d'organes corporel : elle est en dehors du « tout », c'est-à-dire en dehors de l’espace et du temps, en une dimension où il n’y a pas d’ici, de là, ou d’entre-deux (Ud I, 10), ni allée, ni venue, ni séjour (Ud VIII.1). On ne peut donc pas dire qu'elle soit permanente ou omniprésente (termes qui n’ont de sens que dans l’espace-temps). Cette conscience est synonyme du Nibbana lui-même : les textes la décrivent comme telle, par exemple, comme le lieu où les phénomènes physiques et mentaux trouvent leur fin (DN 11) ; comme Nibbâna, elle est connue sans médiation. Les textes la comparent à une lumière qui ne se pose nulle part, parce qu’elle ne rencontre aucun obstacle : de même « lorsqu’il n’y a pas de plaisir, de soif, alors la conscience ne s’établit pas ici ni ne croît" et la souffrance disparait (SN XII. 64). Autrement dit, lorsque la conscience cesse de se projeter vers des objets, comme une lumière ne se projetant sur aucune chose, c'est la fin de la souffrance, donc Nibbâna.
En définitive, il faut distinguer Nibbâna de la conscience qui le connait. Celle-ci est la conscience ordinaire, qui figure parmi les agrégats ; tandis que Nibbâna lui-même est comparé (non identique à) une conscience immédiate et lumineuse.
| Citation: | « La "conscience" est comme une juxtaposition d'instants [...]. Qu'est-ce qui relie ces instants ? Ensuite, la conséquence de cette observation implique que le passé et l'avenir n'ont pas de valeur intrasèque.
Mais d'un autre côté, on comprend vite que chaque instant peut être divisé, en fonction de la perception qui s'affine, en d'autres instants de plus en plus petits, ce qui a pour conséquence de rendre le présent insaisissable, voire inexistant ». |
Là, je ne suis pas sûr de vous suivre ; vous voulez peut-être dire que, si la conscience n’est composée que d’instants juxtaposés, le temps semble perdre toute sa réalité. Et, de fait, le passé et l’avenir n’existent plus, ou pas encore, tandis que le présent ne cesse de passer, sans s’arrêter : aucun des 3 ne semble véritablement exister. Mais tout le message du Bouddha est précisément que le temps est une création de l’esprit ! Et Nibbâna est justement la fin du temps (voire ce post : http://forumetta.free.fr/viewtopic.php?t=729).
| Citation: | | « Dans la pratique, on ressent bien cet état dans lequel il semble qu'il n'y ait plus de temps mais seulement une "conscience" qui accompagne ce qui se passe au lieu d'être en permanence en décalage avec l'instant présent ». |
Le mieux est lorsque disparait la séparation entre la conscience et « ce qui se passe ». Alors sujet et objet ne s’opposent plus, l’impression d’être un témoin cesse, et seule reste la réalité.
J'aimerai, en définitive, résumé les arguments en faveur de la doctrine d'anatta. Si les choses sont sans "soi", c'est en raison de :
- leur impermanence : rien n'a d'existence durable, ne serait-ce que durant quelques instants
- leur caractère composé ou divisible : rien n'a d'existence unifiée ou unitaire
- leur dépendance : rien n'est indépendant de causes et conditions, et d'une conscience qui donne un nom. |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Istiqama

Inscrit le: 01 Fév 2010
Messages: 86
|
 Posté le: Ven 30 Avr, 2010 14:42 Sujet du message: Posté le: Ven 30 Avr, 2010 14:42 Sujet du message: |
 |
|
Merci tout d’abord pour cette longue réponse, détaillée, argumentée et très élaborée à laquelle vous avez dû consacrer un temps précieux. C’est très généreux de votre part.
Toutefois, je pense qu’il y a une incompréhension à l’origine. La doctrine d’anatta, je crois l’avoir comprise dans les livres que j’ai lus sur la question et qui exposent les mêmes arguments que vous. Je pense même pouvoir dire que j’en ai un certain ressenti, ce qui me semble important car si beaucoup en parlent savamment, combien en parlent d’expérience ? L’intuition méditative que j’en ai eu et qui a été assez forte pour graver la validité de la théorie d’anatta dans mon cœur, c’est qu’en observant mon corps et mes pensées, je comprends qu’il n’existe pas une conscience mais plusieurs consciences distinctes liées, pour faire simple, à chacun des 5 agrégats. Il n’y a pas une seule et unique conscience qui passe de l’un à l’autre. C’est la rapidité du processus mais aussi la confusion qui nous amènent à identifier tout cela à une identité distincte et personnelle. D’où la notion capitale et souvent mal comprise voire ignorée de souffrance conditionnée.
Comprenez bien que cette conviction est devenue pour moi si forte qu’aucun doute sur la voie bouddhiste ne me tiraille. Je me pose toutefois des questions sur des points qui me semblent très importants. Et je ne dois pas être le seul. Je suis intéressé par le point de vue des autres mais sans entrer dans la philosophie ou la métaphysique. Tout cela, je l’ai étudié pendant 35 ans et qu’est-ce que ça m’a apporté ? Rien. Je ne m’en suis pas réveillé plus heureux, moins souffrant, bien au contraire.
Donc anatta, je l’ai vu, je l’ai constaté. Je sais, en moi, que c’est juste… mais je ne l’ai pas encore totalement intégré. J’ai l’humilité et la franchise de vous en faire part à toutes et à tous, c’est tout. Je refuse de tomber dans une sorte de « catéchisme » bouddhiste qui consisterait à défendre des thèse que l’on n’a pas expérimentées. Ca, cette attitude, c’est ce que j’ai fuit ailleurs, donc pas pour retrouver la même chose ici.
Mais la question n’est pas (seulement) là. Je vais essayer de m’exprimer autrement.
Quand le Bouddha parle de « celui qui est entré dans le courant », de « celui qui n’a plus à revenir qu’une fois », de « celui qui n’a plus à revenir » ou enfin de « celui qui est devenu un saint », de qui ou de quoi parle-t-il ? A coup sûr, ce n’est pas de ce que nous identifions comme le Soi car cela n’a pas d’existence réelle. Alors qu’est-ce qui revient, une fois, pas du tout ou qui devient un saint ? C’est, à mon avis, dans la réponse à cette question que l’on trouve la voie du milieu, la solution à toutes les questions et surtout l’argument définitif qui distingue, au-delà des figures de style et autres acrobaties philosophiques, le bouddhisme du nihilisme. Car sinon, forts de la doctrine d’anatta, comment expliquer l’existence même du bouddhisme, de la voie, de quoi cherchons-nous à nous libérer et surtout pourquoi ?
_________________
Comme une mère protègerait son unique enfant au risque de sa propre vie, cultivons un amour sans limite envers tous les êtres. |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
|
|
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
|
|