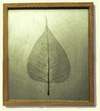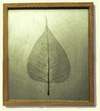 |
Forum Mettâ
Bouddhisme originel
|
| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
Chaosophe
Inscrit le: 13 Avr 2008
Messages: 125
|
 Posté le: Jeu 29 Mai, 2008 15:20 Sujet du message: Posté le: Jeu 29 Mai, 2008 15:20 Sujet du message: |
 |
|
Force m'est bien de relever le défi que vous me posez, Viriya, quoique les matières dont il s’agit ici sont particulièrement, ce me semble, difficiles à pénétrer.
Rûpa ne fait-il pas partie des 12 causes, et précisément de la quatrième (nâma-rûpa) ? C'est pourquoi Walpola Rahula écrit : « Par la conscience sont conditionnés les phénomènes mentaux et physiques » (L’Enseignement du Bouddha, p. 78]. Pour nier que rûpa fasse partie des 12 causes, il faut alors nier qu’il s’agisse de rûpa au sens de « matière » ou « forme » dans l’énoncé des 12 causes. Bien sûr, il m'aurait été utile que vous précisiez en quoi l’idée que rûpa soit conditionné et conditionnant, membre de la production dépendante, n’est pourtant « pas l’enseignement du Bouddha »… ?! Dira-t-on que le rûpa dont il est fait mention dans l’énoncé des 12 causes n’est pas séparable de nâma ? Cela ne change rien au fait que le terme figure dans l’énoncé des 12 causes, et qu’il désigne bien la matière – sans doute celle du corps, et en particulièrement sans doute celle du corps humain (encore que tous les êtres vivants, me semble-t-il, sont soumis à la loi de production en dépendance fonctionnelle de causes et conditions). Si rûpa n’est pas une des 12 causes, il suffit, pour justifier mes posts précédents, qu’il fasse partie des agrégats. – Reste en tout cas qu’il m'est difficile de comprendre en quoi nâma-rûpa provient de la conscience, comme l’énonce pourtant la formule des 12 causes. C'est d’ailleurs pourquoi un soupçon d’idéalisme à souvent pesé sur le bouddhisme, et c'est pourquoi apparaitra le Yogacara-Vijnanavada. Je serai en tout cas heureux qu’on éclaircisse ce point : qu’est-ce qui est conditionné par la conscience : l’existence de nâma-rûpa, ou seulement son phénomène (son apparition subjective) ? La conscience est-elle à l’origine du corps et des phénomènes mentaux, ou seulement de leur expérience ? C'est un des nerfs de la question qui s'enquiert de savoir si le bouddhisme est ou non un idéalisme.
Vous taxez d’ambigüité le terme « réalisme », et en effet, il n’est pas moins plurivoque que le terme « idéalisme ». J’entendais ce terme au sens philosophique (et non politique ou esthétique par exemple), sens qui est lui-même multiple et ne se comprend que par son opposition à l’idéalisme. Je préciserais donc ce que j’entends par là – à savoir : non pas la doctrine qui attribue une existence réelle aux entités idéelles (cas du platonisme, d’une partie de la scolastique médiévale, ou de certaines branche de la philosophie des mathématiques moderne), mais plutôt une doctrine d’après laquelle l’être est indépendant de la connaissance actuelle que peuvent en prendre les sujets conscients, ou d’après laquelle esse (être) n’est pas équivalent à percipi (être perçu). En ce sens, pour le réalisme, l’esprit ne créer pas le monde ou l’acte de connaître l’objet connu. – On appelle encore réalisme une doctrine d’après laquelle la pensée individuelle ou l’esprit peut, dans l’acte de connaissance, saisir par une intuition directe le non-moi en tant que distinct du moi – ce qui est, me semble-t-il, le cas du bouddhisme (si bien sûr on comprend par moi et non moi respectivement le composé psychosomatique et le monde extérieur). Or à croire toutes les objections qui m'ont été faite sur l’hypothèse d’un idéalisme théravadin, ne suis-je pas obligé de reconnaître que le bouddhisme est un réalisme naïf ? A savoir : cette forme philosophique du réalisme de sens commun, qui admet l’existence non problématique d’un monde d’objets matériels et de sujets conscients, avec lesquels la connaissance est en rapport soit de saisie directe (en cas de « connaissance et vision », dirait le Bouddha), soit comme le portrait par rapport au modèle (je ne crois pas que ce soit le cas du bouddhisme).
Je veux encore apporter des éléments d’élucidations, car si j’ai été obligé de conclure que le bouddhisme est un réalisme, c'est pour partie à contre-cœur. Pour le réalisme, l’être est autre chose que la pensée, au sens où le donné est autre que les abstractions, les concepts, etc. dans lesquelles notre entendement les résout. Et l’être est indépendant à l’égard de la connaissance consciente, au sens où l’être existe en dehors de la connaissance et où celle-ci ne le créer pas. (On ne s’insurgera pas d’entendre le mot « être » au sein de distinctions philosophiques, car il ne signifie ici que les objets mondains ou les objets de la pensée). – En somme, pour le réalisme, il y a une réalité indépendante de la subjectivité (thèse ontologique), et cette réalité peut faire l’objet d’une connaissance (thèse épistémique). Je précise pourtant qu’aucune de ces deux thèses isolément ne suffit à définir le réalisme, mais on appellera réalistes les théories soutenant les deux thèses.
Ce qui m'importait à l’origine était notamment de savoir s’il y avait un idéalisme épistémique du bouddhisme, c'est-à-dire une doctrine selon laquelle nous n’avons accès qu’aux phénomènes, aux apparitions des choses, et non à ces choses elles-mêmes. En ce sens, les dhamma ne seraient que des données sensorielles et mentales, non des atomes de réalité. Cette question reste encore pour moi insoluble, notamment parce qu’elle est liée à la question de savoir si le monde n’est, pour le Bouddha, qu’un flux d’actes, ou si ce flux est lié à la connaissance et au désir. Le problème est bien effet que pour le bouddhisme, l’acte intentionnel, le désir et l’ignorance coordonnent le devenir, l’orientent, le conditionne – bref : décident de son apparition ou de sa disparition. C'est en ce sens qu’il faut comprendre certains textes qui remplacent, dans l’énoncé des 4 Nobles « Vérités », « dukkha » par « le monde » (loka), lequel proviendrait… de tanha ! Le monde signifie alors simplement les agrégats d’attachements, car en effet : qui y a-t-il en dehors des agrégats ? Je reviendrais sur le fait Walpola Rahula notamment classe les objets correspondants aux organes des sens (formes visuelles, etc.) sous le premier agrégat. La question est de nouveau de savoir si le premier agrégat ne comprend que des phénomènes (le son en tant seulement qu’entendu, l’odeur en tant seulement qu’humée, etc.), ou les choses mêmes (le son en tant que réalité matérielle, etc.). Or les objets dont il s’agit, en tant que classés sous le premier agrégat, sont matériels (le son est vibration, mouvement), et non purement phénoménaux ou subjectifs. Donc si jamais on n’arrivait à prouver que tanha est à l’origine des agrégats d’attachement, on devrait admettre que tanha est à l’origine de la matière en tant qu’agrégat d’attachement. Même si on limite alors cet agrégat au seul organisme vivant, par exemple celui de l’homme, cela ne change rien : tanha est encore à l’origine de l’organisme.
Les choses étant présentées ainsi, le bouddhisme est soi un idéalisme, soi un réalisme, ou une forme mixte ; mais dans tous les cas, cela ne sera pas une croyance de ma part. Une chose me paraît à tout le moins certaine : le Bouddha commence par un phénoménisme perceptif, au sens où il opère une analyse quasi-phénoménologique de l’expérience. Le problème est en définitive que son phénoménisme ne se prononce pas sur le lieu du flux : la conscience, ou le monde ? Les réalistes les plus hardis seront les Sarvastivādin : ceux qui affirment que tout existe (même le passé et le futur). Le bouddhisme ancien est réaliste au sens où, si le monde extérieur est sans doute impermanent, les dhamma sont réels.
Donc qu’on ne se trompe pas sur le caractère embrouillé de ce post : la question est elle-même difficile à résoudre, et il semble que la vérité en la matière passe par des concessions faites à la fois à l’idéalisme et faites au réalisme. Cela se comprend intuitivement lorsque l’on songe qu’en un sens, la majeure partie de l’expérience de l’esclave du devenir est une fabrication de la pensée (en ce sens, une idéalisation), mais qu’en outre, l’éveillé ou le moine a bien un accès direct à une réalité profonde. Mais à aucun moment le Bouddha ne semble présenter cette réalité par opposition à l’apparence que nous en fournissent nos sens. Si bien qu’il ne s’agit pas tant de connaître de prétendues choses en soi qui seraient cachées derrière leurs apparences phénoménales, que d’analyser ces manifestations pour les résoudre en leurs éléments constitutifs, alors tenus pour réels et non produits par la pensée. – En un sens, les « objets » que connaît l’esprit illusionnés sont en bonne part sa propre création, mais la sagesse peut apercevoir ce qui en eux est bien réel, sans qu’à aucun moment l’apparence ne s’oppose à la réalité, au sens où le sens commun et l’occident depuis le platonisme entendent cette opposition (comme opposition entre l’impermanence et l’éternel, le visible et l’intelligible, etc.). Quant à savoir ce qui a pu donner + de 2000 ans d’avance au Bouddha sur la pensée philosophique et la science moderne à cet égard… mystère !
« Pourquoi relier réalisme qu'aux phénomènes physiques ? ».
J’abordais la question sous cet angle, car je ne pense pas que le Bouddha soutenait un réalisme des idées, i.e. une doctrine qui affirmerait l’existence mondaine, ou extérieure au sujet, des objets théoriques et des concepts. A cet égard, j’ai bien conscience que les phénomènes physiques ne sont pas l’ultime réalité, mais une réalité ultime, comme je l’avais pourtant précisé. – Malgré tout, Walpola Rahula invite à croire à une sorte d’idéalisme des idées, lorsqu’il écrit, à la page 40 de l’Enseignement du Bouddha (édition Seuil, La Flèche, 1961) : « sous ce terme de dérivés des quatre grands éléments, on comprend les 5 organes matériels des sens […] et les objets qui leur correspondent dans le monde extérieur, i.e. les formes visibles […], et également telles pensées, idées et conceptions qui appartiennent au domaine des objets mentaux ». Mais ne perdons pas de vue, comme l’indique la suite du texte, que « le bouddhisme ne conçoit pas l’esprit comme s’opposant à la matière » (p. 40-41) ! La question de savoir si les « objets » dont il est question sont des phénomènes ou des choses en soi vient d’être discutée, et apparaît finalement comme une alternative inadéquate, ou particulièrement difficile à maintenir (et je serai heureux de voir si certains y arrivent, ce qui suppose de régler la question la question de l’idéalisme ou du réalisme bouddhique).
Je ne citais pas Rahula pour confirmer mon affirmation incroyablement hérétique ( !) que le désir est à l’origine des agrégats d’attachement, mais simplement pour définir cet agrégat.
Je ne cesse pourtant de penser que, si les « 5 agrégats d’attachement sont dukkha » (S III [PTS], p. 158) et si tanha est à l’origine de dukkha, tanha est à l’origine des 5 agrégats d’attachements !
Pourquoi me répétez-vous que je mets dans le même sac la soif et la volonté de libération, alors que je précise que mon but est de distinguer les deux ? Vous répétez que je les mets dans le même sac, mais je répète que je voulais distinguer les deux. Mes messages précédents n’ont-ils pas visé effectivement à montrer que, si la soif implique tension, soucis et agitations, la voie de libération, au contraire, engage quant à elle un effort, une intention, une joie, un plaisir et une aspiration spécifiques ? Il y a bien aspiration à la libération, et même une soif des extases, lesquelles sont en effet des fabrications de la pensée, et je ne m'épuiserais pas à confirmer ces points si formidablement établis par Silburn, dans Instant et Cause. Mais je suis bien d’accord pour dire qu’il ne s’agit pas simplement dans le bouddhisme de réorienter le désir ou de lui donner une nouvelle forme, mais in fine de le déraciner totalement. Seulement, cette opération passe par la mise en jeu d’actes, d’intentions, d’efforts, et d’une volonté puissante (elle amène par exemple à préférer perdre la vie plutôt que commettre un acte malhabile !). A part le Bikkhuni, le Culavedalla Sutta (MN 44) ainsi que MN 137 mentionnent également une aspiration ardente – et encore est-il sans doute aisé de trouver d’autres occurrences de ce principe, et j’invite quiconque peut m'aider à trouver des références à cet égard à me les communiquer. Tous les autres textes que j’ai cités montraient ce qui fait l’objet du désir ou du plaisir temporaires du moine (joies du renoncement, plaisirs subtils, etc.). – Ainsi, votre interprétation du Bikkhuni – à savoir : « il existe un ancien qui a pu se libérer en déraciner cette soif, ou cette vanité. Il devrait penser que lui aussi, il pourrait le faire en suivant la méthode du précédent moine » – cette interprétation confirme, si du moins l’on est de bonne foi, qu’il y a un réel désir chez le moine d’atteindre la libération. A quoi bon le nier ? Encore que votre formulation vise à amenuiser de nouveau le sens du texte, puisque vous renvoyez au seul facteur mental (« The thought occurs to him.. »), et non au facteur conatif ou érotique qui l’accompagne (« I HOPE that… »), et qui est présent dans les autres cités (« O when will I enter & remain … he thus nurses this yearning for the unexcelled liberations », MN 44 : remarquez l’insistance sur le vocabulaire de l’envie !). Seul cet élément d’ailleurs justifiait que l’on dise que ce soit « par la soif qu’on met fin à la soif ». – Reste en tout cas que le Bikkhuni stipule que le corps provient bien du désir…
Entre « tanha est un agrégat » est « tanha fait partie des agrégats », je ne faisais pas de différence (le lien est si étroit entre les deux qu’il ne parait pas possible de les distinguer objectivement, MN 44 !), et je n’en vois toujours pas de radicale du point de vue du propos ici en jeu : à savoir que tanha est un des facteurs principaux, ou le nom générique pour les facteurs multiples à l’origine des agrégats d’attachement, lesquels comprennent l’organisme physique. Cela n’érige-t-il pas tanha, ou le complexe : tanha + ignorance + attachement (ou « saisie », ou « appropriation ») en force à l’origine du vivant ? Or, en faisant abstraction des formes saines et malsaines de ce qui oriente le devenir (le devenir du moine comme le devenir du putthujana), ne voit-on pas que l’origine du devenir est une intention (ancrée dans l’ignorance ou la sagesse) qui reprend une impulsion (venant du désir ou de la volonté de libération) et l’oriente en vue d’une fin (actes habiles ou malhabiles) ? Je ne fais de toute façon pas de cette idée une croyance philosophique, et il m'importe peu que l’on soit d’accord avec moi. Néanmoins, toute réfutation est la bienvenue, car ainsi seulement progressent les réflexions.
Je peux sur ce point faire une concession : l’acte de l’esclave du devenir n’est pas toujours nécessairement intentionnel. En tant qu’il est impulsif (appativānî ; S.N. 11. 132, cité dans Silburn, Instant et cause, p. 212), il est dépourvu d'intention (anabhisamkhāra), quoiqu’il comporte désir. Il s’oppose alors à l’acte de l'homme délivré – acte dépourvu d'intention (anabhisamkhāra), mais parce que son activité n'est pas intéressée. Entre temps, le moine aura dû engendrer une nouvelle continuité (car toute continuité est une fabrication) : une cohérence spirituelle, engendrée par la pensée lucide et orientée – temps idéalisé qui n'engage aucune une durée dont on ne serait pas le maître.
Votre vision de la pratique est semble-t-il celle-ci : « C'est en observant les souillures, en identifiant les trois poisons, la vanité, avec compréhension que c'est akusala […] qu'on arrive à les déraciner petit à petit jusqu'au plus subtil ».
Il a d’une part été réfuté que tel serait le sens de la proposition selon laquelle c'est par la soif que la soif est abandonnée ; mais il apparaît d’autre part et surtout qu’aucun facteur de volonté ou d’effort n’est mentionné dans votre description, quoique je doute que votre pratique personnelle ne vous ai présenté la nécessité de ces facteurs. En un sens, il est vrai, l’acte libérateur, compris fondamentalement comme acte d’attention, n’engage aucun effort : car quel effort pourrait rendre l’esprit véritablement attentif ? Je renvoie sur ce point aux génialissimes analyses de l’attention sur le site Dhammadana.org. |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Pieru
Web

Inscrit le: 17 Jan 2007
Messages: 256
Localisation: France sud
|
 Posté le: Jeu 29 Mai, 2008 20:47 Sujet du message: Posté le: Jeu 29 Mai, 2008 20:47 Sujet du message: |
 |
|
Bonsoir,
| Citation: | | Force m'est bien de relever le défi que vous me posez, Viriya, quoique les matières dont il s’agit ici sont particulièrement, ce me semble, difficiles à pénétrer. |
A la lecture de ce post, cette question me vient à l'esprit:
Où commence la réflexion vaine et où finit dhamma vicaya?
Non que je ne doute pas de la possibilité que je ne détienne pas les notions philosophiques adéquates pour répondre, mais plus à savoir est-ce que ces questions nécessitent réellement des réponses.
Voici comment Sayadaw U Pandita résume dhamma vicaya, "l'investigation du dhamma":
Caractéristique : connaissance intuitive de la nature des dhammas et de nibbâna.
Fonction : dissiper l'ignorance.
Manifestation : Non-confusion.
Moyens pour éveiller ce facteur :
Selon le Bouddha : perception directe.
Selon les Commentaires :
1) Poser des questions à propos du Dhamma et de la pratique de la méditation.
2) Maintenir les bases internes et des bases externes (le corps et l'environnement immédiat) dans un état de propreté.
3) Equilibrer les facultés de contrôle.
4) Eviter les personnes ignorantes.
5) S'associer avec des personnes sages.
6) Réfléchir au Dhamma profond.
"Il s'agit ici essentiellement de réfléchir à la nature des phénomènes physiques et mentaux du point de vue de vipassana : il n'y a que des agrégats, des éléments, des facultés et tous ces phénomènes sont impersonnels."
7) Etre déterminé à développer
"Il faudrait toujours être soucieux de développer l'investigation, la vision intuitive directe. Souvenez-vous qu'il n'est pas nécessaire de rationaliser ou d'intellectualiser vos expériences. Contentez-vous de pratiquer la méditation et d'acquérir la connaissance directe de votre propre corps et de votre propre esprit."
Extraits de Dans cette vie même - Sayadaw U Pandita
De même, souvenez vous du vénérable Culamâlukyaputta qui, du temps de Bouddha, se posait de grandes questions à propos de l'univers et de la vie.
("L'univers est-il permanent? L'univers est-il non permanent? L'univers est-il limité?" etc)
Ce a quoi Bouddha répondit :
"Si vous exigez de connaître les réponses à ces questions avant de commencer la pratique du dhamma, vous mourrez sans en avoir pu obtenir le moindre bénéfice.
Parce que je ne répondrai jamais à ces questions ! Par exemple, si quelqu’un reçoit une flèche empoisonnée, et qu’il exige de connaître le nom et la caste de l’archer, ainsi que de savoir de quoi est faite la flèche, avant même qu’on la lui retire, il mourra certainement. De la même manière, la pratique du dhamma constitue l’essentiel, c’est le seul moyen de se délivrer du cycle sans fin du samsara, les questions que l’on se pose sont sans importance. Lorsque vous êtes en train de penser que l’univers est permanent, vous ne pratiquez plus. Lorsque vous êtes en train de penser qu’il est non permanent, de la même façon, vous ne pratiquez plus (...).
Que l’univers soit permanent ou qu’il soit non permanent, (...) il y a dukkha ; la vieillesse, la maladie et la mort.
J’ai enseigné comment se délivrer de la vieillesse, la maladie et la mort. Mettez en application le dhamma que j’ai enseigné, étudiez-le ! Il n’y a aucun avantage à se demander si l’univers est permanent ou non permanent (...), ni pour soi, ni pour les autres. Cela ne cause qu’une perte de temps. Pour cette raison, pratiquez ce que vous êtes en mesure d’expérimenter, pratiquez pour vous libérer de la souffrance que vous vivez chaque jour ! J’ai enseigné les quatre nobles vérités. Si vous pratiquez en accord avec ces quatre nobles vérités, vous vous libèrerez du samsara. »
Le Vénérable Culamâlukyaputta fut enchanté des paroles du Bienheureux."
Dhamma Sami - La vie de Bouddha et de ses principaux disciples p.263
Le Bouddhisme est-il idéalisme ou réalisme?
Le Dhamma est une voie de libération.
Amicalement.
_________________
"Qui connait la nature connait le Dhamma". |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
viriya
Web

Inscrit le: 27 Juil 2006
Messages: 601
Localisation: idf
|
 Posté le: Jeu 29 Mai, 2008 23:28 Sujet du message: Posté le: Jeu 29 Mai, 2008 23:28 Sujet du message: |
 |
|
merci Chaosophe pour vos explications.
On n'a tout simplement pas la même lecture de l'enseignement du Bouddha. Et c'est ainsi va la vie.
_____________________________________________
Je vais seulement m'attarder à un point de la doctrine qui de là découlent tous les autres.
"rupa est une des 12 causes" : cette affirmation est cohérente par rapport à vos messages, mais le Bouddha n'a pas enseigné cela.
Pourquoi ?
1er point : Le Bouddha a enseigné la loi de coproduction conditionnée (PaticcaSamupadda). La représentation habituelle est la chaine des 12 conditions. Parfois on nomme cette loi, la loi de causes et d'effets , étant donné que chaque condition est à la fois cause et effet. Aucune condition n'est la cause première par rapport à d'autres conditions.
Donc ça n'existe pas la loi des 12 causes. Si vous voulez se référer à Paticcasampudda, il faudrait dire la loi de causes et d'effets.
Quand ceci est , cela est ; ceci apparaissant, cela apparait.
Quand ceci n'est pas , cela n'est pas; ceci cessant , cela cesse.
Tout ce qui a la nature de l'apparition, tout cela a la nature de la cessation.
2ème point : rûpa est une des 12 causes - supposons que vous voulez dire la loi de 12 causes et effets.
Le Bouddha a enseigné : sens de l'apparition
1. Par avijja, l'ignorance, sont conditionnés les sankharas, volitions productrices de renaissances ou le Kamma amassé dans le passé.
2. Par les sankharas est conditionné vinna, la conscience reliant les renaissances.
3. Par vinnana est conditionné nama/rupa
4. Par nama/rupa sont conditionnés salayatana, les six bases des sens (oeil, oreille, nez, langue, corps,esprit )
5. Par salayatana est conditionné phassa, le contact
6. Par phassa est conditionné vedana, la sensation.
7. Par vedana est conditionné tanha, le désir passionné.
8. Par tanha est conditionné upadana, l'attachement.
9. Par upadana est conditionné bhava, le processus du devenir.
10. Par bhava est conditionné jati, le processus de renaissance.
11. Par jati est conditionné la vieillesse, la maladie, la mort, la tristesse, les lamentations, la peine, la douleur et le désespoir.
Ensuite le sens de la cessation...
Nama/rûpa est l'être dans son entier, si on extrait rûpa de nama-rupa , c'est un cadavre qu'on a et il n'a aucune utilité.
_________________________________________________________________
sur la citation du Vénérable Walpola Rahula, vous avez raison qu'il a bien écrit concernant les Agrégats de la Matière à la page 40 de l’Enseignement du Bouddha (édition Seuil, La Flèche, 1961) : « sous ce terme de dérivés des quatre grands éléments, on comprend les 5 organes matériels des sens […] et les objets qui leur correspondent dans le monde extérieur, i.e. les formes visibles […], et également telles pensées, idées et conceptions qui appartiennent au domaine des objets mentaux ».
Sur ce point qui considère que "les pensées , idées et conceptions qui appartiennent au domaine des objets mentaux" sont dans l'Agrégat de la Matière, je suis en désaccord avec ce qui est écrit si je me réfère aux Suttas et aux autres sources. Malheureusement le Vénérable n'est plus là pour expliquer son point de vue.
D'après ce que j'ai compris, l'agrégat de la matière contient le support pour les pensées, idées et conceptions.... c'est à dire la porte du mental, mais pas le mental lui même. Tout comme les yeux, les oreilles, la langue, le nez, le corps tangible qui sont le support permettant la conscience (visuelles, auditives,...) de se manifester.
_________________________________________________________________
Bonne quête. 
_________________
avec metta
viriya
Dernière édition par viriya le Jeu 29 Mai, 2008 23:43; édité 1 fois |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
viriya
Web

Inscrit le: 27 Juil 2006
Messages: 601
Localisation: idf
|
 Posté le: Jeu 29 Mai, 2008 23:41 Sujet du message: Posté le: Jeu 29 Mai, 2008 23:41 Sujet du message: |
 |
|
| Pieru a écrit: | A la lecture de ce post, cette question me vient à l'esprit:
Où commence la réflexion vaine et où finit dhamma vicaya?
Non que je ne doute pas de la possibilité que je ne détienne pas les notions philosophiques adéquates pour répondre, mais plus à savoir est-ce que ces questions nécessitent réellement des réponses.
|
bonsoir Pieru, très juste question
la part de spéculations intellectuelles est toujours présente.
le Dhamma vicaya commence là où il y a nécessité d'inspection et d'instrospection , et finit quand on sait que c'est ainsi .
maintenant je sais que c'est ainsi 
meilleurs souhaits 
_________________
avec metta
viriya |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Chaosophe
Inscrit le: 13 Avr 2008
Messages: 125
|
 Posté le: Ven 30 Mai, 2008 2:55 Sujet du message: Posté le: Ven 30 Mai, 2008 2:55 Sujet du message: |
 |
|
| Pieru a écrit: | | est-ce que ces questions nécessitent réellement des réponses |
J'ai bien compris que la réponse, c'est la disparition du questionneur |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Hahasiah
Inscrit le: 06 Mai 2008
Messages: 22
|
 Posté le: Lun 16 Juin, 2008 1:37 Sujet du message: Posté le: Lun 16 Juin, 2008 1:37 Sujet du message: |
 |
|
| viriya a écrit: | | "C’est en reposant sur la soif que la soif est abandonnée" signifie que le yogi a identifié que la soif est source de dukkha et en cela qu'il a abandonné la soif en prenant exemple sur un ancien lui montrant la voie. |
Vaincre sa volonté par la volonté elle-même ?  |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Hahasiah
Inscrit le: 06 Mai 2008
Messages: 22
|
 Posté le: Lun 16 Juin, 2008 1:45 Sujet du message: Posté le: Lun 16 Juin, 2008 1:45 Sujet du message: |
 |
|
Je pense qu'au contraire cette discussion est très intéressante. Elle relève en effet d'un autre lien entre christianisme et bouddhisme, celui du "pauvre en esprit" et du "riche en esprit" (référence wagnérienne). Je m'explique, le christianisme et le bouddhisme sont deux pensées qui n'ont nul besoin d'approfondissements "scientifiques" et rigides, de réflexions pour la réflexion mais bien d'être considérée comme des expériences à vivre. Ce n'est pas tant une pensée à étudier qu'une réalité à changer par cette pensée. Je ne sais pas si je suis assez clair et je ne me permettrais de remettre en doutes vos connaissance sur le bouddhisme qui sont plus aboutties que les miennes néanmoins justement, Bouddha et Christ ont fait leur travail pour les gens simples qui ne cherchent pas de justification dans leurs actes, simplement à mieux se comprendre soi pour mieux comprendre les autres. Mais le bouddhisme peut se comprendre effectivement de différentes manières, serait-il possible par exemple de comparer l'école tantrique et l'école zen ?!  Certains peuvent voir la lumière là où d'autres ne voient que de l'ombre... Certains peuvent voir la lumière là où d'autres ne voient que de l'ombre... |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
thanatos
Web

Inscrit le: 06 Aoû 2006
Messages: 138
|
 Posté le: Lun 16 Juin, 2008 19:40 Sujet du message: Posté le: Lun 16 Juin, 2008 19:40 Sujet du message: |
 |
|
| Hahasiah a écrit: | | ... le christianisme et le bouddhisme sont deux pensées qui n'ont nul besoin d'approfondissements "scientifiques" et rigides, de réflexions pour la réflexion mais bien d'être considérée comme des expériences à vivre. Ce n'est pas tant une pensée à étudier qu'une réalité à changer par cette pensée. |
c'est tout à fait cela! 
Bien que je dirai plutôt: une vision de la réalité à changer par cette pensée.
avec metta
_________________
buddham saranam gacchami dhammam saranam gacchami sangham saranam gacchami |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
|
|
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
|
|