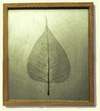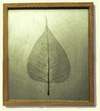 |
Forum Mettâ
Bouddhisme originel
|
| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
Chaosophe
Inscrit le: 13 Avr 2008
Messages: 125
|
 Posté le: Jeu 02 Oct, 2008 13:10 Sujet du message: Pour mieux connaitre dukkha Posté le: Jeu 02 Oct, 2008 13:10 Sujet du message: Pour mieux connaitre dukkha |
 |
|
Bonjour à tous.
Je mets ici à disposition un petit travail, consistant à définir et décrire dukkha. Il se base sur plusieurs sources, notamment sur une traduction libre du passage concernant la première Noble Vérité de « Wings to Awakening », de Thanissaro Bikkhu (http://www.buddhanet.net/wing1nt.htm), et sur le passage afférant à dukkha sur le site dhammadana.org. Vueillez excuser le style parfois télégraphique : peut-être apportera-t-il parfois une plus grande clarté.
Dukkha = la douleur, la peine, la souffrance, le stress, l’insatisfaction, le désagrément. Plus profondément : le malaise, le tourment, l’instabilité. Bouddha ne décrit que dukkha et sa cessation ("Both formerly & now, it is only dukkha that I describe, and the cessation of dukkha." -- SN 22.86). Le but de la voie est de comprendre dukkha pour la supprimer.
Définition de dukkha dans l’énoncé des 4 Nobles Vérités :
- naissance,
- vieillesse,
- maladie,
- mort,
- union avec ce que l’on n’aime pas, séparation avec ce que l’on aime,
- ne pas obtenir ce qu’on désire
→les 5 agrégats d’attachement
Définition de SN 56.11, avec explication de MN 141 :
- naissance (apparition des agrégats, acquisition des sphères sensorielles)
- vieillesse (déclin de la force vitale, affaiblissement des facultés)
- mort (rupture des agrégats, interruption de la faculté vitale)
- tristesse (tristesse intérieure de celui qui souffre d’un malheur, touché par une chose douloureuse)
- lamentations (cris, pleurs, gémissements, etc.)
- douleur (douleur ou gêne physique, née du contact physique)
- peine/désarroi/détresse (douleur ou gêne mentale, née du contact mental)
- désespoir (accablement, désespérance, etc.)
- union avec ce que l’on n’aime pas (apparition d’objets indésirables, déplaisants, peu attirants ; connexion, contact, relation, interaction avec ceux qui nous veulent du mal, souhaitent notre gêne, ne veulent pas notre sécurité) ;
- séparation avec ce que l’on aime (non-apparition d’objets désirables, plaisants, attirants ; absence de connexion, contact, relation, interaction avec ceux qui veulent notre bien, bénéfice, confort, sécurité, ni avec mère, père, frère, sœur, amis, compagnons, relations)
- ne pas obtenir ce qu’on désire (étant sujet à naissance, vieillesse, maladie, mort, tristesse, lamentation, douleur, peine, désespoir – souhaiter ne pas l’être)
→les 5 agrégats d’attachement.
Définition en fonction des sens : dukkha = les 6 moyens internes des sens (œil, etc.). ("Et quelle est la noble vérité de dukkha? Les six moyens internes des sens,' devrait être la réponse. Quels sont ces six? Le moyen de l'oeil... l'oreille... le nez... la langue... tle corps... l'intellect. C'est ce qu'on appelle la noble vérité de dukkha." SN LVI.14).
Dukkha en tant qu'incendie qui fait rage : « le tout est en flammes » (i.e. les organes, objets, consciences, contacts, plaisirs, douleurs, sensations neutres sont en flammes), « enflammé du feu de la passion », de l’aversion, illusion, naissance, vieillissement et mort, avec les peines, lamentations, souffrances, regrets et désespoirs (cf. SN XXXV.2 . .
Il faut connaître Dukkha, sa cause (l’envie insatiable), sa diversité (majeur/mineur, disparaissant lentement/rapidement), son résultat (perplexité ou recherche), sa cessation (cessation de tanha), la voie de la pratique pour sa cessation (Noble Octuple Sentier). (Cf. sutta des 4 Nobles Vérités)
Dukkha est :
• perturbation, irritation, dépression, souci, désespoir, peur, angoisse, anxiété ;
• vulnérabilité, blessure, incapacité, infériorité ;
• maladie, vieillesse, déclin du corps et des facultés, sénilité ;
• douleur/plaisir ;
• excitation/ennui ;
• privations/excès ;
• désir/frustration, inhibition ;
• nostalgie/aimlessness ;
• espoir/désespoir ;
• effort, activité, effort/répression ;
• manque, besoin, insuffisance/satiété ;
• amour/absence d’amour, solitude, aversion/attraction ;
• paternité/absence d’enfant ;
• soumission/rébellion ;
• décision/indécision, incertitude.
(Cf. Francis Story in Suffering, in Vol. II of The Three Basic Facts of Existence (Kandy: Buddhist Publication Society, 1983)
Il y a 3 sortes de dukkha (cf. SN 38.14 ; DN 11,1.216) :
Dukkha-dukkha : dukkha en tant que souffrance ordinaire (douleur)
vipariṇâma-dukkha : dukkha en tant que souffrance causée par le changement, ou plutôt par l’altérité de l’existence.
saṃskhāra-dukkha : dukkha en tant qu’état conditionné (existence conditionnée)
Dukkha est une caractéristique générale et dominante du monde vécu. Le seul fait de vivre est marqué par la caractéristique de dukkha, i.e. la peine sous toutes ses formes : tristesse dans la misère ou les difficultés de la vie ; peine par saturation de plaisir ; peine de la séparation d’avec ceux qu’on aime et de la présence de ceux qu’on n’aime pas
C'est une erreur de dire que le bouddhisme est un pessimisme, en ce que le monde ne serait pas si malheureux car il y a de l’espoir : c'est justement parce qu'il y a de l'espoir que cela montre que le monde est + malheureux qu'on ne le pense. L'espoir d'un avenir meilleur = manière de reconnaître que le présent n'est pas si agréable. Les difficultés sont innombrables… D’où l’imagination d’un paradis éternel, merveilleux, où tous les êtres vivent un bonheur parfait (démocratie ; richesse et prospérité ; drogue ; idéal religieux). Il existe chez l’homme une tendance à projeter (dans l'avenir et l'espace) un monde meilleur, qui part du constat de la pénibilité du monde, mais rend incapable de construire une vie décente présente. Il faut arriver à ne plus rêver de paradis, à ne plus s'imaginer un monde hypothétique, meilleur, et en outre arriver à se construire dans ce monde pénible un monde décent, confortable, voire assez heureux. (Bouddha n’a pas entretenu ses auditeurs dans le rêve d'un monde meilleur, mais à mis en garde vis-à-vis du fait qu'on ne peut pas acheter sa place au paradis).
La voie est celle de la cessation de la souffrance plutôt que de l’acquisition du bonheur. Le monde est fait de dukkha, qui a une cause, donc il y a la possibilité de la fin de la peine. L’alternative n’est pas la vie divine ou éternelle, mais la fin ou l’absence de la souffrance. Il n’y a grand-chose à faire, car on ne peut pas enlever la souffrance, mais arrêter de la fabriquer, i.e. en arrêter ce qui en est la cause ou la multiplication de ses causes + faire + développer le mental.
On n’apprend pas à gérer la douleur : on apprend nos stratégies élémentaires pour la gérer dans notre plus tendre enfance, quand notre pouvoir d’observation n’est pas développé et quand on ne peut pas comprendre d’enseignement verbal de la part des autres. Il n’y a alors pas de compréhension de la peine, mais perplexité ou fuite, et développement d’une manière malhabile de traiter dukkha. Même quand notre esprit développe des capacités verbales et plus logiques, beaucoup des stratégies et attitudes malhabiles face à la peine qu’il a développées dans l’enfance demeurent sur un plan inconscient.
Il ne s’agit pas de se débarrasser de la souffrance en accord avec nos tendances habituelles, mais d’essayer de la comprendre. L’acte même d’essayer fait apprendre des leçons importantes :
- apprendre à faire cesser tout sens de perplexité/confusion en face de la souffrance. La voir telle qu’elle est réellement permet de la traiter plus efficacement et habilement : affaiblissement du processus par lequel ignorance et souffrance s’alimentent mutuellement.
- A mesure qu’on apprend à résister à nos réactions habituelles face à la peine, on apprend à creuser dans le non-verbal, les niveaux inconscients de l’esprit, portant à la lumière beaucoup de processus informes et cachés (inarticulés) dont on était préalablement ignorant.
Toutes les tendances inconscientes s’abreuvent à la source de la souffrance. Il suffit d’observer la souffrance pour voir quelle réaction inconsciente apparaît (comme on se terre pour observer un animal sauvage). L’acte d’essayer de comprendre la souffrance mène à une compréhension améliorée de la douleur + une conscience accrue des processus les plus élémentaires à l’œuvre dans l’esprit. Alors qu’on voit comment chaque manque d’habileté dans ces processus, et en particulier dans nos réactions à la peine, produit + de peine, l’esprit s’ouvre à la possibilité que des réactions plus habiles non seulement soulageront les souffrances particulières, mais également éloignera de la souffrance. La conviction dans cette possibilité (= principe du kamma) mène de l’expérience de dukkha à une chaine causale qui rompt la perplexité menant à de la souffrance future et termine dans une libération totale (cf. SN 12.23). Mais la peine est aussi la perspective la + difficile pour observer les processus de l’esprit, parce que c'est déplaisant et dur à supporter. C'est pourquoi le discernement implique les facultés de conviction, persistance, attention et concentration, pour lui donner l’assurance détachée et la focalisation constante nécessaire pour coller à la peine et ne pas virer dans le discours ordinaire, les théories abstraites, et autres moyens de défenses malhabiles que l’esprit élabore contre la souffrance. Seul le développement des 5 facultés dans la concentration juste fournit la base de plaisir et d’équanimité nécessaire pour sonder la souffrance sans se sentir menacer par elle, et parvenir ainsi à une compréhension impartiale de sa vraie nature.
DN 22 indique la direction que cette compréhension doit prendre, analysant la large variété de dukkha sous 5 catégories (les 5 agrégats d’attachement). Les 5 catégories des agrégats recouvrent le champ entier de l’expérience qui peut être décrite adéquatement (DN 15 Maha-nidana sutta). Ce ne sont pas les agrégats qui constituent en eux-mêmes dukkha, mais lorsqu’ils fonctionnent comme objets de clinging/sustenance : upadana couvre 2 aspects d’un processus physique métaphoriquement appliqué à l’esprit :
- L’acte de s’accrocher (act of clinging) par lequel un feu (takes sustenance) s’alimente avec un peu de combustible ;
o Faut-il ici traduire par « s’accrocher » ou « s’attacher » ? Le terme upadana a-t-il toujours des connotations affectives ?
- L’alimentation (sustenance) procurée par le combustible.
L’origine de la métaphore est physique ! Upadana est l’acte de s’attacher et l’objet saisi, qui ensemble entretiennent le processus par lequel la souffrance mentale apparaît. Dukkha est chaude et instable comme un feu, alors que l’acte mental de s’attacher à un des agrégats est ce qui alimente le feu. Cette image fait partie d’une plus vaste imagerie complexe du Canon, comparant les processus de dukkha et de sa cessation aux processus physique du feu et de son extinction. Dukkha comparée explicitement à une fièvre ou un feu brûlant et instable (cf. Ud 3.10 et Thig 8.1). D’autres textes donnent plus une imagerie indirecte, dans laquelle la terminologie pour expliquer le feu est appliquée à l’esprit (le terme upadana appartient à cette imagerie). D’autres incluent khandha, « tronc d’un arbre », et nibbana, l’extinction d’un feu. Pour la physique de l’époque de Bouddha, le feu était « saisi » quand il était en feu. Brûlant, il est en état d’agitation instable, attrapé par le combustible auquel il s’attache pour subsister. Disparaissant, il est « libéré ». Abandonnant le combustible, il se refroidit, devient calme et libre, indépendant (unbound). L’étude de dukkha est celle d’un feu ravageant : on l’étudie pour trouver la source de la flamme, et de le piéger pour éteindre le feu et s’en libérer.
Il y a 4 types d’upadana : désir et passion pour :
- La sensualité trouvée dans les agrégats ;
- Les vues concernant les agrégats ;
- Les pratiques et préceptes impliquant les agrégats ;
- Les théories concernant le soi impliqué dans les agrégats.
L’acte de s’attacher n’est ni le même que les agrégats ni entièrement séparés d’eux (Cf. MN 44 [MFU, pp. 44-45]) :
- S’il était identique à eux, on ne pourrait expérimenter les agrégats sans attachement, et ainsi il n’y aurait pas moyen pour un éveillé de retourner au plan de l’expérience conditionnée après son Eveil.
- S’il en était entièrement différent, il pourrait exister séparément des agrégats et compterait comme une partie séparée de l’expérience descriptible. Transcender les agrégats lors de l’Eveil ne reviendrait pas à transcender le monde conditionné (fabricated realm), et la tache de compréhension de dukkha ne serait alors par terminée.
L’interdépendance upadana/khandha signifie que la pleine compréhension des agrégats suffit à mener à l’Eveil, cependant qu’elle ouvre à l’expérience du monde conditionné après l’Eveil. Cette interdépendance signifie en termes pratiques qu’on doit examiner les agrégats de telle manière qu’on réalise pleinement qu’ils ne sont pas dignes qu’on s’y attache. Ce qui se fait en se concentrant sur 2 de leurs caractéristiques communes : instabilité et complexité. Voyant leur instabilité intrinsèque, on réalise qu’ils sont impermanents. Parce qu’ils sont impermanents, toute tentative de baser sur eux notre bonheur est intrinsèquement douloureuse, comme il est intrinsèquement stressant d’essayer de s’assoir confortablement sur une chaise vacillante. Parce que les agrégats ne fournissent aucune base pour un bonheur réel, ils sont au-delà de notre contrôle, et ainsi ne méritent pas d’être tenus pour « moi » ou « mien ». En se concentrant plus avant sur les agrégats, on perçoit la complexité de leurs relations mutuelles. Bien que ces agrégats fonctionnent de différentes manières, ils peuvent apparaitre dans l’expérience réelle uniquement comme parties d’un groupe d’événements mentaux environnants un objet. Ils sont si étroitement reliés les uns aux autres que la conscience ordinaire les tiens pour un tout unique. Une tes taches du discernement dans la compréhension de la peine est de voir ces agrégats en tant qu’événements interdépendants. Parce que leurs relations mutuelles suivent des lois complexes, invariables, la compréhension de leur véritable comportement apporte avec elle la réalisation oppressante – oppressante tant qu’on continue de regarder la chaîne causale en partie ou en totalité en termes de « soi » et d’« autre » – qu’ils sont ne se tiennent pas, ultimement, sous notre contrôle. Au mieux, on peut les explorer et manipuler au point de les comprendre et de s’en libérer, mais ils n’offrent en eux-mêmes et extérieurement aucune sorte de bonheur stable.
Observer et comprendre les relations mutuelles complexes entre sensation, perception et conscience mène au domaine de la production en dépendance, qui forme l’essence de la seconde noble vérité. Alors que notre compréhension devient plus profonde, cela révèle le fait que tout attachement à ces phénomènes interconnectés devrait être abandonné. Cette compréhension – que tout phénomène prenant part dans une telle relation n’est pas digne d’attachement – forme l’essence du chemin. La pleine poursuite de ce chemin, dans lequel on abandonne toute passion et tout désir pour les agrégats, apporte la connaissance de la cessation de dukkha. Tout cela confirme l’assertion de Gavampati (cf. Cf. SN 56.20) selon laquelle la connaissance de la 1ère Noble Vérité implique intrinsèquement la connaissance des 3 autres.
Dernière édition par Chaosophe le Sam 10 Oct, 2009 1:37; édité 1 fois |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Jérôme
Inscrit le: 15 Sep 2009
Messages: 5
|
 Posté le: Lun 28 Sep, 2009 9:50 Sujet du message: Posté le: Lun 28 Sep, 2009 9:50 Sujet du message: |
 |
|
| Peut-on dire que Viparinama-Dukkha est la charnière de Dukkha "Dukkha" ? Viparinama-Dukkha serait l'instant infime où je passe d'une condition "de bien être" a une condition "de souffrance". |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Chaosophe
Inscrit le: 13 Avr 2008
Messages: 125
|
 Posté le: Sam 10 Oct, 2009 1:42 Sujet du message: Posté le: Sam 10 Oct, 2009 1:42 Sujet du message: |
 |
|
Viparinama dukkha est sans doute le sens le plus profond de dukkha. Seulement, je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Viparinama dukkha concerne la "souffrance" qu'implique tout état conditionné, y compris les absorptions méditatives (jhana) - raison pour laquelle le Bouddha dit qu'elles sont impermanentes, dukkha et sujettes au changement (annicā dukkhā vipariṇāmadhammā, cf Mahâdukkhakkhandha-sutta, M I (PTS), p. 90). Autrement dit, des expériences qui peuvent servir de moyen en vue de l’Eveil, deviennent des formes de souffrance sitôt qu’elles sont considérées comme des fins en soi. Si l’expérience méditative constitue certes une des conditions nécessaires à l’apparition de la sagesse (pañña), elle reste pourtant accessible à l’être ordinaire (puthujjana), dénué de pénétration (vipassana), donc constitue finalement, du point de vue éveillé, une forme de dukkha. Celui qui connaît ces états est en effet généralement victime de l’illusion qu’ils provoquent : la croyance au bonheur éternel : « N’aspire pas à la félicité de l’au-delà. Une telle aspiration est ce que je nomme un flot tout dévorant (mahogha) » (Sn. 944-945).
Dernière édition par Chaosophe le Sam 10 Oct, 2009 1:44; édité 1 fois |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Chaosophe
Inscrit le: 13 Avr 2008
Messages: 125
|
 Posté le: Sam 10 Oct, 2009 1:43 Sujet du message: Posté le: Sam 10 Oct, 2009 1:43 Sujet du message: |
 |
|
| .. |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
cgigi2
Modérateur
Inscrit le: 02 Mar 2007
Messages: 793
|
 Posté le: Sam 10 Oct, 2009 5:29 Sujet du message: Posté le: Sam 10 Oct, 2009 5:29 Sujet du message: |
 |
|
Chaosophe dit:
| Citation: | | Viparinama dukkha est sans doute le sens le plus profond de dukkha |
gigi dit:
La définition de ce monde est tout simplement Dukka, qui n'entraine que des phénomènes agréables et désagréables,
la base même de ce monde est le Stress qui n'engendre que plaisirs et déplaisirs, la fréquence vibratoire de ce monde est le Stress;
seul Nibbana est la fin de ce Stress et jhana est la fonction la plus opposée à ce Stress, jhana est l'Oasis qui permet d'observer la frénésie inconsciente dans laquelle s'ébat le monde, ce Stress qui donne vie et mort simultannéement est comme une mer d'acide fumant, tout cet univers tant par sa beauté comme par sa laideur nous brûle, nous corode par ses plaisirs et ses tristesses, ce monde nous use et nous tue à l'infinie.
Nibbana est la fin de tout Stress
avec metta
gigi

_________________
Que tous soient en liaison
Avec les Bouddhas des Trois Temps
Passés, Présents et Futurs,
Ici et Maintenant. |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Chaosophe
Inscrit le: 13 Avr 2008
Messages: 125
|
 Posté le: Sam 10 Oct, 2009 14:43 Sujet du message: Posté le: Sam 10 Oct, 2009 14:43 Sujet du message: |
 |
|
Le monde est en effet dukkha, si l'on entend par "monde" non pas la réalité extérieure, mais l'expérience, "les 6 bases internes des sens". C'est du moins l'avis du Bouddha, lorsqu'il prononce ce que Bikkhu Bodhi nomme "la proposition la plus profonde de l’histoire de la pensée humaine » :
| Citation: | | "C'est, ami, dans cette carcasse d'un pied de long, doté de perception et d'esprit, que je fais connaitre le monde, l'origine du monde, la cessation du monde, et le chemin menant à la cessation du monde" (SN 2 : 26). |
Le commentaire pâli le confirme, lorsqu'il affirme que le Bouddha montre ceci : | Citation: | | « Je ne fais pas connaître ces 4 vérités dans les choses extérieures comme l’herbe et le bois, mais ici même dans ce corps composé des 4 grands éléments ». |
Bikkhu Bodhi précise que le "monde" est « ce par quoi dans le monde on est un percevant et concepteur du monde », c'est-à-dire les bases internes des sens, ou le monde de l'expérience.
Autrement dit, le monde extérieur, objectif, atomiquement constitué, N'EST PAS en lui-même dukkha : la souffrance n’appartient qu’à un point de vue, une perspective subjective sur le monde extérieur ; ce n'est pas une qualité intrinsèque aux "choses" extérieures. Preuve en est que :
| Citation: | | « Ce dont les autres parlent comme bonheur, cela les nobles en parlent comme "souffrance" (dukkha) ; ce dont les autres parlent comme "souffrance", cela les nobles le connaissent comme bonheur » (SN 35 : 136). |
Dans ce sens, la vérité de dukkha concerne la façon dont toutes les formes d’existence conditionnée apparaissent à un éveillé : en tant que « Noble Fait (ariya-sacca) », il s’agit de la façon dont un noble (arya) voit le monde. C'est pourquoi Vasubandhu note que, comparé au dukkha des êtres de la sphère infernale (nârakas), le dukkha des animaux paraît plaisant ; et comparé au dukkha du monde humain, le dukkha des êtres divins (devas) paraît plaisant (cf. Mahāvibhāṣāśāstra, L. M. PRUDEN, Abidharmakoṣabhāṣyam of Vasubandhu, 1988-90, III, p. 1044, n. 29). Il explique également que « les nobles se font de l’existence dans le ciel le plus sublime une idée plus douloureuse que ne s’en font les sots de l’existence dans l’enfer le plus épouvantable » (ibid., p. 900).
Il y a pourtant une tendance chez les bouddhistes à déprécier le "monde" extérieur, en disant que la réalité n'est que souffrance. Alors qu'elle n'est souffrance que pour les êtres ordinaires !
Je ne suis pas sûr que
| Citation: | | jhana (soit) la fonction la plus opposée à ce Stress |
En effet, les jhâna ne sont qu'un répit momentané, une manière d'insensibiliser l'appareil de perception de la souffrance ; c'est une forme de plaisir subtil, mais ce n'est encore que du plaisir - raison pour laquelle la plupart des religieux et des bouddhistes eux-mêmes sont accrocs aux jhâna ; mais dès que cesse l'expérience méditative, dès qu'on se lève de son coussin de méditation, dukkha revient ! C'est pourquoi l’Eveillé déclare que les jhâna sont impermanents, dukkha et sujets au changement (annicā dukkhā vipariṇāmadhammā, cf. Mahâdukkhakkhandha-sutta, M I (PTS), p. 90). En fait, les jhâna ne sont que des constructions de l'esprit :
| Citation: | « "Cela [tous les jhâna et les libérations de conscience] est fabriqué et voulu. Or tout ce qui est fabriqué et voulu est inconstant et sujet à cessation." Demeurant juste là, il atteint la fin des fermentations mentales » (SN XLV.4, Janussoni Brahmana Sutta).
« Dans cet enseignement, ô moines, le moine pénétre et reste dans le premier jhâna. Lorsqu'il émerge de cet état jhânique, il contemple, le corps physique, les sensations, les perceptions, les formations mentales et la conscience qui existent au moment de jhâna et il voit qu'ils sont transitoires, douloureux, non-substanciels. Voyant ainsi, il demeure avec cette vision profonde de vipassâna qu'il a obtenue et il atteint l'état d'arahant, la cessation de toute purulence. (AN 2 . 312) |
C'est l'attention (sati) qui permet de s'apercevoir de la nature conditionnée des extases, raison pour laquelle le Satipatthana sutta fait de l'attention "la seule et unique voie" qui mène à l'Eveil. Pour les meilleurs pratiquant, il est possible d'atteindre l'Eveil sans passer par la méditation (les jhâna) :
« Lorsque, Uttiya, fondé sur la tenue (sila), établi sur la tenue (sila), tu développes ces 4 établissements de l’attention de cette manière, tu iras au-delà du royaume de la Mort (Mara) » (SN 47 : 16).
En définitive, il faut bien voir que viparinama dukkha ne désigne pas l'instabilité du monde extérieur, des choses physiques, mais l'instabilité de la pensée. Il s’agit de l’inquiétude, l’instabilité, l’agitation mentale et la dispersion, liées à l’anxiété du désir et caractérisant l’esprit conditionné. Le Bouddha dénonce à cet égard « les préoccupations (vitakka) [qui] harassent l'esprit comme des garçons mènent un corbeau, ici et là », et « naissent de l'attachement (sneha) » (Sn. 279-2). L’anxiété du désir et l’automatisme de la pensée, leur caractère compulsif et non maîtrisé, sont l’objet de sa critique, car ils accroissent sans cesse le besoin d’appropriation :
« Ce qu'on éprouve, on le perçoit ; ce qu'on perçoit on s'en préoccupe (vitakketi) ; ce dont on se préoccupe, on en est obsédé (papañceti) ; de là les diverses obsessions (papañca) concernant les choses passées, futures et présentes connues au moyen d'une vision obsédée et infectée » (MN I.112).
L’instabilité qui préoccupe le Bouddha n’est pas celle des corps physiques, mais celle, beaucoup plus rapide, des états mentaux, « la vibration, commente Silburn, qui procède d'une succession ininterrompue de pensées ou états de conscience » (Instant et cause, p. 180) :
| Citation: | « Rien [n’est] de révolution aussi brève (lahu parivatta) que la pensée. Il n'est pas aisé d'illustrer avec quelle rapidité elle change » (A.N. 1.10).
« On voit le corps durer un an, cent ans, davantage, mais ce qui porte le nom de pensée (citta), d'esprit (manas), de conscience (vinnāna), de nuit, de jour, naît autre, périt autre [...] Comme un torrent de montagne il n'y a pas d'instant (khaṇa) [...] où la pensée se repose » (S.N. II.94 et A.N.IV.137) |
Ce que le Bouddha reproche à l’homme ordinaire est que « sa pensée ne tient pas en place » et « bat la compagne » (Dhp, § 37 et 3 . Précisément, il condamne dans cette attitude les énergies et les efforts tendus, inapaisés, donc en eux-mêmes gros d’un incessant tourment : . Précisément, il condamne dans cette attitude les énergies et les efforts tendus, inapaisés, donc en eux-mêmes gros d’un incessant tourment :
« La "douleur" (dukkha) suprême, ce sont les énergies intentionnelles (saṅkhārā) » (Dhp, § 203).
Leur instabilité ou leur « vibration » (vipariṇāma) désigne la coopération des tendances habituelles en vue d'une fin (l’appropriation). Ce processus implique une tension, une fluctuation incessante, synonyme d'inquiétude, d'agitation et de dispersion, qui réapparait continuellement parce qu’elle est alimentée par le désir et l'ignorance. La conscience est alors contrainte d’éprouver le temps sur le mode de la répétition cyclique et du perpétuel retour de l’insatisfaction (ce qu'on appelle "la routine", le "quotidien"). Reste que l’intérêt du Bouddha pour cette forme d’impermanence vient de ce qu’elle est la seule à laquelle il est possible de remédier :
« La pensée étant vibrante, fluctuante, oscillante, difficile à contrôler, qu'on la redresse par l'application comme le fléchier redresse (la flèche) grâce au feu » (U.V. 33).
De là la nécessité d’une discipline mentale d’auto-délivrance, grâce à laquelle l’esprit, « touché par les expériences, ne vibre pas (na kaṃpati), demeure sans chagrin et sans attachement » (Khuddaka pāṭha, VII). |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Chaosophe
Inscrit le: 13 Avr 2008
Messages: 125
|
 Posté le: Sam 10 Oct, 2009 14:47 Sujet du message: Posté le: Sam 10 Oct, 2009 14:47 Sujet du message: |
 |
|
| Je précise que j'ai commis une erreur : le sens le plus profond de dukkha n'est pas viparinama dukkha, mais sankhara dukkha, me semble-t-il... |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
cgigi2
Modérateur
Inscrit le: 02 Mar 2007
Messages: 793
|
 Posté le: Sam 10 Oct, 2009 16:30 Sujet du message: Posté le: Sam 10 Oct, 2009 16:30 Sujet du message: |
 |
|
Chaosophe dit:
| Citation: | | Autrement dit, le monde extérieur, objectif, atomiquement constitué, N'EST PAS en lui-même dukkha : la souffrance n’appartient qu’à un point de vue, une perspective subjective sur le monde extérieur ; ce n'est pas une qualité intrinsèque aux "choses" extérieures. Preuve en est que : |
gigi dit:
La souffrance n'appartient qu'à la croyance en ce monde tel qu'il est perçu, car en réalité la forme est Vide d'existence réelle
Chaosophe dit:
E | Citation: | n effet, les jhâna ne sont qu'un répit momentané, une manière d'insensibiliser l'appareil de perception de la souffrance ; c'est une forme de plaisir subtil, mais ce n'est encore que du plaisir - raison pour laquelle la plupart des religieux et des bouddhistes eux-mêmes sont accrocs aux jhâna ; mais dès que cesse l'expérience méditative, dès qu'on se lève de son coussin de méditation, dukkha revient ! C'est pourquoi l’Eveillé déclare que les jhâna sont impermanents, dukkha et sujets au changement (annicā dukkhā vipariṇāmadhammā, cf. Mahâdukkhakkhandha-sutta, M I (PTS), p. 90). En fait, les jhâna ne sont que des constructions de l'esprit :
|
gigi dit:
Oui bien sûr mais pour observer le Stress primordial de ce monde il faut s'en éloigner le plus possible, plus on développe Jhana plus les énergies deviennent subtiles, le simple fait d'expérimenter des énergies subtiles cela permet de faire la différence avec les énergies grossières et Sati peut être présente aussi en jhana, cela permet un va et vient sécuritaire et ne pas perdre de vue anata est très utile aussi 
avec metta
gigi

_________________
Que tous soient en liaison
Avec les Bouddhas des Trois Temps
Passés, Présents et Futurs,
Ici et Maintenant. |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Chaosophe
Inscrit le: 13 Avr 2008
Messages: 125
|
 Posté le: Sam 10 Oct, 2009 20:55 Sujet du message: Posté le: Sam 10 Oct, 2009 20:55 Sujet du message: |
 |
|
Je crois que nous sommes d'accord. Un bémol cependant. Vous affirmez que :
| cgigi2 a écrit: | | pour observer le Stress primordial de ce monde il faut s'en éloigner le plus possible |
Mais en un sens, comme vous le savez sans doute, il faut connaitre dukkha et l'affronter directement, plutôt que le fuir ou vouloir sa cessation : dukkha est en effet « la condition suffisante de la confiance (saddhā) », d’où provient « le bien-être (pāmojja) [...], la joie spirituelle (pīti) [...], l’apaisement (passadhi) [...], l’unification de l’esprit (samādhi) [...], la connaissance et la vision des choses telles qu’elles sont (yathā-bhūta-ñāṇa-dassana) » et, finalement, l’Eveil. Donc dukkha est la condition de l'Eveil ! Au contraire, paradoxalement, lorsqu'on souhaite à tout prix se libérer de dukkha, on en reste prisonnier :
| Citation: | | « N’aspire pas à la félicité de l’au-delà. Une telle aspiration est ce que je nomme un flot tout dévorant (mahogha) » (Sn. 944-945). |
Il me semble d'ailleurs qu'il y a une ambiguïté à cet égard dans les textes pâli : vouloir la fin du devenir, c'est-à-dire l'annihilationnisme (ucchedaditthi : « je ne devrais pas être [...] je ne serai pas", SN 24 : 4) -- est une attitude condamnée par le Bouddha, car elle résulte d'une vue fausse. Pourtant, Nibbâna est bien la fin du devenir, et l'annihilationnisme semble parfois recommandé par l'Eveillé :
| Citation: | | « "Cela ne devrait pas être et cela ne devrait pas être pour moi ; cela ne sera pas, [et] cela ne sera pas pour moi" : planifiant ainsi [adhimuccamāno], un moine peut trancher les 5 entraves inférieures » (SN 22 : 55). |
La formule décrivant l'aspiration à la fin du devenir apparaît dans 2 versions :
- Il y a la version des annihilistes. Il s'agit d'une vue fausse, mais c'est aussi "la plus haute des vues spéculatives extérieures [au Dhamma] (etadaggam bāhirakānam ditthigatānam)" (AN V 63). Car celui qui pense ainsi ne sera pas attaché à l’existence ni réfractaire à la cessation de l’existence.
- Il y a la version du Bouddha, qui transforme cette formule en un thème de contemplation. Dans sa formule, il remplace les verbes à la première personne ("je ne devrais pas être...") dans leur équivalent à la troisième personne ("cela ne devrait pas être..."). C'est la solution du paradoxe : le Bouddha préconise un annihilationnisme impersonnel, dépourvu de croyance au moi.
En définitive, il ne faut pas fuir la souffrance, mais la traiter directement. Vouloir la fin de la souffrance est une cause de souffrance lorsque cette volonté vient de la croyance au moi, c'est-à-dire de l'envie de se protéger, de trouver la sécurité. Mais lorsqu'on vise la fin de la souffrance non pour protéger un hypothétique égo, mais seulement pour faire apparaître des états sains, alors cette volonté est la voie vers l'Eveil. Soyons donc prudent lorsque nous pensons qu'il faut "s'éloigner de la souffrance le plus possible". On peut paraître extérieurement "bouddhiste" tout en recherchant à protéger le prétendu "moi" de la souffrance, pour libérer ce prétendu "moi". A l'inverse, un vrai bouddhiste ne recherche pas la sécurité personnelle : il s'expose entièrement à la souffrance et ne la nie pas, mais veut la connaitre, lutter directement contre elle et en triompher. Vous remarquerez que, malheureusement, la majorité des auteurs et des maîtres soi-disant "bouddhistes" sont en fait de annihilationnistes : ils fuient la souffrance et souhaitent sa cessation, parce qu'ils n'arrivent pas à la supporter. En fait l'Eveil n'est pas vraiment l'absence totale de souffrance : le Bouddha a ressenti de la douleur physique lorsqu'il s'est pris un rocher sur le pied (cf la tentative d'attentat par Devadatta) ; il lui arrivait de tomber malade (SN 47 : 9), alors que la maladie fait partie de la définition de dukkha (SN 56 : 11) ; et lorsque ses disciples préférés mourraient, il lui semblait que le monde était devenu vide... L'Eveil est plutôt la capacité de ressentir la souffrance comme un stimulant pour la force de notre volonté (c'est-à-dire, d'après un texte déjà cité, comme "la condition de la confiance", du bien-être et de la joie...). |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
cgigi2
Modérateur
Inscrit le: 02 Mar 2007
Messages: 793
|
 Posté le: Sam 10 Oct, 2009 22:29 Sujet du message: Posté le: Sam 10 Oct, 2009 22:29 Sujet du message: |
 |
|
Chaosophe dit:
| Citation: | Au contraire, paradoxalement, lorsqu'on souhaite à tout prix se libérer de dukkha, on en reste prisonnier :
|
gigi dit:
Il ne faut pas perdre de vue que Jhanas font parties de ce Samsara, donc dukkha est aussi partie intégratante de jhana, ne serais-ce que par son impermanence, il n'est pas question ici de fuir mais de se positionner pour une observation adéquate, un point de comparaison par la vision pénétrante ...
Chaosophe dit:
| Citation: | Il me semble d'ailleurs qu'il y a une ambiguïté à cet égard dans les textes pâli : vouloir la fin du devenir, c'est-à-dire l'annihilationnisme (ucchedaditthi : « je ne devrais pas être [...] je ne serai pas", SN 24 : 4) -- est une attitude condamnée par le Bouddha, car elle résulte d'une vue fausse. Pourtant, Nibbâna est bien la fin du devenir, et l'annihilationnisme semble parfois recommandé par l'Eveillé :
|
gigi dit:
Effectivement cela est peut-être une mauvaise traduction, car c'est en temps futur, pas logique 
Pour bien observer dukkha il est bon de lâcher prise sur dukkha, plus il y a lâcher prise sur toutes choses, plus la vision est profonde et pénétrante, ne laisser aucun objet obstruer le rayonnement de l'Esprit même pas dukkha 
avec metta
gigi

_________________
Que tous soient en liaison
Avec les Bouddhas des Trois Temps
Passés, Présents et Futurs,
Ici et Maintenant. |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Chaosophe
Inscrit le: 13 Avr 2008
Messages: 125
|
 Posté le: Dim 11 Oct, 2009 3:14 Sujet du message: Posté le: Dim 11 Oct, 2009 3:14 Sujet du message: |
 |
|
| cgigi2 a écrit: | | cela est peut-être une mauvaise traduction, car c'est en temps futur, pas logique |
Pourquoi n'est-il pas logique que cela soit au futur ? Je ne suis pas sûr de vous comprendre. |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
cgigi2
Modérateur
Inscrit le: 02 Mar 2007
Messages: 793
|
 Posté le: Dim 11 Oct, 2009 7:27 Sujet du message: Posté le: Dim 11 Oct, 2009 7:27 Sujet du message: |
 |
|
Chaosophe dit:
| Citation: | | Pourquoi n'est-il pas logique que cela soit au futur ? Je ne suis pas sûr de vous comprendre. |
gigi dit:
| Citation: | | « je ne devrais pas être [...] je ne serai pas", SN 24 : 4) -- |
Tout simplement parce qu'il est inconcevable de parler de Nibbana dans un sens à venir...
l'accès à Nibbana ne peut-être nul part ailleur qu'Ici et Maintenant
La fin de tout Stress ne s'effectue, qu'Ici et Maintenant, croire que l'on peut avoir accès à Nibbana dans plusieurs années oû même demain ne peut que nous en obstruer l'accès, le temps et Nibbana ne font pas bon ménage 
avec metta
gigi

_________________
Que tous soient en liaison
Avec les Bouddhas des Trois Temps
Passés, Présents et Futurs,
Ici et Maintenant. |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Jérôme
Inscrit le: 15 Sep 2009
Messages: 5
|
 Posté le: Dim 11 Oct, 2009 13:33 Sujet du message: Posté le: Dim 11 Oct, 2009 13:33 Sujet du message: |
 |
|
| Chaosophe a écrit: | | Viparinama dukkha est sans doute le sens le plus profond de dukkha. Seulement, je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Viparinama dukkha concerne la "souffrance" qu'implique tout état conditionné, y compris les absorptions méditatives (jhana) - raison pour laquelle le Bouddha dit qu'elles sont impermanentes, dukkha et sujettes au changement (annicā dukkhā vipariṇāmadhammā, cf Mahâdukkhakkhandha-sutta, M I (PTS), p. 90). Autrement dit, des expériences qui peuvent servir de moyen en vue de l’Eveil, deviennent des formes de souffrance sitôt qu’elles sont considérées comme des fins en soi. Si l’expérience méditative constitue certes une des conditions nécessaires à l’apparition de la sagesse (pañña), elle reste pourtant accessible à l’être ordinaire (puthujjana), dénué de pénétration (vipassana), donc constitue finalement, du point de vue éveillé, une forme de dukkha. Celui qui connaît ces états est en effet généralement victime de l’illusion qu’ils provoquent : la croyance au bonheur éternel : « N’aspire pas à la félicité de l’au-delà. Une telle aspiration est ce que je nomme un flot tout dévorant (mahogha) » (Sn. 944-945). |
Pardonnez moi je n'avais pas vu que vous aviez répondu à ma question -_- en fait je ne parle pas de Samkhara Dukkha (qui est l'état conditionné ) mais de Viparinama Dukkha qui est "la souffrance du au changement" par exemple tout état de joie est aussi Viparinama Dukkha puisque tôt ou tard il disparaitra. |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Chaosophe
Inscrit le: 13 Avr 2008
Messages: 125
|
 Posté le: Dim 11 Oct, 2009 15:12 Sujet du message: Posté le: Dim 11 Oct, 2009 15:12 Sujet du message: |
 |
|
| L'erreur vient de moi, parce que je traduis, dans le poste que vous citez, viparinama dukkha par "la souffrance qu'implique tout état conditionné" : j'ai confondu avec sankhara dukkha... |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Chaosophe
Inscrit le: 13 Avr 2008
Messages: 125
|
 Posté le: Dim 11 Oct, 2009 15:39 Sujet du message: Posté le: Dim 11 Oct, 2009 15:39 Sujet du message: |
 |
|
| cgigi2 a écrit: | il est inconcevable de parler de Nibbana dans un sens à venir...
l'accès à Nibbana ne peut-être nul part ailleur qu'Ici et Maintenant [...] croire que l'on peut avoir accès à Nibbana dans plusieurs années oû même demain ne peut que nous en obstruer l'accès, le temps et Nibbana ne font pas bon ménage |
Il me semble que vous avez tout à fait raison. Je rejoins ce que vous dites dans mon poste sur Nibbâna en tant que fin du temps psychologique. Pourtant, les choses restent obscures pour moi : il est vrai qu'aspirer anxieusement au Nibbâna comme à un "ailleurs" que l'on ne rejoindra que dans le futur, aux prix d'efforts soucieux et tendus, est la meilleure façon de ne pas connaître NIbbâna. Pourtant, le Bouddha emploie lui-même le temps futur, dans une citation que j'ai déjà donnée : « "Cela ne devrait pas être et cela ne devrait pas être pour moi ; cela ne sera pas, [et] cela ne sera pas pour moi" : planifiant ainsi [adhimuccamāno], un moine peut trancher les 5 entraves inférieures » (SN 22 : 55).
Et comme je l'ai déjà indiqué dans un autre poste, il y a une véritable volonté d'Eveil, un désir (chanda) d'Eveil qui est un désir sain et habile (kusala)... Donc il faut véritablement aspirer à l'Eveil comme à un état futur, en reconnaissant que le présent que l'on vit est dukkha ; pourtant il ne faut pas que cette aspiration provienne du refus de dukkha, du refus du présent, et de l'espoir anxieux d'un avenir meilleur.
De la même manière, il est vrai que l'Eveil est obtenu "dans cette vie même", "ici et maintenant" comme disent les textes. Pourtant, Nibbâna n'est pas ici et maintenant, il n'est pas déjà là : ce qui est là est dukkha, et Nibbâna n'est pas dukkha. C'est pourquoi les textes semblent placer Nibbâna en dehors de l'espace et du temps, par exemple lorsque le Bouddha affirme avoir
| Citation: | | "connu la mesure de ce qui n’a pas été expérimenté à travers la totalité du tout » (SN 35 : 23). |
Le Bouddha parle également d'une
| Citation: | | « Conscience sans surface (viññanam anidassanam : « sans caractéristiques », ou « sans distinctions »), sans fin, lumineuse tout autour, [et qui] n’a pas été expérimentée à travers la cohésion de la terre [et les autres éléments]", ni « à travers la totalité du tout ». |
Cette conscience est comparable, disent les textes, à une lumière qui ne se pose nulle part, parce qu’il n’y a pas d’obstacle : de même | Citation: | | « lorsqu’il n’y a pas de plaisir, de soif, alors la conscience ne s’établit pas ici ni ne croît [...] les phénomènes physiques et mentaux (nâma-rûpa) ne s'établissent pas [...] il n’y a pas de croissance des fabrications [...] il n’y a pas production d’un devenir dans le futur », ni de souffrance. |
Autrement dit, la conscience ordinaire est expérimentée parce qu’elle a une « surface » contre laquelle elle s’établit : les organes des sens et leurs objets, qui constituent le « tout » (on expérimente la conscience visuelle à cause de l’œil et de la forme dont on est conscient). Au contraire, la "conscience sans surface" est connue directement, sans intermédiaire, indépendamment de toutes conditions. Qu’elle soit en dehors du « tout » (les 6 organes des sens et leurs objets) signifie qu'elle est en dehors de l’espace et du temps, en une dimension où il n’y a pas d’ici, de là, ou d’entre-deux (Ud I, 10), ni allée, ni venue, ni séjour (Ud VIII.1). On ne peut donc pas dire qu'elle soit permanente ou omniprésente (termes qui n’ont de sens que dans l’espace-temps) - et c'est ce qui distingue le bouddhisme de l'hindouisme... Cette conscience n'est pas celle qui connaît Nibbana, parce qu'elle serait alors distincte de lui ; tandis que les textes la décrivent en utilisant des termes synonymes de Nibbâna (par exemple, comme le lieu où les phénomènes physiques et mentaux trouvent leur fin, DN 11) ; et surtout, Nibbana ne peut pas être un objet de conscience mentale, un phénomène, par exemple un objet de l’intellect, car il ferait alors partie du « tout » (Nibbâna est plutôt "la cessation de la conscience" mentale). La "conscience sans surface" est en fait un pur synonyme de Nibbâna : comme lui, elle est connue sans médiation. |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
|
|
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
|
|