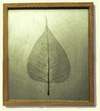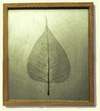 |
Forum Mettâ
Bouddhisme originel
|
| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
thanatos
Web

Inscrit le: 06 Aoû 2006
Messages: 138
|
 Posté le: Lun 04 Déc, 2006 21:09 Sujet du message: Qu'est-ce que le Theravâda ? Posté le: Lun 04 Déc, 2006 21:09 Sujet du message: Qu'est-ce que le Theravâda ? |
 |
|
La première chose qui frappe lorsqu’on cherche à se renseigner sur le bouddhisme, c’est la diversité des approches proposées. Entre bouddhisme tibétain, bouddhisme zen/chan et bouddhisme Theravâda, il est bien souvent difficile de s’y retrouver. Chaque courant semble soutenir des points de vue différents et bien souvent inconciliables entre eux, ce qui génère régulièrement des tensions et des débats enflammés entre les pratiquants de traditions différentes (hé oui, le bouddhisme n’est pas épargné).
Un petit rappel de l’évolution du bouddhisme semble donc nécessaire afin de mieux comprendre ce qui distingue le Theravâda des autres courants bouddhistes.
Le Theravâda
Le bouddhisme est né dans le nord de l’Inde il y a environ 2500 ans lorsque l’ascète Gotama réalisa l’Éveil et commença à enseigner aux gens comment se libérer de la souffrance et de l’insatisfaction (dukkha). Durant plus de 40 ans, il ne cessa de donner ses enseignements et ses conseils à tout ceux qui le souhaitaient. Après son parinibbâna, ses enseignements furent conservés et transmis oralement tels quels pendant plusieurs siècles par ses disciples avant d’être finalement mis par écrit. Pendant des siècles, une grande majorité des disciples du Bouddha sont restés fidèles à ces enseignements, les considérant comme complets et parfaits (puisqu’ils émanaient d’un être Éveillé ayant une compréhension parfaite des choses) et refusant d’y apporter la moindre modification. Pour cette raison, cette tradition est désignée sous le nom de Theravâda, ou de Tradition des Anciens, et les enseignements du Bouddha selon les anciens textes constituent la seule et unique source utilisée par ces disciples.
Les principales caractéristiques de ce courant bouddhiste sont qu’il explique comment accéder soi-même à la délivrance en devenant un arahant (personne délivrée parce qu'elle a suivi la voie enseignée par le Bouddha), qu'il met l’accent sur la pratique personnelle, qu'il rejette catégoriquement l'idée d'un dieu créateur, éternel et tout puissant, l’idée d’une âme individuelle et/ou universelle ainsi que l'idée d'un salut obtenu par la seule dévotion et le culte des reliques.
Le Mahâyâna
A partir du 2e siècle de l’ère chrétienne, un second courant bouddhiste commença à s’affirmer. Il se distingue du précédent sur plusieurs points :
La vacuité : si l’idée d'absence d’existence propre et indépendante (anatta ou non-soi, vacuité) constitue déjà un élément essentiel du bouddhisme originel, ce concept se trouve développé à l’extrême par ce nouveau courant bouddhiste.
Un enseignement secret révélé : pour les tenants de cette tradition, les enseignements du Bouddha ne sont pas complets. Une partie aurait été cachée car le Bouddha estimait que l’humanité n’était pas prête à recevoir ces enseignements. Ces enseignements cachés auraient ensuite été révélés à certains maîtres bouddhistes et seraient à l’origine de cette nouvelle tradition bouddhiste qui se désigne sous le nom de Mahâyâna, le Grand Véhicule, par opposition au Hînayâna ou Petit Véhicule (indiquant ainsi qu’il est incomplet selon eux).
| Citation: | | Position du Theravâda : Cette affirmation apparaît en contradiction avec les paroles du Bouddha telles que rapportées par les textes anciens, Celui-ci a répété à plusieurs reprises que rien n’avait été gardé secret et que tout ce qu’il avait à enseigner l’avait été (« rien n’a été gardé dans le poing fermé »). Les bouddhistes theravâdins considèrent que les enseignements du Bouddha tels qu’ils sont conservés et transmis par l’ancienne Tradition sont complets et ne nécessitent aucun ajout supplémentaire. |
Les Trois Corps du Bouddha : le Bouddha n’est plus un simple humain ayant atteint la connaissance par ses propres moyens mais l’émanation d’un Bouddha Cosmique qui possède un Corps de Création (Nirmâna-kâya) correspondant au corps terrestre du Bouddha, un Corps de Jouissance (Sambhoga-kâya) qui correspond à un corps supra-mondain et un Corps de la Loi (Dharma-kâya) qui est le corps ultime du Bouddha.
| Citation: | | Position du Theravâda : pris au sens strict, cette conception s’oppose aux enseignements du Bouddha qui a toujours refusé qu’on le considère comme un surhomme ou qu’on le déifie. Il a aussi toujours rejeté les notions d’absolu et de réalité ultime, les considérant comme des idées fausses nées de l’ignorance. Certains voient cependant ces Trois Corps comme une métaphore symbolisant les Trois Joyaux présents dans le bouddhisme Theravâda, à savoir le Bouddha, le Dhamma (son enseignement) et la Sangha (la communauté de renonçants) et ne devant donc pas être pris au sens strict. |
Panthéon de Bouddhas : En plus du bouddha historique, de nombreux bouddhas du passé font leur apparition et deviennent des figures de premier plan. Certaines écoles du Mahâyâna s’éloignent du bouddha historique pour ne se concentrer que sur un de ces bouddhas du passé (Vairocana ou Amitabha par exemple).
| Citation: | Position du Theravâda : Si le Bouddha Gotama a effectivement mentionné l’existence de bouddhas passés (et futur), ils n’ont jamais occupés le premier plan des enseignements (un seul discours leur est consacré en détail, le Mahâpadâna Sutta). La raison est que, tout les bouddhas enseignant la même chose (la cessation de la souffrance et de l’insatisfaction), l’enseignement d’un seul bouddha Parfait (Sambuddha) est suffisant. De plus, un bouddha étant une personne qui atteint l’Éveil et la connaissance par ses propres moyens (c’est à dire sans se baser sur les enseignements d’un autre bouddha), il ne peut apparaître que si l’enseignement du bouddha précédent à été complètement oublié. Il est par conséquent impossible de se référer aux enseignements d’un bouddha antérieur.
Une interprétation symbolique est néanmoins possible, chacun de ces bouddhas personnifiant en réalité un principe bouddhiste (compassion, bienveillance, non-soi/vacuité, Éveil…) |
L’idéal du Bodhisatta : la tradition Mahâyâna développe également à l’extrême les principes de compassion et de bienveillance présent dans les enseignements du bouddha. Le but du pratiquant n’est plus son propre Éveil mais l’Éveil de tout les êtres. Pour cela, il renonce temporairement à la cessation de dukkha afin d’aider les autres à l’atteindre également. Dans son immense bonté, il accepte même de soulager la souffrance des autres en l’endurant à leur place. Tel est l’idéal du bodhisatta.
| Citation: | Position du Theravâda : Cet idéal est noble et ne fait que suivre l’exemple du Bouddha, qui a renoncé temporairement à nibbana pour enseigner aux hommes. Cela ne peut cependant être fait efficacement qu’à condition d’avoir soi-même réalisé l’Éveil afin de pouvoir guider correctement les autres. La pratique individuelle prônée par le Theravâda n’apparaît donc pas comme une pratique égoïste (critique souvent faite par les mahâyânistes), mais comme une étape indispensable qui doit être accomplie avant d’envisager toute aide à l’humanité (attention cependant de ne pas tomber dans les pièges subtils de l’ego en se rêvant Sauveur de Tout les Êtres).
Par contre, l’aspect rédempteur que prend le bodhisatta est en contradiction avec les paroles du Bouddha. Il a toujours insisté sur le fait qu’il appartenait à chacun de se libérer de la souffrance par ses actes et que personne ne pouvait le faire à notre place. Il exhortait ses disciples à "être un refuge pour eux-mêmes" et à ne jamais chercher refuge ou aide auprès d'un autre (« On est son propre refuge, qui d'autre pourrait être le refuge » [Dhammapada, XII, 4]). Cela signifie qu'on ne peut attendre de personne l'obtention de l'illumination, il faut chercher en soi-même la vérité et pour atteindre ce but suivre le Noble Sentier Octuple.
Cet aspect du bodhisatta sauveur de l’humanité présente aussi les même risques de dérives que les autres religions à sauveur (christianisme, judaïsme, etc…), à savoir déresponsabiliser les gens, minimiser les efforts à faire et renforcer les pratiques rituelles et dévotionnelles (à quoi bon faire des efforts pour avoir une conduite vertueuse puisque quelqu’un « encaisse » mes mauvaises actions et fait le boulot à ma place par compassion pour moi ? Il suffit donc de faire le minimum d’efforts et d’aller ensuite « marchander » une rédemption auprès du bodhisatta en échange de quelques prières et rituels). |
Le Vajrayâna
A partir du 8e siècle de l’ère chrétienne, le bouddhisme Mahâyâna est introduit progressivement en Inde et au Tibet. Au cours de cette période, il incorpore de nouveaux éléments provenant de courants religieux divers :
Tantrisme : pratiques ésotériques et magico-religieuses permettant d’arriver à des réalisations surnaturelles et spirituelles au moyen de rites (tantras), de gestes (mudras) et de syllabes (mantras) magiques.
Shaktisme : pratique axée sur le culte de divinités féminines. Ce courant est issu de l’hindouisme et des notions d’énergie créatrice (la Shakti). Chaque bouddha et bodhisatta du panthéon mahâyâniste se voit ainsi associé à une figure féminine (l’exemple le plus connu est Vajrayogini, la compagne du bodhisatta Avalokiteshvara et l’équivalent bouddhiste de la shakti hindouiste Kali). L’union sexuelle du bodhisatta et de sa compagne leur permet d’accéder à l’union éternelle.
Le Bön ou Bonpo : religion tibétaine regroupant diverses pratiques animistes et chamaniques (méditation, divination, magie rituelle, communication avec les esprits, exorcisme...).
| Citation: | Position du Theravâda : le Bouddha n’a pas manqué de souligner de son vivant l’inefficacité et l’inutilité des pratiques religieuses rituelles et dévotionnelles (Janussoni Sutta, Sonadanda Sutta). L’attachement aux préceptes et pratiques diverses est d’ailleurs considéré par le Bouddha comme une entrave à la libération dont le pratiquant doit impérativement se débarrasser s’il veut progresser. En outre, la nécessité de recourir à l’union sexuelle pour parvenir à la libération est en totale contradiction avec l’abstinence sexuelle prônée par le Bouddha.
Par conséquent, toutes les pratiques rituelles du bouddhisme tibétain apparaissent comme une aberration au vu des enseignements originels du Bouddha, à moins de les considérer une fois de plus comme une représentation complexe et hautement symbolique des enseignements, chaque divinité personnifiant un aspect bien précis de la Doctrine. Une compréhension claire des enseignements n’est alors possible qu’avec la clé ou les clés permettant de décoder tout ces symboles. |
En conclusion, si toutes les Traditions s’accordent sur les principes de base du bouddhisme (caractère impermanent et insatisfaisant des phénomènes, absence d’existence propre (anatta/non-soi/vacuité), origine de dukkha, cessation de dukkha, moyen de parvenir à la cessation (la Voie à Huit Branches ou Octuple Sentier)), elles se distinguent par la façon de les présenter et de les enseigner ainsi que par la forme que prend la pratique. Aucune de ces Traditions ne pouvant être considérée comme meilleure ou pire qu'une autre, il appartient à chacun de choisir la "mise en forme" qui lui convient le mieux. Les bouddhistes theravâdins ont choisis la forme originelle des enseignements, tels qu'ils ont été présentés par le Bouddha lui-même de son vivant.
avec Metta
_________________
buddham saranam gacchami dhammam saranam gacchami sangham saranam gacchami
Dernière édition par thanatos le Mer 06 Déc, 2006 2:47; édité 3 fois |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
tirru...

Inscrit le: 02 Aoû 2006
Messages: 424
|
 Posté le: Lun 04 Déc, 2006 22:23 Sujet du message: Re: Qu'est-ce que le Theravâda ? Posté le: Lun 04 Déc, 2006 22:23 Sujet du message: Re: Qu'est-ce que le Theravâda ? |
 |
|
| thanatos a écrit: | | toutes les Traditions s’accordent sur les principes de base du bouddhisme...Les bouddhistes theravâdins ont choisis la forme originelle des enseignements, tels qu'ils ont été présentés par le Bouddha lui-même de son vivant. |
Excellente introduction Thanatos, qui met parfaitement en lumière les grands axes des enseignements des différentes écoles, mais aussi la spécificité du bouddhisme originel.
Avec Mettâ |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
cgigi2
Invité
|
 Posté le: Lun 04 Déc, 2006 23:53 Sujet du message: Posté le: Lun 04 Déc, 2006 23:53 Sujet du message: |
 |
|
Je trouve aussi cet exposé très concis et complet à la fois, toutefois en ce qui concerne les mantras, je ne pense pas que l'ont puissent vraiment les associer à la magie,
Dans le théravada il y a certain son ou nom de Bouddha comme Buddho par exemple qui sont utiliser comme mantras et même Metta est utiliser, ce ne sont que des moyens habiles qui procurent certains types de concentration, souvent ce que l'ont ne comprend pas est reléguer au niveau ésotérique oû magique,
------------------------------------
Définition de la méditation avec mantra
On dit que le mot « mantra » a une racine signifiant « ce qui protège l'esprit ».
Dans la méditation bouddhiste, de nombreuses choses peuvent être utilisées comme objets de concentration, comme « protecteurs de l'esprit ». Ainsi on porte son attention sur la respiration (anapanasati), sur les sensations provoquées par le contact des pieds avec le sol dans la méditation en marche, sur les émotions dans la pratique du metta bhavana (développement de la bienveillance) et sur des images dans les exercices de visualisations. Les mantras sont des sons, des mots ou des phrases utilisés comme objets de concentration.
Ces sons peuvent être psalmodiés à voix haute ou écoutés intérieurement. Les mantras sont parfois associés à des personnages historiques ou des archétypes mais ce n'est pas nécessairement le cas. Par exemple, il existe des mantras associés au Bouddha historique (Om muni muni maha muni Shakyamuni svaha), et à la figure mythique d'Avalokiteshvara (Om mani padme hum). Le mantra de la Prajñaparamita (Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha) n'est pas associé à un personnage éveillé mais à des enseignements du Bouddha connus sous le nom de Soûtras de la Prajñaparamita ou Perfection de la Sagesse. Le mantra Om shanti shanti shanti (Om paix, paix, paix) n'est associé, pour autant que je le sache, à aucune figure particulière, et l'expression en pali Sabbe satta sukhi hontu (Puissent tous les êtres atteindre le bonheur) est psalmodiée comme un mantra, sans être non plus associée à un personnage particulier. :)
avec metta
gigi
 |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
sebastien billard
Inscrit le: 13 Aoû 2006
Messages: 70
Localisation: Lille
|
 Posté le: Mar 05 Déc, 2006 0:27 Sujet du message: Posté le: Mar 05 Déc, 2006 0:27 Sujet du message: |
 |
|
Les mantras s'ils sont utilisés pour s'attirer des bénédictions, ou envoyer des "ondes" etc sont des pratiques rituelles et ou magiques, donc pas vraiment utiles.
A la rigueur je crois, mais je laisse un vénérable ou un pratiquant plus avancé que moi me corriger le cas échéant, qu'un mantra peut être un objet, un signe pour les méditations de type samatha, mais il ne s'agit que de pratiques visant à stabiliser l'esprit.
J'aimerai également revenir sur le prétendu égoisme du Theravada : c'est une vue complètement fausse. Ce que le Theravada dit, c'est que pour aider les autres, on doit d'abord s'assurer de sa propre situation : on ne plonge pas dans les sables mouvants pour sauver quelqu'un qui y est embourbé. D'ailleurs quand Buddhagosa expose le Visuddhimagga, il dit bien qu'il le fait "pour le bien de tous les êtres" et cet ouvrage est authentiquemen theravadin.
_________________
Sébastien
http://s.billard.free.fr/dotclear
http://s.billard.free.fr/bouddhisme
http://s.billard.free.fr/sadhu |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
cgigi2
Invité
|
 Posté le: Mar 05 Déc, 2006 4:38 Sujet du message: Posté le: Mar 05 Déc, 2006 4:38 Sujet du message: |
 |
|
| sebastien billard a écrit: |
J'aimerai également revenir sur le prétendu égoisme du Theravada : c'est une vue complètement fausse. Ce que le Theravada dit, c'est que pour aider les autres, on doit d'abord s'assurer de sa propre situation : on ne plonge pas dans les sables mouvants pour sauver quelqu'un qui y est embourbé. D'ailleurs quand Buddhagosa expose le Visuddhimagga, il dit bien qu'il le fait "pour le bien de tous les êtres" et cet ouvrage est authentiquemen theravadin. |
Tu as tout à fait raison, et je suis bien placée pour en parler, depuis que je suis en contact avec vous tous ici, combien de fois je me suis sentis comblée de toute la générosité et la patience que j'ai reçus, et tous ces merveilleux Enseignements qui m'ont été offerts avec tant de soins, je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arriver de toute ma vie de vous connaître, de connaître aussi Dalai-Lama,
c'est une fausse notion qui semble être véhiculer et une mauvaise compréhention des Enseignements par certaines personnes, mais je pense que ceux qui pratiquent sérieusement,tant le mahayana que le théravada comprennent très bien l'aspect copmpatissant de Précieux Gautama Bouddha, il me semble que c'est évident, si ça n'avait pas été le cas, il n'aurait sans doute pas transmit le Dhamma. :)
Pour ce qui est des Mantras, il faut savoir qu'ils existent une multitudes de mantras, qui sont d'ailleurs appliquer à toutes les sauces, c'est un phénomène de superstition, en Inde il y a des mantras pour presque toutes les situations de la vie quotidienne, mais les mantras dont ils est question ici, je dirais que ce sont de nobles mantras si bien utilisés, peuvent êtres très utiles, dans plusieurs situations, c'est un peu comme des outils qui peuvent nous ammener à des racourcis en quelque sorte :)
avec metta
gigi[/color]
 |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
thanatos
Web

Inscrit le: 06 Aoû 2006
Messages: 138
|
 Posté le: Mer 06 Déc, 2006 2:46 Sujet du message: Posté le: Mer 06 Déc, 2006 2:46 Sujet du message: |
 |
|
J'ai déjà posté ma réponse sur Nangpa, mais je la remets ici pour ceux qui ne fréquente pas ce site. Désolé pour ceux qui fréquentent les deux 
Gigi, il semble y avoir une double utilisation des mantras. Initialement, un mantra est bien une formule magique et les sons qui le composent sont censés avoir une puissance propre permettant à la personne qui les récite d'acquérir certains pouvoirs. Mantra signifie d'ailleurs "formule sacrée".
Cependant, ces sons semblent avoir perdu leur caractère magique dans certaines traditions et sont devenus de simples objets de concentration pour la méditation de type samatha comme l'a fait remarquer Sébastien. Celà rejoint donc ta définition.
avec metta
_________________
buddham saranam gacchami dhammam saranam gacchami sangham saranam gacchami
Dernière édition par thanatos le Mer 06 Déc, 2006 15:56; édité 3 fois |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Dhamma
Ascète

Inscrit le: 18 Oct 2006
Messages: 70
Localisation: Birmanie
|
 Posté le: Mer 06 Déc, 2006 14:55 Sujet du message: Re: Qu'est-ce que le Theravâda ? Posté le: Mer 06 Déc, 2006 14:55 Sujet du message: Re: Qu'est-ce que le Theravâda ? |
 |
|
| thanatos a écrit: | | par opposition au Hînayâna ou Petit Véhicule (indiquant ainsi qu’il est incomplet selon eux). |
En pali, hína ne signifie pas "petit" mais "mauvais". ("Petit" se dit cúla.)
_________________
http://dhammadana.org | http://dhammadana.fr
C'est en renonçant qu'on devient renonçant. |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
viriya
Web

Inscrit le: 27 Juil 2006
Messages: 601
Localisation: idf
|
 Posté le: Jeu 07 Déc, 2006 0:35 Sujet du message: Posté le: Jeu 07 Déc, 2006 0:35 Sujet du message: |
 |
|
à propos de yâna (véhicule) :
"Ananda, le noble véhicule 'Brahma yana',
le véhicule des enseignements 'Dhamma yana'
et l'incomparable véhicule de la victoire dans la bataille (sur les souillures) 'anuttaro sangama vijaya'
ne sont que des noms différents pour désigner la Noble Voie Octuple (Ariya Magga)".
Janussoni Brahmana Sutta (Samyutta Nikaya XLV.4)
voir aussi post de tirru - véhicule pour Nibbana.
_________________
avec metta
viriya |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
|
|
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
|
|