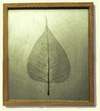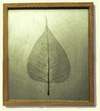 |
Forum Mettâ
Bouddhisme originel
|
| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
Chaosophe
Inscrit le: 13 Avr 2008
Messages: 125
|
 Posté le: Dim 06 Juin, 2010 18:36 Sujet du message: Socrate bouddhiste ! Posté le: Dim 06 Juin, 2010 18:36 Sujet du message: Socrate bouddhiste ! |
 |
|
| Citation: | "quand on dit de chaque être vivant qu’il vit et qu’il reste le même – par exemple, on dit qu’il reste le même de l’enfance à la vieillesse –, cet être en vérité n’a jamais en lui les mêmes choses. Même si l’on dit qu’il reste le même, il ne cesse pourtant, tout en subissant certaine pertes, de devenir nouveau, par ses cheveux, par sa chair, par ses os, par son sang, c'est-à-dire par tout son corps.
Et cela est vrai non seulement de son corps, mais aussi de son âme. Dispositions, caractères, opinions, désirs, plaisirs, chagrins, craintes, aucune de ces choses n’est jamais identique en chacun de nous ; bien au contraire, il en est qui naissent, alors que d’autres meurent. […] C'est en effet de cette façon que se trouve assurée la sauvegarde de tout ce qui est mortel ; non pas parce que cet être reste toujours exactement le même à l’instar de ce qui est divin, mais parce que ce qui s’en va et qui vieillit laisse place à un être nouveau, qui ressemble à ce qu’il était. Voilà par quel moyen [...] ce qui est mortel participe à l’immortalité, tant le corps que tout le reste » (Platon, Banquet, 207c-208a) |
| Citation: | | « Tout l’univers est en mouvement, et il n’y a rien en dehors de cela [...] Il résulte de tout cela […] que rien n’est un en soi, qu’une chose devient toujours pour une autre et qu’il faut retirer de partout le mot être, bien que nous-mêmes nous ayons été forcés souvent, et tout à l’heure encore, par l’habitude et l’ignorance, de nous servir de ce terme. Mais il ne faut pas, disent les sages, concéder qu’on puisse dire "quelque chose", ou "de quelqu'un", ou "de moi", ou "ceci", ou "cela", ou tout autre mot qui fixe les choses ; il faut dire, en accord avec la nature, qu’elles "sont en train de devenir, de se faire, de se détruire, de s’altérer" ; car si, par sa façon de parler, on représente une chose comme stable, on s’expose ainsi à être aisément réfuté. Il faut donc suivre cette règle et à propos des objets particuliers et à propos de collections d’objets nombreux, auxquelles on donne le nom d’homme, de pierre, d’animal et d’espèce […] rien n’existe, mais que le bien, le beau et tout ce que j’ai énuméré tout à l’heure est dans un perpétuel devenir » (Socrate, in Platon, Théétète, 157 b-c). |
N'est-il pas beau de voir que Socrate connaissait la doctrine d'anattâ ?!  |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Pieru
Web

Inscrit le: 17 Jan 2007
Messages: 256
Localisation: France sud
|
 Posté le: Dim 06 Juin, 2010 21:44 Sujet du message: Posté le: Dim 06 Juin, 2010 21:44 Sujet du message: |
 |
|
Merci Chaosophe.
C'est en effet très intéressant. J'apprécie beaucoup Socrate.
De nombreux philosophes ont eu l'intelligence de prendre en compte le dhamma, les choses telles qu'elles sont.
La plus ancienne école philosophique Grecque:
| Citation: |
L'école de Milet : thalès (env. 600 Av. J-C)
La première question se posa à peu près ainsi :
"Qu'y a-t-il donc qui persiste à travers tout le changement?"
La première réponse philosophique donnée à cette question fut la suivante : c'est la substance qui persiste dans tout ce qui change et ne cesse de passer.
(...)
"Quelle est la substance qui persiste à travers le changement?"
(...), c'est l'eau, l'air, le feu, ou même l'infini, ..."
L'étonnement Philosophique - Jeanne Hersch |
_________________
"Qui connait la nature connait le Dhamma". |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Chaosophe
Inscrit le: 13 Avr 2008
Messages: 125
|
 Posté le: Mar 08 Juin, 2010 1:12 Sujet du message: Posté le: Mar 08 Juin, 2010 1:12 Sujet du message: |
 |
|
| Jeanne Hersch est une philosophe formidable ! Ce qui est intéressant est que vous voyez une forme de bouddhisme dans la croyance des présocratiques en une substance permanente (eau, terre, etc.) ! Cela ne va pas de soi, mais il est vrai qu'on peut interpréter cette idée de cette façon : dire que seule l'eau (Thalès) ou le feu (Héraclite) persiste à travers les changements du monde, c'est d'une certaine façon dénoncer toutes les choses composées (de feu, d'eau, etc.) comme étant des constructions fictives, des sankhâra ! Et c'est vrai que beaucoup de présocratiques ont quelque chose de bouddhsite : Héraclite, par exemple, a bien compris l'impermanence (anicca), lorsqu'il dit qu'"on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve" ; il ne cesse de dire que la vie humaine est comme un rêve dont il s'agit de "s'éveiller"... |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Pieru
Web

Inscrit le: 17 Jan 2007
Messages: 256
Localisation: France sud
|
 Posté le: Mar 08 Juin, 2010 18:16 Sujet du message: Posté le: Mar 08 Juin, 2010 18:16 Sujet du message: |
 |
|
Bonjour Chaosophe,
Si vous le voulez bien on peut se tutoyer.
Il y a quelque temps j'ai un peu étudié la part de Dhamma que l'on peut trouver dans "la philosophie". Mais cette entreprise est très vaste, et on peut se perdre en chemin  . Ce qui est notable c'est que les philosophes, souvent, tournent autour du Dhamma, en tout cas du point de vue central qui est le notre (!) La vertu par exemple est une qualité récurrente. . Ce qui est notable c'est que les philosophes, souvent, tournent autour du Dhamma, en tout cas du point de vue central qui est le notre (!) La vertu par exemple est une qualité récurrente.
Et il me semble que tu pourrait éclairer ma lanterne avec tes connaissances!
Je ne dirais pas que les présocratiques étaient "Bouddhistes", mais que certaines de leurs conceptions s'en approche. De même un petit peu plus tard, Epicure et sa "modération", et qui à défaut de quatre Nobles Vérités énonce le quadruple remède. 
D'ailleurs on dit que les "Atomistes" ont trouvé les bases de leur philosophie auprès de maitres Indiens...
Quid de cette affirmation :
Thèse : être, antithèse : non-être, synthèse : devenir.
(...)
Qui fait écho à anicca et au kamma.
Amicalement
_________________
"Qui connait la nature connait le Dhamma". |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Chaosophe
Inscrit le: 13 Avr 2008
Messages: 125
|
 Posté le: Sam 12 Juin, 2010 18:48 Sujet du message: Posté le: Sam 12 Juin, 2010 18:48 Sujet du message: |
 |
|
| Citation: | | « les philosophes, souvent, tournent autour du Dhamma » |
Je suis tout à fait d’accord sur ce point, et cela ne cesse de m’étonner ! Je fais également des recherches personnelles pour repérer « la part de Dhamma que l'on peut trouver dans "la philosophie" », et bien que je trouve beaucoup de choses, il me semble que les philosophes restent toujours à côté de la plaque… Par exemple, la plupart des philosophes ont vu l’impermanence (anicca), l’absence de moi (anatta) ou la souffrance (dukkha), mais la très grande majorité d’entre eux réintroduisent quelque part une forme de permanence, de moi ou de « bonheur »… Je crois que le plus bouddhiste des philosophes est Nietzsche, puisqu’il reconnait l’impermanence (« tout est fluctuant, insaisissable, évanescent »), l’absence de moi (cf. Par-delà bien et mal, § 16-17), et la souffrance (le « nihilisme », la « décadence »). Nietzsche, qui voulait être "le Bouddha d'Europe", s’inspire d’Héraclite (surnommé « l’Obscur »), qui disait qu’« on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve », parce que ce sont toujours de nouvelles eaux qui s’écoulent ; tout comme l’instructeur Araka (qui selon le Canon pali vivait dans un « passé obscur ») comparait la vie humaine à « une rivière de montagne qui [...] va sans cesse coulant et continuant » (AN 7.70)… Héraclite est un présocratique oriental (d'Asie mineure) dont la doctrine est très proche du bouddhisme, puisqu’il dit que nous sommes comme endormis, mais que les « meilleurs » des hommes (les aristoi) sont « éveillés », comme le disait le Bouddha au sujet des êtres nobles (ariya). La plupart des philosophes n’ont pas compris l’impermanence parce qu’ils croyaient en Dieu, de même qu’ils n’ont pas compris l’absence de moi parce qu’ils croyaient à l’âme et à la substance. C'est le cas dans la métaphysique, qui a été traditionnellement une étude de « l’Etre » (une « ontologie »), et une compréhension de l’Etre comme « substance », « essence », ou « créature » de Dieu. Heidegger, un des derniers grands philosophes, a le mérite d’avoir dénoncé cette tradition métaphysique ; mais il définit pourtant la réalité comme « être », et l’être comme « présence » ou « durée » ! Mais contre cette tradition « dogmatique », il y a toujours eu des esprits libres et originaux (Héraclite, Pyrrhon, Epictète, Montaigne, Pascal, Nietzsche, Bergson), qui ont contesté les notions d’« être », d’« essence », « substance », « unité », « moi », « sujet », etc. C'est ce qui explique que les philosophes occidentaux ont pu soutenir des propos parfois tout à fait conformes au Dhamma tel qu’il est conservé dans le Canon pali, comme par exemple :
| Citation: | « Ce moi de vingt ans n’est plus moi » ; « Finalement, il n’y aucune constante existence, ni de notre être, ni de celui des objets » ; « l'humaine nature est toujours au milieu entre le naître et le mourir » ; « Notre veillée est plus endormie que le dormir » (Montaigne)
« Toutes choses changent et se succèdent » ; « Où est donc ce moi, s'il n'est ni dans le corps, ni dans l'âme ? » (Pascal)
« il n'y a point de force en nous par laquelle nous puissions subsister ou nous conserver un seul moment » (Descartes)
« Tous les corps sont dans un flux perpétuel comme des rivières ; et des parties y entrent et en sortent continuellement » ; « Ce qui est composé de parties ne peut passer, à parler exactement, pour une substance, pas plus qu’un troupeau » (Leibniz)
« Il n'y a pas de choses, il n'y a que des actions » ; « Tout change intérieurement, et la même réalité concrète ne se répète jamais » (Bergson)
« Notre moi, indépendamment de la perception de quelque autre objet, n’est rien en réalité » ; « Ce que nous appelons un esprit n’est qu’un amas, ou une collection de différentes perceptions » ; « Ce nom d’unité n’est qu’une dénomination fictive » ; « La fiction d’une existence continue [...], tout comme l’identité, est fausse, ainsi que le reconnaissent tous les philosophes » (Hume) |
Tu as tout à fait raison de remarquer la ressemblance entre les quatre Nobles vérités et le quadruple remède (tétrapharmacon) d’Epicure ; de même Pascal demande « quelle religion enfin nous enseignera [...] les faiblesses qui nous détournent [de notre bien], la cause de ces faiblesses, les remèdes qui les peuvent guérir, et le moyen d’obtenir ces remèdes ». Mais les rapports entre philosophie occidentale et philosophie orientale sont très complexes : celle-ci a rejeté celle-là pendant longtemps ; et le peu que les philosophes occidentaux savent du bouddhisme provient généralement de Schopenhauer ou de Nietzsche, qui étaient très mal documentés. Les contresens de Nietzsche au sujet du Bouddhisme sont sans doute une cause majeure de l’échec de la philosophie occidentale depuis plus d’un siècle : sans cela, les philosophes auraient pu cesser de croire à l’unité, la permanence et l’identité. Mais malgré le désaccord d’opinions entre les occidentaux et les orientaux, il y a un accord fondamental sur les principes : tous les Grecs reconnaissent que, si une chose change, si elle est composée, ou si elle est dépendante, elle n’« est » rien, à proprement parler, mais elle « devient », puisque le « devenir » est un juste milieu entre l’« être » et le « non-être » (le néant). Le « devenir » est l’image occidentale de la « vacuité ». Hegel dit parfaitement que le devenir est une synthèse d’être et de non-être : la « science de la logique » consiste à partir de l’Etre, et en reconnaissant que l’Etre en général n’est aucun être en particulier, admettre que l’Etre s’identifie au néant, et donc qu’il faut penser le passage incessant de l’être au non-être, c'est-à-dire le devenir. Le « devenir » a toujours été synonyme de destruction, « corruption », ou altération, c'est-à-dire le fait de se changer en autre chose, donc de n’être pas véritablement soi-même. C'est pourquoi les Grecs s’entendent généralement à dire que rien ne nait ni ne meurt, n’apparait ni ne disparait :
| Citation: | « Ni la genèse ni la destruction ne sont permises [...] Ainsi disparaissent la genèse et la mort inexplicables [...] la genèse et la destruction ont été, bannies au loin » (Parménide).
« Tout est et n’est pas » (Héraclite).
« "Aucun être n’a une nature (c'est-à-dire une existence propre), mais il y a seulement mélange et séparation du mélange ; et la nature n’est qu’un nom donné par les hommes" » (Empédocle).
« Rien n'existe » (Zénon d'Élée)
« L’Etre n’est rien » (Gorgias)
|
De même la plupart des philosophes s’accordent à dire que tout est causé ou causant, et même à dire qu’il n'y a pas d’existence sans interdépendance :
| Citation: | « Sans pouvoir de communication, rien ne participerait à la réalité existante » (Platon)
« Il faut se penser comme membre du tout » ; « Les parties du monde ont toutes un tel rapport et un tel enchainement l’une avec l’autre que je crois impossible de connaître l’une sans l’autre et sans le tout » (Pascal).
« Dans la relation, chaque terme est autre sans être autre chose » (Augustin).
« L’influence de toutes les choses de l’univers les unes sur les autres[/b] » fait que « l’individualité enveloppe l’infini » (Leibniz)
« La réalité consiste exactement en cette action et réaction de chaque individu à l’égard du tout » (Nietzsche).
« L'individualité du corps se résorbe dans l'universelle interaction qui est sans doute la réalité même ». (Bergson).
« Tout ce qui est mondain est dépendant » (Husserl).
« La moindre chose est liée au tout » (Alain) |
Il me semble que lorsque les philosophes parlent de l’unité de toutes choses, l’unité du Tout, il veulent dire que rien n’a d’existence séparée :
| Citation: | « Toutes choses sont une » (Héraclite)
« Le Tout est un » (Parménide)
« Tout est un » (Thalès)
« Tout est un tout est divers. Tout est un, mais l'un est dans l'autre [...] Que de natures en celle de l'homme » (Pascal) .
« Tout ne forme qu’une seule et même chose » (Fichte) |
Le problème est que, comme je l’ai dit, la plupart (sinon tous ?) des philosophes réintroduisent une forme d’unité, de permanence ou d’autonomie… Et surtout, la philosophie occidentale n'est plus, comme dans l'antiquité et dans le bouddhisme, un mode de vie dirigé vers le bonheur ou la vertu, mais une discipline théorique ou fondée sur la pensée théorique. C'est pourquoi la philosophie occidentale ne tient pas compte du bouddhisme, qui offre pourtant des interrogations très proches des siennes. La philosophie occidentale était à l'origine proche du bouddhisme, car les présocratiques étaient pour la plupart des orientaux ; mais elle s'en est éloigné par la suite, en raison de l'influence du christianisme ; elle s'en est rapproché au 19è siècle, en raison de Schopenhauer et de Nietzsche, mais les contresens de ces auteurs concernant le bouddhisme a provoqué la rechute de la philosophie dans la spéculation abstraite, puisqu'elle est devenue une pensée du langage (Heidegger, Wittgenstein, etc.). Je garde pourtant confiance dans le fait qu'un jour apparaitront des philosophes nouveaux, qui montreront comment la tradition a toujours cru, fondamentalement, à la permanence, l'unité et l'indépendance, et comment la réalité est en fait fugace, multiple et interdépendante  |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Pieru
Web

Inscrit le: 17 Jan 2007
Messages: 256
Localisation: France sud
|
 Posté le: Dim 13 Juin, 2010 7:57 Sujet du message: Posté le: Dim 13 Juin, 2010 7:57 Sujet du message: |
 |
|
Merci pour ces réflexions. Je vois en effet que ton approche de la philo est plus avancé que la mienne.
La position des bouddhistes n'est pas évidente à première vue car justement ils ne peuvent se "reposer" sur rien (pas de dieu, pas d'être infini, pas d'âme). Mais l'élément transcendant du monde -découverte du Bouddha, est nibbana. Si les philosophes possédaient cet élément comme expérience, ils auraient de fait compris les trois caractéristiques du monde phénoménal. (Mais ils ne l'ont même pas comme notion "juste").
Alors ils ont du composer avec cette notion omniprésente (aussi à cause de la religion) : Dieu.
Dieu et l'être, comme tu le fait remarquer, qui fait dire à Descartes : "Je pense donc je suis"; ou bien qui "prouve" dans ses méditations l'existence de Dieu. (...)
Nous pouvons noter (en étudiant le dhamma, et pratiquant la méditation) combien les croyances et les convictions qui naissent dans l'illusion (première des sens) peuvent influencer, modifier et fausser la compréhension de la réalité (dhamma).
D'un autre coté grâce au dhamma de Bouddha, les disciples vont de plus en plus vers l'allègement de l'être : c'est la voie de la libération.
Anatta, anicca et dukkha sont les clés de la voie.
On trouve en effet (et c'est normal je pense), des éléments du dhamma dans chaque philosophie, comme ceux que tu as cité.
Comme autre philosophe intéressant, il y a Spinoza.
Notamment son "approche" de l'omniprésence du désir dans l'être, et de la vertu qui est source de "bonne conscience" en soi.
Après bien sûr il y a "la substance", qui est "nature" et "dieu", et on trouve quelque chose d'éternel en l'esprit...
Les philosophes ont souvent voulu discourir sur "tout", l'ensemble.
Alors que ...
| Citation: | "On mesure l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitudes qu'il est capable de supporter."Emmanuel Kant
|

| Citation: |
Je garde pourtant confiance dans le fait qu'un jour apparaitront des philosophes nouveaux, qui montreront comment la tradition a toujours cru, fondamentalement, à la permanence, l'unité et l'indépendance, et comment la réalité est en fait fugace, multiple et interdépendante Wink |
Peut être connait-tu Roger-Pol Droit?
_________________
"Qui connait la nature connait le Dhamma". |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Chaosophe
Inscrit le: 13 Avr 2008
Messages: 125
|
 Posté le: Mar 15 Juin, 2010 22:00 Sujet du message: Posté le: Mar 15 Juin, 2010 22:00 Sujet du message: |
 |
|
Je connais effectivement Roger Pol-Droit pour son travail sur L'Oubli de l'Inde, livre légitime et efficace. Mais ce qui me trouble est que les grands philosophes de la tradition qui se sont intéressé à l'Inde (Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger) sont "passés à côté" du bouddhisme, pour ainsi dire. Hegel va jusqu'à dire que l'Orient ne connait pas la liberté intérieure, et Schopenhauer et Nietzsche interprètent le bouddhisme comme nihilisme ! Je crois que c'est cette accusation de nihilisme qui fait aujourd'hui consensus parmi les philosophes - accusation d'ailleurs tout à fait erronée... Quant à Husserl, il qualifie le Bouddha de "proto-phénomélogue", ce qui revient à la fois à reconnaitre son mérite et à minimiser ses découvertes, alors que le bouddhisme présente une phénoménologie (une étude des vécus de conscience) extrêmement élaborée. Du coup, l'étude du bouddhisme revient à des universitaires érudits (Silburn, Schterbatsky, Bareau, Chenet, etc) parfaitement ignorés par leur collègues :( Il reste bien des préjugés à briser au sujet du bouddhisme !
| Citation: | | « Quelle dose de vérité un esprit sait-il supporter, sait-il risquer ? Voilà qui, de plus en plus, devint pour moi le vrai critère des valeurs. L’erreur (la croyance en l’idéal) n’est pas aveuglement, l’erreur est lâcheté… » (Nietzsche). |
|
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Pieru
Web

Inscrit le: 17 Jan 2007
Messages: 256
Localisation: France sud
|
 Posté le: Dim 27 Juin, 2010 19:40 Sujet du message: Posté le: Dim 27 Juin, 2010 19:40 Sujet du message: |
 |
|
Roger Pol-Droit à d'ailleurs écrit un nouveau livre : Le silence de Bouddha. (Que je n'ai pas lu).
On peut se demander jusqu'à quel niveau la réflexion philosophique est utile et à quoi elle aboutie réellement, surtout lorsque l'on franchit les "déserts d'opinions" dont parle Bouddha.
Ce qui peut réunir à un certain niveau les philosophes et les disciples de Bouddha, c'est le "juste milieu des choses" ou la voie médiane.
Et la recherche de la sagesse...
Cependant le disciple possède un élément qui fait défaut chez les penseurs, -et qui est même vécu comme un empêchement, c'est la foi (dans le triple joyaux) développée grâce à panna.
Amicalement
_________________
"Qui connait la nature connait le Dhamma". |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Pieru
Web

Inscrit le: 17 Jan 2007
Messages: 256
Localisation: France sud
|
 Posté le: Dim 26 Déc, 2010 14:33 Sujet du message: Posté le: Dim 26 Déc, 2010 14:33 Sujet du message: |
 |
|
Après lecture du silence de Bouddha, et approfondissement de la philosophie de Schopenhauer, il semble que ce soit sa pensée qui est la plus proche du Bouddhisme, par rapport à Nietzsche.
Ceci sur deux points principaux : il croyait en la cessation de la souffrance par l'annihilation du désir (apparemment contrairement à Nietzsche), et avait une profonde compassion et sympathie pour tous les êtres vivants (contrairement à Nietzsche).
"Sa pensée présente des coïncidences nombreuses, et presque miraculeuses, avec les doctrines fondamentales de la philosophie bouddhiste." E. Conze.
_________________
"Qui connait la nature connait le Dhamma". |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
|
|
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
|
|