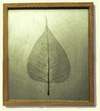cgigi2
Modérateur
Inscrit le: 02 Mar 2007
Messages: 793
|
 Posté le: Dim 11 Avr, 2010 3:05 Sujet du message: VIPASSANA : Une pratique de méditation ou une traditions ? Posté le: Dim 11 Avr, 2010 3:05 Sujet du message: VIPASSANA : Une pratique de méditation ou une traditions ? |
 |
|
Textes Choisis
VIPASSANA : Une pratique de méditation ou une traditions ? - par Gil Fronsdal
Cet article est adapté d'un texte qui a été publié dans le numéro d'automne 2001 du magazine américain Tricycle. Il cherche à cerner ce que pourrait être la pratique bouddhiste au sein du mouvement vipassana dans les dix prochaines années.
Au cours de votre lecture, gardez à l'esprit que l'auteur se réfère principalement au contexte anglo-saxon du développement du mouvement vipassana en Occident. L'Europe en général est moins touchée par le phénomène décrit ici. Il n'est pas éxagéré de dire que la France est même restée à l'écart de ce mouvement d'envergure. Cet article a été publié en français dans le magazine bouddhiste Samsara.
Les 30 dernières années ont vu croître la communauté Vipassana occidentale de façon exponentielle, et tout indique que cela va continuer. Dans cet article, Gil Fronsdal s'interroge sur les développements du Vipassana pour les dix années à venir.
Le terme Vipassana signifie voir clairement, en profondeur; il est souvent traduit par "vision claire", "vue pénétrante", "intelligence introspective". Le Maître Vietnamien Thich Nhat Hanh le traduit par "regard profond". Traditionnellement, il fait référence à la compréhension intuitive, obtenue par la méditation, de la nature impermanente (anicca), insatisfaisante (dukkha) et dépourvue de centre (anatta) de notre expérience. Couplé à samatha, le calme mental, Vipassana permet de découvrir la réalité des choses telles qu'elles sont, libérée de nos perceptions habituelles et confuses.
La pratique du Vipassana joue un rôle central dans le processus riche et complexe destiné à atteindre la Libération que développe la tradition Theravada du bouddhisme, présente essentiellement en Thaïlande, en Birmanie et au Sri Lanka.
Dans le passé, de nombreuses méthodes ont été enseignées pour promouvoir la pratique du Vipassana. Mais l'une d'entre elles a plus particulièrement séduit l'Occident : c'est la pratique de la conscience introspective et de la présence éveillée, le développement de notre capacité à voir avec lucidité et de façon détachée dans le présent. C'est la méthode à laquelle les Occidentaux se réfèrent majoritairement lorsqu'ils emploient le mot Vipassana, et c'est à elle que je me réfère dans cet article.
Quand Vipassana est synonyme de conscience éveillée, cette notion fait abstraction des doctrines, rituels et institutions religieuses. Le terme désigne une eau claire et transparente qui épouse la forme du contenant dans lequel elle coule.
Au fur et à mesure que la pratique s'est implantée en Occident, la notion de Vipassana s'est progressivement détachée de son contexte Theravada. En Amérique du Nord, non seulement les origines Theravada du Vipassana, mais également son contexte bouddhiste d'origine sont devenus accessoires.
En raison de la fluidité du Vipassana, l'un des développements majeurs, et en même temps très controversés de la prochaine décennie, pourrait être la naissance d'une nouvelle forme de bouddhisme, appelée bouddhisme Vipassana. Pour s'en convaincre, il suffit de constater que les trois traditions méditatives les plus populaires parmi les pratiquants occidentaux d'Amérique du Nord sont aujourd'hui le Zen, le Vajrayana et le Vipassana, la tradition Theravada étant rarement mentionnée.
Pour les nouveaux pratiquants, le Vipassana semble d'ores et déjà constituer une tradition faisant jeu égal avec les deux autres, alors qu'à l'origine il ne s'agit que d'une pratique de méditation. Avec le temps, il n'est pas exclu que le Vipassana acquière le statut de tradition.
Ce que j'appelle bouddhisme Vipassana prend sa source dans la manière généreuse et non-sectaire avec laquelle la pratique Vipassana est enseignée en Amérique du Nord depuis plus de trente ans. Beaucoup de ceux qui se seraient peut-être détournés de la pratique bouddhiste sont attirés par cet aspect d'ouverture. Dépouillé de ses éléments theravada, l'esprit cuménique de nombreux étudiants et enseignants les conduit à enrichir le bouddhisme Vipassana d'éléments issus d'autres traditions comme le Zen, le Vajrayana, l'hindouisme, voire la psychologie occidentale et la tradition Theravada elle-même.
Je considère ce développement comme une étape susceptible de transformer le bouddhisme Vipassana en une tradition à part entière. Nul ne peut prédire à ce stade quels éléments perdureront dans les années à venir, mais le processus mérite toute notre attention.
Ce n'est pas la première fois que le sens d'un mot désignant une forme de méditation évolue pour prendre le sens d'une tradition bouddhiste. Cela s'est déjà produit avec le Zen :
Le mot Zen est la prononciation japonaise du mot chinois Ch'an, qui lui-même est la traduction du mot sanskrit Dhyana, qui signifie méditation. Nul n'a tenté de créer intentionnellement l'école Zen, mais lorsque cette branche du bouddhisme a présenté des caractéristiques suffisamment distinctes, elle a été reconnue comme une tradition à part entière. De la même manière, bien que nul ne cherche à créer la tradition Vipassana, je sens tout un courant de forces qui convergent pour la faire émerger.
De même que le Zen est composé de lignées et d'écoles indépendantes, un bouddhisme Vipassana ne sera pas monolithique. Chacun des nombreux groupes vipassana devra composer avec les tensions inhérentes à l'émergence de tout nouveau groupe spirituel : tenants de la tradition contre tenants de l'innovation, esprit d'insularité contre esprit d'ouverture, choix de coopération contre défense farouche de l'indépendance, principes égalitaristes contre structure hiérarchique
Certains groupes seront plus proches du bouddhisme Theravada que d'autres, qui tendront plus vers une approche bouddhiste cuménique.
Au-delà de la prévisible émergence d'un bouddhisme Vipassana, nous pouvons observer une large adaptation des pratiques fondamentales du Vipassana, telles que la pratique de la conscience éveillée et la vision profonde, dans des contextes non bouddhistes.
Dès aujourd'hui, des Chrétiens, des Juifs, des Hindouistes, s'approprient ces pratiques et les enseignent dans leurs lieux de culte respectifs. Ces pratiques sont également offertes dans des prisons, des écoles et des entreprises ; elles sont prescrites médicalement comme moyen pour soulager la douleur et le stress, voire pour amener une transformation psychologique.
Je suis convaincu de l'efficacité de la pratique vipassana dans ces divers contextes et j'imagine que, d'ici dix ans, se développeront de nombreuses autres formes d'application de la technique, tant et si bien que beaucoup de gens n'auront plus aucune conscience des origines bouddhistes de leurs pratiques. Certains regrettent cette situation et déplorent le fait qu'en Amérique du Nord, le Vipassana ait emprunté des voies de traverse. Ils craignent une acculturation de la tradition bouddhique et l'oubli de son message radical de libération.
Je ne vois pas les choses de cette façon. Je suis plutôt heureux de voir que les bienfaits de la pratique bouddhiste profitent au plus grand nombre: tout soulagement de la souffrance me semble souhaitable et bienvenu. D'autant que ces bienfaits sont mutuels : dès lors que les avantages procurés par la pratique de la conscience éveillée sont reconnus par un large public, cette reconnaissance suscite en retour un soutien à ceux qui optent pour une pratique plus approfondie.
Après tout, en Asie, les gens entretiennent traditionnellement des relations très complexes avec le bouddhisme. Ceux qui suivent la voie authentique de la libération sont peu nombreux, mais leur pratique est soutenue par l'ensemble de la communauté au sein de laquelle ils se trouvent. Je crois qu'il y aura toujours des gens pour choisir d'adapter leur vie à la Voie plutôt que d'adapter la Voie à leur vie.
Les applications séculières de la pratique bouddhiste ne me gênent pas outre mesure, parce que je suis convaincu que la source primordiale qui alimente la culture occidentale continuera à être bouddhiste. En effet, les enseignements bouddhistes sur la libération continueront à être le principal facteur motivant ceux et celles qui explorent la grande variété de techniques et méthodes offertes par la voie du Vipassana. De plus, les lieux où ils recevront le meilleur soutien pour une pratique intensive du Vipassana resteront certainement les centres de retraite bouddhistes et les monastères.
De nombreux monastères Theravada, des centres de retraite vipassana, des communautés autour des centres de méditation urbains, et même des maisons de retraite vipassana sont actuellement en projet de construction. Dans dix ans, beaucoup d'entre eux seront achevés. Il y aura des endroits pour des retraites longues et silencieuses et des endroits pour l'intégration des valeurs et principes bouddhistes dans la vie quotidienne. D'autres encore serviront de centres pour ceux qui souhaitent s'investir au niveau social et dans la société en général. Je vois dans cette diversité une riche expression de la grande créativité liée à la pratique bouddhiste.
Une autre raison qui me fait croire que vipassana continuera à s'abreuver aux sources de la tradition bouddhiste est la découverte dans les dix prochaines années des textes anciens des discours du Bouddha.
De bonnes traductions de ces textes ne sont disponibles que depuis dix ou quinze ans. A mesure que nous nous imprégnons de ces textes, nous découvrons une richesse et une variété des enseignements que nous ne soupçonnions pas. Dans les dix années à venir, ces enseignements constitueront un corpus de référence qui nous aidera à distinguer les enseignements originels du Bouddha des interprétations et adaptations occidentales. Cette nouvelle donnée donnera sans doute lieu à des débats et discussions qui promettent d'être passionnants.
Je m'attends également à ce qu'un plus vaste éventail de pratiques traditionnelles fasse son apparition au sein de la communauté vipassana. L'introduction de la pratique de l'amour bienveillant envers soi-même et autrui (Metta), confirme cette tendance. Il y a vingt ans, cette pratique était en effet quasiment inconnue des cercles vipassana nord-américains. On la réservait aux cérémonies de clôture des retraites spirituelles. Aujourd'hui, elle est devenue une pratique essentielle du mouvement vipassana. De même que beaucoup de pratiquants ont recours à la pratique de Metta pour faciliter l'accès aux états d'absorptions (Dhyana), on assiste à un intérêt croissant pour le développement du pouvoir de la concentration, dont l'un des avantages est traditionnellement de favoriser le développement de la vision profonde et de la conscience éveillée (Vipassana).
Les liens entre le Vipassana et ses sources bouddhistes se trouveront également renforcés par le nombre croissant d'Occidentaux qui entrent dans la tradition monastique Theravada. Certains ont reçu l'ordination monastique en Asie, mais les pratiquants sont de plus en plus nombreux à prendre les vux monastiques en Occident. Ces nouveaux ordonnés pourront d'une part intégrer la profondeur des enseignements traditionnels au contexte de la culture occidentale qui leur est familier. Leur présence apportera d'autre part à une communauté majoritairement laïque la dimension monastique, si présente en Asie mais encore balbutiante en Occident.
En guise de conclusion, je dirais que dans dix ans il y aura sans doute dans la communauté laïque un nombre beaucoup plus important de pratiquants du Vipassana qui auront atteint une grande maturité dans leur pratique. Les pratiquants actuels, qui ont déjà vingt à trente années de pratique, en auront dix de plus et sur le plan de la pratique comme sur celui des accomplissements, ils auront mûri d'autant.
Ceux qui débutent aujourd'hui pourront par conséquent s'appuyer sur l'expérience collective de leurs aînés. On peut d'ores et déjà observer que des synergies apparaissent parmi les pratiquants : au fur et à mesure que les anciens approfondissent leur expérience, il devient plus aisé pour les nouveaux venus de leur emboîter le pas. Je suis convaincu que cette synergie va se poursuivre, voire se renforcer.
En considérant les voies de développement multiples qu'empruntent les pratiques vipassana et les groupes vipassana, j'entrevois déjà des points de discorde.
Déjà des désaccords apparaissent concernant les mérites relatifs de confier l'enseignement à des laïcs plutôt qu'à des moines, ou de dispenser un enseignement basé sur un prix fixé à l'avance plutôt que sur le don comme c'est l'usage en Asie, ou encore sur ce qui constitue le degré acceptable d'adaptation de l'enseignement traditionnel aux besoins occidentaux.
Espérons que ces différents points de vue ne créeront pas de division au sein de la Sangha. Un moine thaïlandais qui m'avait beaucoup impressionné par sa sérénité et que je questionnais sur ses réalisations me répondit : un esprit non polémique et non querelleur. Pour que le mouvement Vipassana demeure une source d'inspiration en Occident, il lui faudra absolument préserver cet esprit non querelleur.
Traduction Daniel Millès, octobre 2001
Gil Fronsdal
Gil Fronsdal est titulaire d'un Doctorat en Etudes bouddhiques de l'Université de Stanford. Il a reçu la transmission Zen dans la lignée de Susuki Roshi. Il enseigne le Vipassana au Spirit Rock Center et à l' Insight Meditation Center de Pala Alto, Californie.
http://www.vipassana.fr/Textes/GilFronsdalVipassana.htm
avec metta
gigi

_________________
Que tous soient en liaison
Avec les Bouddhas des Trois Temps
Passés, Présents et Futurs,
Ici et Maintenant. |
|